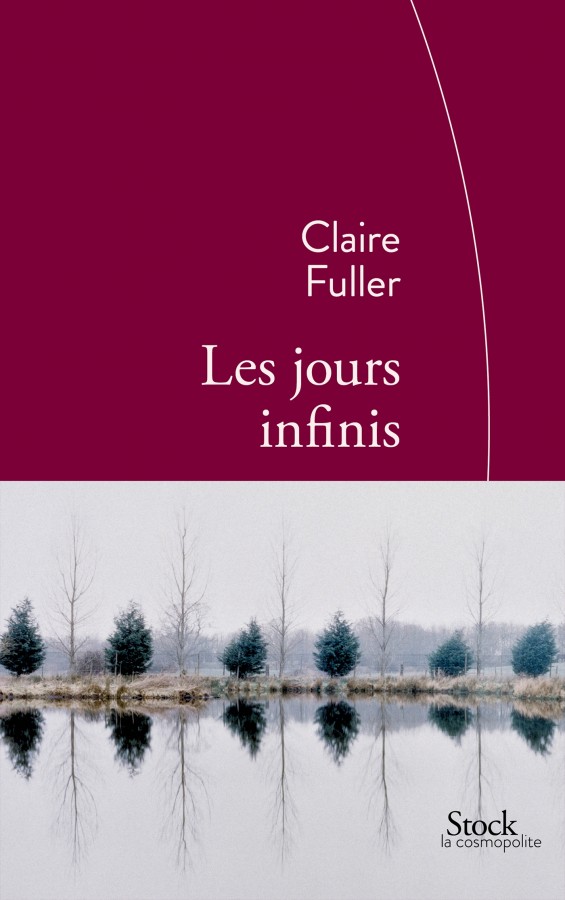Il se dit que Claire Fuller aurait eu l’idée de son roman en lisant une brève dans un journal : un adolescent séquestré dix ans par son père au fin fond de la forêt. L’article s’avéra être un canular, mais qu’importe, la jeune anglaise en a extrait la moelle pour écrire son premier roman, Les jours infinis.
En novembre 1985, dans un beau quartier londonien, une adolescente met la main sur une photographie représentant son père. Il semblerait bien que cette photo soit la dernière dans la maison à représenter cet homme désormais disparu, Ute, la mère, ayant fait le grand ménage et disparaître tout portrait ou autre photo de mariage. Peggy, notre jeune narratrice, se souvient alors de son père et de ses amis survivalistes qui venaient souvent à la maison, au milieu des années 70, quand elle était encore une petite fille. Un père aimant mais quelque peu obsédé par d’éventuelles conséquences de la guerre froide, qui après s’être attelé à construire un abri antiatomique dans le jardin pour protéger sa famille, se mit à enseigner à sa fille les premières techniques de survie. Dressant des listes de matériel indispensable, discutant des endroits les plus sûrs pour se mettre à l’abri d’une guerre ou d’une catastrophe, entraînant sa fille à faire du feu au fond du jardin, James Hillcoat se prit à un jeu qui, petit à petit, le grignota et ne le quitta plus.
Peggy a donc huit ans quand, en cette fin d’année scolaire, sa mère pianiste part en tournée en Allemagne laissant fille et père garder la maison. Un beau matin, coup de sifflet, Peggy prépare son sac à la hâte comme elle a été entraînée à le faire, et son père lui dit « On part en vacances ». Vacances qui, le lecteur le comprend dès le début, vont durer huit ans. Ils passent la Manche, prennent un bus, puis marchent des jours et des jours jusqu’à atteindre die Hütte, cabane au milieu de nulle part dont James avait parlé dans les contes qu’il racontait à sa fille. C’est assez rapidement que Peggy déchante et trouve le temps long, mais quand elle demande à son père s’ils rentrent bientôt à la maison, la réponse est sans appel : « Nous sommes à la maison, Punzel. »
Soulageant d’emblée son lecteur de l’incertitude du retour de l’héroïne, Claire Fuller s’amuse avec ses nerfs en alternant les chapitres sur les vacances prolongées, et ceux sur le retour de Peggy. Les descriptions de la nature, des éléments, et du passage des saisons valent le détour autant que les traits affûtés des personnages. Truffé de pièges, de faux-semblants, de légers changements de cap et de miroirs aux alouettes, le roman semble faire sa mue en même temps que son héroïne, et la légèreté enfantine proche du conte des premières pages laisse place à l’angoisse, l’incertitude et la rébellion propres à l’adolescence.
Mené de main de maître, un premier roman qui aurait pu être glauque, tape à l’œil ou voyeur mais qui, par l’habileté de son auteur, est mû par la grâce.
Claire Fuller, Les jours infinis, traduit de l’anglais par Mathilde Bach, Stock « La Cosmopolite », 2015.