[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]u sein de la scène électronique britannique, le DJ et producteur Richard Fearless aura tour à tour fait figure d’espoir prometteur, de second couteau ou de pâle suiveur, mais aussi de brillant franc-tireur, d’iconoclaste éclectique et de tête brûlée ingérable. Alors que vient de sortir le sombre et difficile Transmission, son sixième album en vingt ans sous l’identité Death In Vegas, il paraît opportun de revenir sur le parcours à contresens du bonhomme, de la lumière du mainstream à l’exigence de la marge.
A l’origine, Fearless forme le duo Dead Elvis avec Steve Hellier dès 1994, mais devra trouver, sous la pression des ayant-droits du King, un autre patronyme à son projet musical : qu’à cela ne tienne, le tandem opte pour la formule non moins sulfureuse Death In Vegas, et baptisera néanmoins son premier album de 1997 de son slogan programmatique initial. La mort du rock, ou le rock et la mort, l’acte fondateur de la formation se place d’emblée sous une obédience bien plus noire et bien moins festive que celle à laquelle souscrivent leurs confrères des Chemical Brothers, fers de lance du son « big beat » dont Dead Elvis (le disque, donc) propose, avec un temps de retard mais une énergie communicative, une version sale et viciée.
[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]e succès plus conséquent viendra avec l’album suivant, à partir duquel le noyau dur de Death In Vegas se résumera désormais à Richard Fearless et à l’ingénieur du son Tim Holmes : le très rock The Contino Sessions met l’accent sur les guitares sauvages, se paye un casting d’invités de luxe (le mythique Iggy Pop, le bouillant Bobby Gillespie de Primal Scream mais aussi son ancien frère d’armes au sein de Jesus & Mary Chain, le chanteur Jim Reid) et obtiendra en 2000 une nomination au prestigieux Mercury Prize, alors que le tube Dirge, hanté par la voix spectrale de Dot Allison, reçoit « l’honneur » d’illustrer un spot de pub Levi’s et que l’implacable Aisha se hisse dans le top 10 anglais.
[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]e troisième long format, Scorpio Rising, creusera encore davantage ce sillon en 2002, ajoutant une forte saveur psychédélique à son cocktail de base, et convoquant cette fois-ci la diva Hope Sandoval, transfuge des velvetiens Mazzy Star, et surtout les emblèmes de la brit pop de la décennie précédente : le vétéran Paul Weller et la grande gueule de la fratrie controversée d’Oasis, le turbulent Liam Gallagher.
Si la formule, déclinée alors sur la longueur de deux albums, fait de nouveau ses preuves, elle montre aussi les limites de l’exercice : contrairement à leurs contemporains Massive Attack, qui parviennent à fondre dans leur univers toutes les participations extérieures qui leur sont offertes, Richard Fearless et son acolyte façonnent pour leurs hôtes de puissants écrins sur mesure à la hauteur de leur talent, mais dans la même veine que leurs styles propres (le riff saignant d’Aisha comme écho aux années Stooges pour Iggy Pop, celui de Scorpio Rising en guise de clin d’œil aux sommets de son propre groupe pour Gallagher). Conséquence fâcheuse : si les titres pris isolément fonctionnent à merveille, leurs couleurs disparates nuisent à la cohérence de l’ensemble et, surtout, éloignent encore un peu plus Fearless de ses influences électroniques, pour faire de Death In Vegas une sorte de super-groupe certes inspiré, mais aussi vampirisé par l’aura de ses guest stars.
Au milieu de ce foisonnant collage sonore, c’est l’inconnue Nicola Kuperus (chanteuse des américains ADULT) qui tire le mieux son épingle du jeu, insufflant à l’oppressant et groovy Hands Around My Throat une langueur et une angoisse des plus prenantes, sa voix blanche et martiale s’enroulant avec délices autour d’une basse ronde et provocante, tandis que des guitares en forme de machettes déboisent une rythmique insatiable. Sans aucun doute le sommet du disque, et aussi la première graine d’une mutation à venir, encore plus profonde que la précédente.
[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]C'[/mks_dropcap]est à cette époque que la pression sur les épaules de Richard Fearless se fait de plus en plus forte voire ingérable : probablement fatigué et usé de fréquenter le milieu rock anglais et de vivre ses frasques, à mille lieues du son qu’il développe par ailleurs dans ses DJ sets minimalistes et radicaux, et bien que pressenti un temps pour prendre les manettes d’un album d’Oasis (un projet qui tombera à l’eau), il décide de casser son jouet pour mieux le réinventer. Death In Vegas quitte le label Concrete, sous-division du géant BMG, et monte la plus modeste structure Drone, sur laquelle sortira en 2004 le surprenant Satan’s Circus, qui voit le duo se recentrer sur la musique électronique, se séparer des guitares et, surtout, exclure les voix de son procédé créatif.

[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]B[/mks_dropcap]ien qu’étant couplé, comme pour faire passer la pilule du changement auprès de leurs fans, à un excellent album live à la Brixton Academy de Londres, témoignage de la période plus accessible de la précédente tournée de 2003, le disque sera un cuisant échec, public comme critique : les uns se sentiront trahis par un musicien qui aura passé trop de temps à faire du rock pour avoir le droit de lui tourner le dos, les autres reprocheront à Fearless de ne proposer qu’une imitation de ses modèles du genre, les piliers Kraftwerk et le kraut rock allemand en général. Pourtant, Satan’s Circus, derrière son approche plus minimaliste, aurait dû entériner la renaissance du duo en tant que formation électronique crédible, et constituait à ce jour l’album le plus homogène et cohérent à porter la signature de Death In Vegas.
[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]près avoir largué les amarres sur le plan musical, Richard Fearless l’accomplit dans la foulée d’un point de vue géographique, émigrant à New York pour s’adonner à une autre de ses passions, la photographie. Sur place, il montera tout de même l’éphémère groupe rock Black Acid, dont les morceaux ne dépasseront jamais les limites de MySpace, mais lui donneront l’occasion de passer lui-même derrière le micro, chose qu’il n’avait jamais tentée en dix ans de carrière avec Death In Vegas.
Ce n’est qu’après ces quelques années d’exil, et seul aux commandes, que Richard Fearless reviendra aux affaires (et à son fief londonien), après une longue mise en veille du projet et la lente gestation d’un cinquième album, le bipolaire Trans-Love Energies, qui sortira finalement en septembre 2011 sur le label Portobello Records : à l’opposé des digressions instrumentales du précédent, le disque convoque la rugosité rock des morceaux créés avec Black Acid tout en réaffirmant l’attrait indéfectible de son créateur pour des sonorités plus synthétiques et dansantes. Si ce dernier chante sur la majorité des titres les plus durs, marqués de l’influence du noisy rock chimique des Spacemen 3, il laisse à la nouvelle venue Katie Stelmanis l’occasion de briller de mille feux sur l’obsédant single Your Loft My Acid, dont les mélopées enivrantes confinent à l’hypnose, en particulier sur une version remixée par Fearless lui-même, qui laisse se rejoindre comme jamais la noirceur menaçante de Death In Vegas et la pulsation techno de ses DJ sets magnétiques.
https://youtu.be/HrLY83iZT3Q
[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]À[/mks_dropcap] la suite de ce retour inespéré, Richard Fearless a réactivé son label Drone, sur lequel il a publié depuis deux ans plusieurs maxis haut en couleurs (Gamma Ray, Higher Electronic States) et, surtout, a rencontré celle qui allait devenir son alter ego sur la longueur entière de son album suivant : la jeune américaine Sasha Grey, ex-actrice X reconvertie depuis dans le cinéma dit « traditionnel », et devenue par la même occasion modèle, écrivain, productrice et… chanteuse, ayant notamment collaboré avec le groupe expérimental culte Current 93.

[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#0a0a0a »]U[/mks_dropcap]nis par une estime mutuelle (dont on ne veut absolument pas connaître les limites) et un amour des pionniers industriels de Throbbing Gristle, la paire entreprend de fusionner ses univers respectifs pour ce qui deviendra un nouvel album de Death In Vegas en bonne et due forme. Avec sa pochette mystérieuse suggérant un voyeurisme inversé et inquiétant (comme un rétroviseur sur un passé sulfureux, pour l’un comme pour l’autre), et sa longue et froide méditation d’ouverture (les onze minutes instrumentales de Metal Box, du nom du studio monté par Fearless sur les bords de la Tamise), ce monumental Transmission s’impose d’emblée comme un voyage des sens qui ne laissera ni indemne, ni de marbre.

[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]E[/mks_dropcap]t pourtant, ce qui frappe dès les premières minutes d’écoute, c’est le contre-pied total que prend ce nouvel album avec les productions précédentes de l’entité Death In Vegas : le son n’est ni léché au détail près comme sur les disques des débuts, ni orchestré avec relief comme les deux derniers en date. Ici, la charge est d’un seul bloc, et même lorsque la voix de Sasha Grey apparaît enfin, elle est enveloppée dans la gangue synthétique ourdie par son partenaire, au même niveau que l’impressionnant arsenal d’ambiances urbaines, de claviers envoûtants et de rythmiques éclatées qui occupe l’espace sans laisser d’air autour. Cette sensation est encore renforcée par le sentiment que ces soixante-six minutes semblent avoir été enregistrées d’une traite (erreurs conservées et incluses), ce qui expliquerait la construction en lente montée progressive, comme un échauffement en temps réel, de la mise en place chaotique de ces Consequences Of Love à la basse sourde et insistante de Transmission, des accélérations refrénées de Mind Control au ralentissement en trompe-l’œil de Flak.
Tout le disque est traversé par une tension sourde, d’abord impalpable puis de plus en plus envahissante : les rythmiques ne s’éclaircissent qu’à partir du milieu de l’album, lorsque les claviers blafards de Sequential Analog Memory croisent la séduction toute en sous-entendus glacés de Arise. Faussement apaisée, l’humeur distillée ici est à la fois trop sombre et malsaine pour n’être qu’un simple fond sonore ambient, et parallèlement, bien qu’égrainant des éléments disparates de plus en plus prenants, le groove développé est bien trop poisseux et lancinant pour être réellement euphorisant : c’est dans cet entre-deux subtil et fragile, mais aussi habile et machiavélique, que le tandem nous prend, tel un sandwich dominateur, pour jouer avec nos nerfs et nos émotions, en alerte dans tous les sens du terme.
L’issue de la délivrance n’est lâchée qu’après l’accalmie presque dissonante de Strom, par ce qui semble être la clé de voûte de la collaboration entre Grey et Fearless. Avec ses huit minutes vrillées entre basse puissante et claviers acides, You Disco I Freak sonne comme la somme de tout ce qui a précédé et nous entraîne vers des interdits inavouables, alors que la voix hallucinée de Sasha Grey assène son slogan au message sans équivoque, comme une claire répartition des rôles : « Tu balances le son et je pète les plombs ».
[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]O[/mks_dropcap]n ne sait pas quel club torve pourrait balancer une telle musique à ses habitués, mais une chose est certaine : il y a là de quoi faire bouillir celles et ceux qui aiment leur dance sombre, perverse et suggestive. La conclusion Transwave n’est ensuite prétexte qu’à nous imposer une vertigineuse redescente, après nous avoir fait traverser des paysages à la foi effrayants, fascinants et addictifs.
Avec Transmission, Richard Fearless a réussi un disque hybride, certainement le plus important et le plus abouti de son parcours, sur lequel l’humain et la machine coexistent enfin à égalité, se reniflent, se toisent et se défient, toujours à la limite de la provocation en duel mais sans jamais céder à l’affrontement. Tout difficile d’accès qu’il soit, être spectateur et auditeur d’une telle mise en abyme de nos peurs modernes, entre frustrations indicibles, isolement flippant et paranoïa incurable, au son d’une musique aussi passionnante et enlevée, tend à induire un état étrangement extatique, ce qui est peut-être la raison d’être majeure de cet album.
Et expliquerait, en creux, son titre.
Nous sommes, à notre manière, nous aussi des machines : bien que complexes, sensibles et contradictoires, il suffit malgré tout d’appuyer sur les bons boutons pour nous mettre en transe.
Mission accomplie.
Transmission est disponible depuis le vendredi 27 mai 2016 en CD, triple vinyle et digital via le label Drone.
Site Death In Vegas Music – Facebook Officiel




















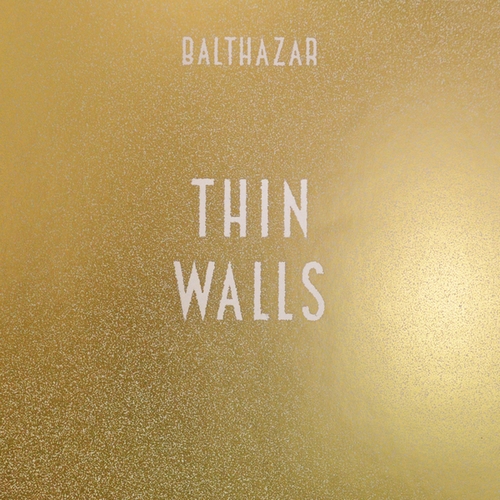
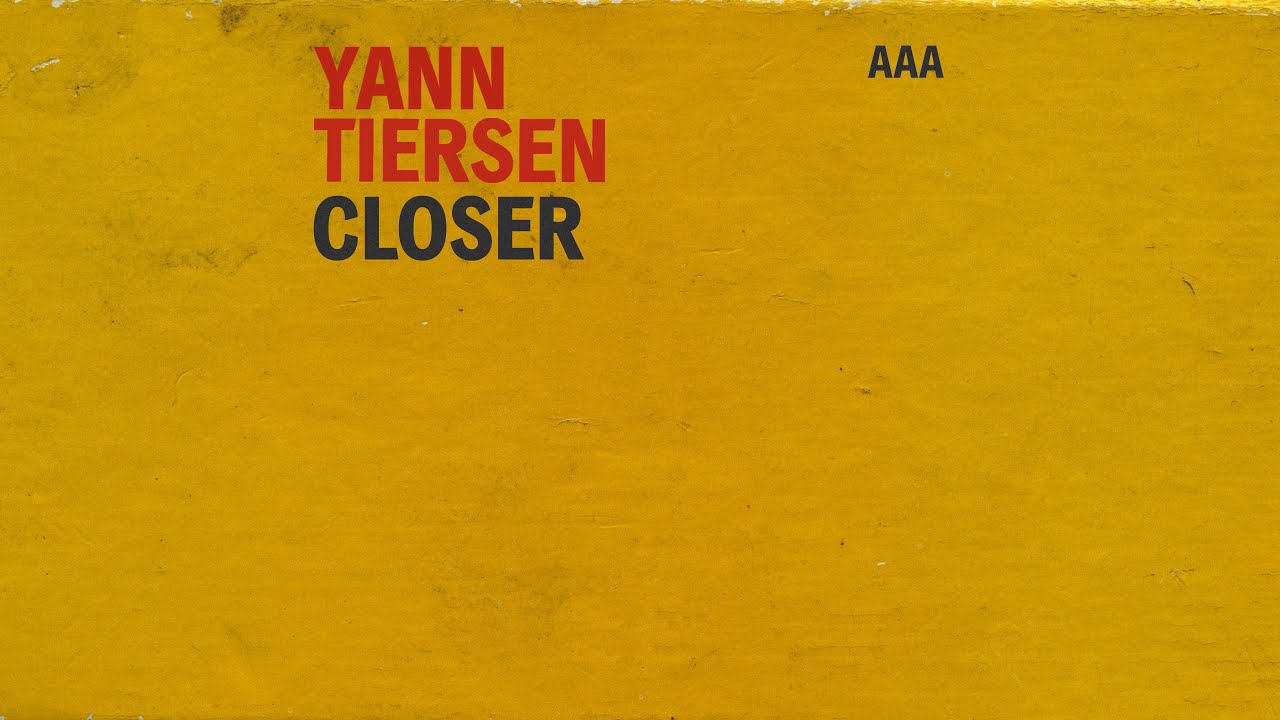

Bonne chronique, grand disque !