[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#D02E26″]A[/mks_dropcap]vec Kill Bill, Tarantino se déchaîne, se livre à un festival de références qui fait l’effet étourdissant et jouissif d’un grand huit de cinéma et une envie d’applaudir comme un gosse à chaque séquence. Cette déclaration d’amour au cinéma de genre et à tous les cinémas est un moment qu’on n’oublie pas, car il se permet toute les audaces formelles, dans un jeu vertigineux de clins d’œil cinéphages.
Jamais hommage aussi vibrant ne fut rendu à une cinéphagie polymorphe qui va -en gros- des films de Kung-fu aux western spaghettis, des mangas au Blood simple des frères Coen, jusqu’à une touche intimiste que l’on découvre avec surprise à la fin du second volet. Kill Bill est une offrande aux fruits de la culture pulp que nous sommes tous peu ou prou, nourris de télé, de jeux vidéos et de dessins animés, ayant intégré les nouveaux codes que cela impose dans l’art.
Le découpage par chapitres est hautement trompeur puisque tout est dans le désordre (le début du premier volet si situe après sa fin et la confrontation avec Oren Ishii et les crazy 88), le début du second volet pourrait faire office de prologue au premier film (la répétition du mariage et la raison de la vengeance de la mariée). Tout est donc lié. L’intertextualité et la déstructuration sont poussées à un degré rare entre les deux films.
Le premier volume est avant tout un film centré sur l’action, en hommage aux films de sabre et de vengeance (comme Lady Snowblood) et aux légendes du kung-fu (la combinaison d’Uma Thurman lors du massacre final est la même que celle de Bruce Lee, dans son ultime film, Le jeu de la mort).
Le second film repose beaucoup plus sur les sentiments et le passé des personnages qui s’étoffe, beaucoup plus axé sur les dialogues (la tirade de Bill sur les super-héros) et au style plus habituel de Tarantino (bourré toutefois de références aux Western Spaghettis, aux chefs-d’oeuvre de Sergio Leone surtout Le Bon, la Brute et le truand et Il était une fois dans l’ouest). On retrouve également des noms de code improbables comme dans Reservoir dogs.
Au niveau de la B.O on retrouve des musique empruntées à d’autres films (celle d’Ennio Morricone -bien sûr- et de Bernard Hermann auteur des B.O d’Hitchcock) ainsi que des variations autour du « Bang, Bang (my baby shot me down) » de Nancy Sinatra. La partie animée du premier volet (sur les origines d’Oren) a été confiée à l’équipe responsable de Ghost in the shell et Jin-Roh, brigade des loups (deux sommets du genre). Le film est donc foisonnant, profondément hétéroclite, un patchwork cinéphile. Avec la passion vorace de Tarantino pour lier le tout.
Le jeu d’Uma Thurman impressionne. Elle rappelle Clint Eastwood dans la trilogie des dollars, ce personnage très marqué, très typé, très maltraité aussi, qui parle assez peu dans le premier volet. Puis sa vulnérabilité apparaît, son prénom et son histoire se révèlent. Après un début dans la vengeance impassible, on finit par la connaître, et le second volet lui donne un passé. Elle joue à merveille le type de l’héroïne sans pitié et dure à cuire (presque à la Charles Bronson). Elle effectue graduellement au long des deux films un retournement puisque à la fin du second elle se libère enfin de sa rage. Elle compose là l’un des plus beaux personnages des années 2000, à la fois identifiable comme une super-héroïne (forcément névrosée), profondément humaine et fragile.
Tarantino filme ses icônes: Sonny Chiba incarne Hattori Honzo, celui qui a perfectionné l’art de fabriquer des sabres et qui va briser son serment de ne plus faire d’instruments de mort car il épouse la cause de l’héroïne. Il opposait au style aérien et chorégraphié de Bruce Lee, son style plus brutal et violent. Grand cascadeur et expert en son domaine, il enseigna aux acteurs les rudiments du combat de sabre. Gordon Liu, autre figure mythique du cinéma d’arts martiaux (héros de La 36ème chambre de Shaolin ainsi que sa suite), se trouve à la tête des crazy 88’s et incarne le vieux maître d’art martiaux, Pai-Mei, puissant et invincible au combat, mais totalement irascible, impitoyable et un tantinet sadique (correspondant en cela à la figure proverbiale et typique du vieux maître). Pour incarner Gogo la jeune garde du corps d’Oren (et accessoirement totalement psychopathe), on découvre Chiaki Kuriyama (remarquée dans Battle royale). Tarantino a pour l’occasion adopté la langue et l’ambiance du Japon, ainsi qu’une mise en scène très respectueuse des codes du genre (les zooms rapides par exemple).
La galerie des seconds rôles est extraordinaire : Lucy Liu incarne une femme traumatisée par la mort de ses parents (beau et terrifiant flash black sur son enfance en forme d’animé japonais), devenue après sa vengeance une tueuse impitoyable et qui prit la tête des Yakuzas de Tokyo. Daryl Hannah est monumentale. Elle joue avec maestria de l’œil unique de son personnage borgne. Elle embrasse avec délice sa froideur impitoyable, jusqu’à devenir un personnage incontournable. Elle est la méchante parfaite, typique de perversité et de traîtrise.
Enfin il y a Bill, David Carradine, figure mythique du feuilleton Kung-Fu (auquel Samuel L. Jackson faisait déjà référence à la fin de Pulp Fiction). Il a une aura, savamment montée en épingle pendant tout le premier volet (où l’on ne voit que ses mains et où l’on entend que sa voix), une présence et un charisme naturel dans le second film, ce petit quelque chose de plus comparable à l’effet que produit Pam Grier dans Jackie Brown ou John Travolta dans Pulp Fiction. Ces acteurs là savent apporter leur supplément d’âme, les souvenirs qui sont liés à eux (peut-être l’ombre de tous les personnages qu’ils ont incarnés) dans un film à leur mesure.
A la fin de Kill Bill volume 2, Uma Thurman fait un clin d’œil complice à la caméra. Et après cette vengeance rageuse et ce bain de cinéma, on ne peut qu’être reconnaissant, et on a envie de lui rendre ce petit signe de connivence. Dans la vengeance sanglante de l’héroïne, on retrouve mélangés dans un cocktail sublime les procédés de De Palma (le split-screen), l’univers de Sergio Leone, la violence stylisée du cinéma de Hong Kong, la beauté des combats de sabres, la distinction du Noir et Blanc.
Ce film est comme une friandise défendue où tout ce qu’on s’interdisait, ce qu’on considérait comme mineur, pas sérieux, dépourvu de noblesse, grossier, devient permis, éclate dans toute sa splendeur déchaînée.




















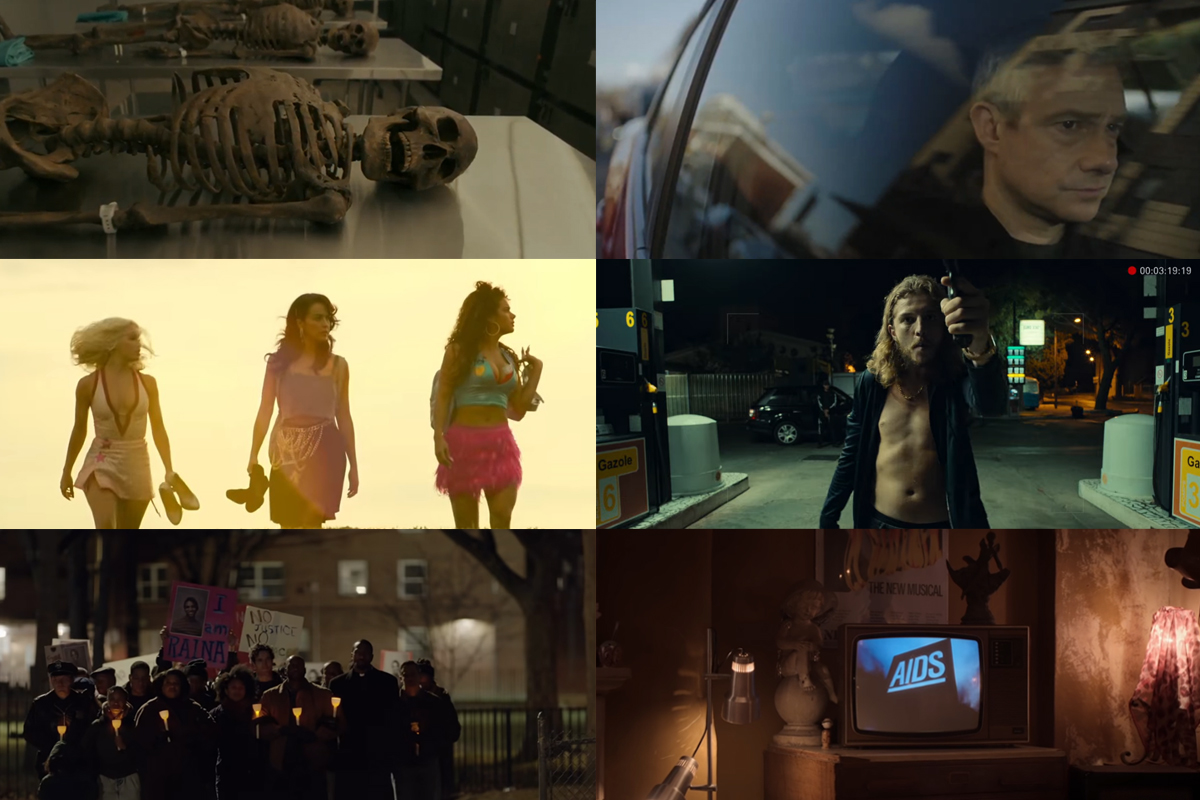
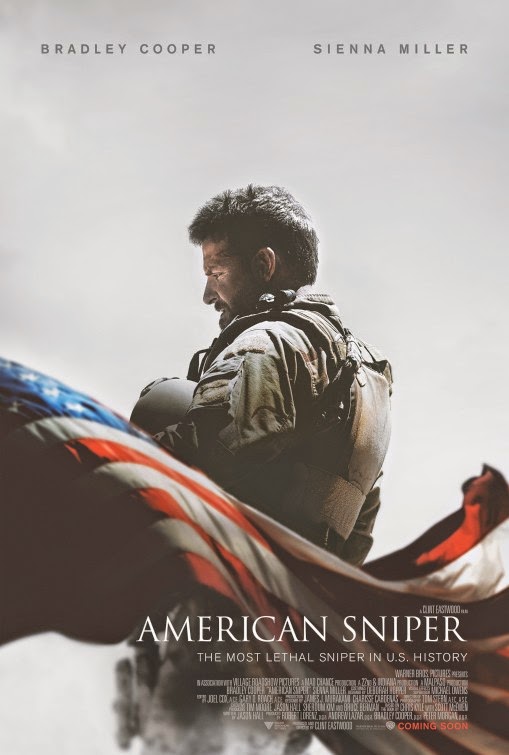


Culte!