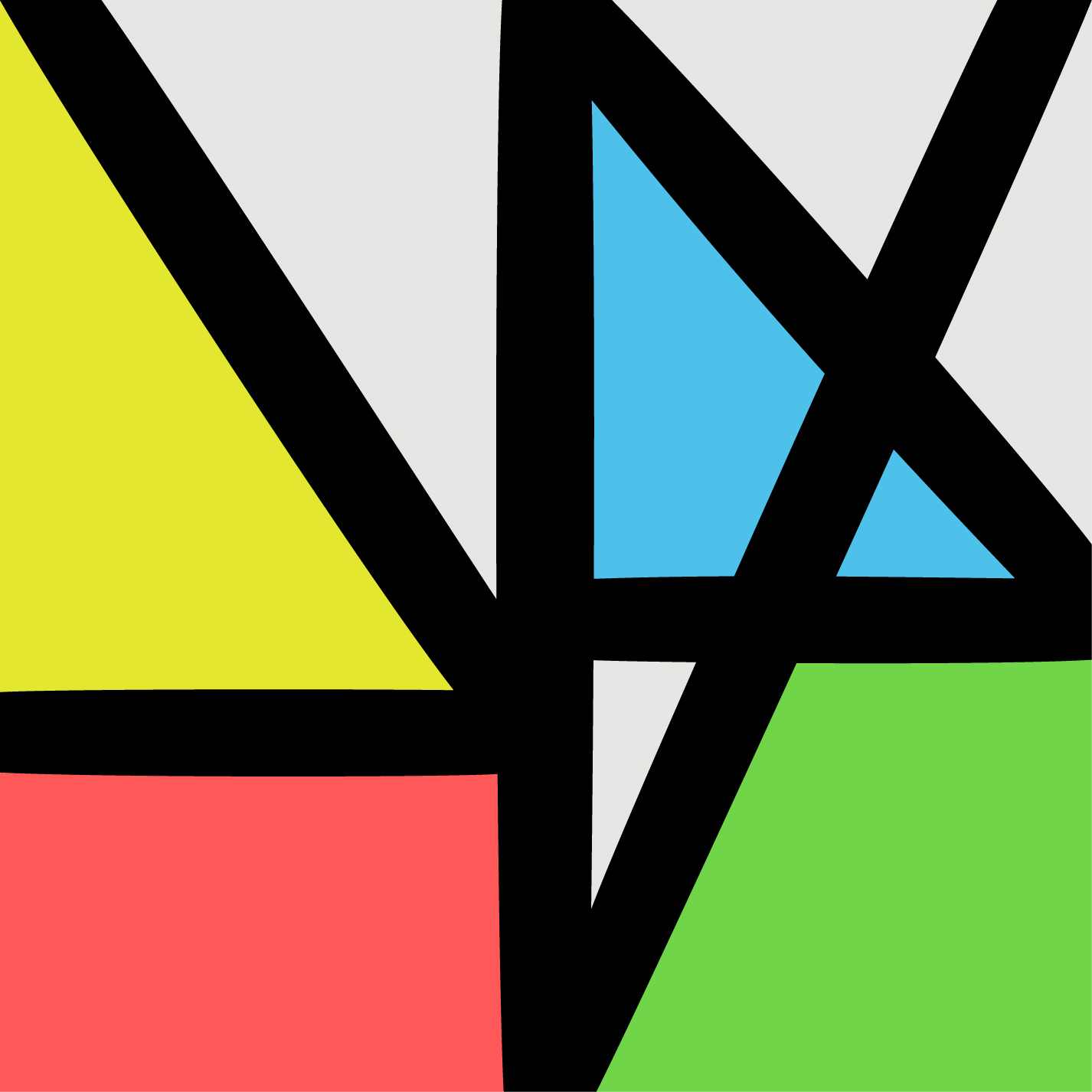[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#bd047c »]A[/mks_dropcap]Certain Ratio fait partie de ces groupes essentiels qui mériteraient enfin une reconnaissance à la hauteur de leur talent. Le récent travail de réédition de leurs albums par Mute ainsi que deux coffrets de pépites plus ou moins rares devraient remettre les pendules à l’heure. Ce groupe inclassable a depuis 1979 été capable de nous proposer des titres empreints d’une froideur extrême, de funk, de jazz, de pop ou d’électronique. Si son histoire est intimement liée à celle du mythique label mancunien Factory Records jusqu’en 1986, A Certain Ratio a depuis continué à nous surprendre. Nous avons rencontré Jez Kerr, un des membres fondateurs, à l’occasion des 40 ans du groupe et de la sortie du coffret ACR:BOX. Retour sur un parcours unique et quasi sans faute qui ne va pas s’arrêter en si bon chemin puisque Jez nous annonce l’enregistrement d’un nouvel album, le premier depuis 2008.
A Certain Ratio s’est formé grâce au Manchester Musician Collective. Pourrais-tu nous dire en quoi cela consistait ?
C’était un organisme public qui bénéficiait de fonds pour développer la culture à un niveau local. Ils organisaient ce qui s’appelle encore des Band On The Wall. Ils louaient un club le lundi soir et six ou sept groupes locaux s’y produisaient. Nous n’étions pas payés mais c’était un endroit parfait pour jouer quand tu débutais. Heureusement, la bière était gratuite (rire). C’est Franck, un hippie aux cheveux longs, qui gérait tout ça. Tous les groupes du coin sont passés par là. The Fall, Joy Division etc. Tu pouvais t’y produire sans avoir la pression de devoir vendre beaucoup de tickets d’entrée. La soirée était subventionnée. C’est grâce à Band On The Wall qu’une scène s’est créée à Manchester à la fin des 70’s.
Le groupe a sorti son premier single “All Night Party” il y a 40 ans. Que penses-tu de ce disque aujourd’hui ?
Je l’aime beaucoup. Ne pas avoir de batteur lui donne un charme particulier. Nous savions à peine jouer de nos instruments. Ce sont ces limitations qui ont donné à ce titre un son original. Nous avons eu de la chance de sortir notre premier disque juste après l’explosion du punk. Des labels indépendants comme Factory se sont créés un peu partout au Royaume-Uni. Grâce à cette explosion des gens qui ne seraient jamais devenus musiciens ont tenté leur chance. Le punk nous a appris que n’importe qui pouvait tenter sa chance et sortir un disque.
Les critiques ont été mauvaises à l’époque. Cela a t-il été difficile à encaisser ?
On s’en moquait complètement. Quand tu as 18 ans, tu as tendance à penser que tu es dans le meilleur groupe du monde. Pour nous les critiques étaient des abrutis. Avec du recul je peux comprendre leur réaction. Comparativement aux Clash ou aux Sex Pistols qui tenaient la route, nous n’étions pas très bons. C’était une époque différente. A la fin des 70’s, si John Peel passait ton disque ou si tu avais une critique dans le NME, cela signifiait que tu étais accepté par une certaine scène. L’énorme scène des musiciens qui ne savaient pas jouer (rire). Une mauvaise critique ne t’empêchait pas de vendre des disques ou de trouver des dates de concerts car cette émergence de groupes indépendants était une nouveauté.
Dès le début du groupe, vous avez voulu jouer un style musical en opposition au punk. Pourrais-tu nous dire pourquoi ?
Les Sex Pistols ont ouvert la voie, mais le mouvement punk en lui même s’est vite essoufflé. Jouer les trois mêmes accords que les Pistols n’aurait mené à rien. Nous n’étions pas les seuls à garder l’essence et l’état d’esprit du punk tout en voulant se démarquer. La majorité des groupes qui ont compté ont tenté de faire quelque chose de différent malgré leurs limitations. Je pense par exemple à Wire, Pere Ubu ou The Human League. Ils avaient tous un son unique qui tient encore la route aujourd’hui. Leur musique reste élaborée et personnelle. Elle crée une alchimie entre le public et le groupe.

Tony Wilson, votre manager et membre fondateur de Factory Records vous appelait pourtant les nouveaux Sex Pistols ! Il pensait que vous alliez obtenir un tel succès que vous finiriez par déménager à Beverly Hills !
Tony était un beau parleur. Nous avions confiance en nous, mais si nous avions rencontré un énorme succès, Beverly Hills n’aurait pas été notre choix (rire). C’est marrant, à l’époque tout le monde pensait que nous étions des gamins de riches. C’était loin d’être le cas. C’est sans doute à cause de ce que racontait Tony. Il était doué pour tout monter en épingle. C’était un homme intelligent. Tout le monde buvait ses paroles.
Malgré son talent et son baratin, vous êtes pourtant restés un moment dans l’ombre de vos compagnons de label et amis Joy Division.
La presse ne nous a pas épargnés. À juste titre. Joy Division était un groupe fantastique. Mais on a galéré à cause de ça. On nous appelait “l’autre groupe” (rire). Cela n’a à aucun moment posé problème à notre amitié. Nous sommes toujours excellents amis. A l’époque il y avait des “packages” Factory pour les concerts. Nous tournions sans cesse avec Joy Division, OMD, The Durutti Column. À part les groupes de chez Stiff, personne ne faisait ça chez les labels indépendants. Nous étions comme une famille. Il y avait de l’entraide. J’ai par exemple mis sous pochette 1000 exemplaires de A Factory Sample. Il fallait 10 minutes pour en réaliser un. Une fois la pochette pliée, il fallait la sceller. On s’en moquait, on était excité par ce projet même si nous n’avions aucun titre dessus.
On a souvent comparé vos premiers enregistrements à Joy Division. Vous étiez proches du groupe et tourniez ensemble. Pensez-vous que cela soit dû à la production de Martin Hannett ?
Clairement. Il y avait également des similarités dans le chant de Martin et de Ian Curtis. Tous deux étaient de Manchester et ne savaient pas vraiment chanter. Ils utilisaient également le même vocabulaire un peu désuet. Aucun n’a copié l’autre. Chaque groupe était insulaire.

Comme pour Joy Division, le nom de votre groupe a été mal interprété. Il s’agit à la base d’un extrait des paroles de The True Wheel de Brian Eno. Il se trouve que c’était aussi un nom utilisé par Hitler pour déterminer qui était juif ou pas en fonction des liens de sang. John Peel a même boycotté vos disques à un moment. Avez-vous attiré un mauvais public à vos débuts pour cette raison ?
John Peel nous a toujours adorés. Nous avions de très bons rapports avec lui. Il se moquait toujours de nous car, étant de Liverpool, il ne pouvait s’empêcher de jouer sur la rivalité des deux villes. John nous a fait jouer à Londres avec les Undertones. Il nous a introduit sur scène en annonçant : “Et maintenant, en provenance de Liverpool, A Certain Ratio (rire). Par contre, il ne nous jamais boycotté des ondes. C’est une légende. Nous avons souffert de cette image nazie. En pleine émission télé, une femme a hurlé “fascistes !” en nous pointant du doigt. J’avais envie de lui hurler dessus. Ces gens n’écoutent pas nos paroles. Ils ne savent même pas que notre batteur est noir. Sur la pochette de To Each, notre batteur Donald Johnson regarde quatre officiers nazis par une fenêtre. C’était une blague par rapport à tout ça. Certaines personnes sont allées jusqu’à penser que c’était un plan marketing.
L’arrivée de Donald à la batterie a apporté un son plus funk. Que s’est t-il passé ?
Cela datait d’avant son arrivée. Nous avions déjà six ou sept morceaux composés dans cette lignée en prévision d’un nouvel album. Quand Donald nous a rejoints pour la première fois, il nous a demandé ce que l’on attendait de lui. On lui a répondu : “ajoute juste de la batterie sur ces morceaux”. Nous n’avons rien changé, Donald a juste ajouté son style si particulier de batterie. Les titres sonnaient plus puissants. Les premiers morceaux composés avec Donald, Flight et Oceans, ont pris une direction funk encore différente. Avant son arrivée, l’absence de batterie nous obligeait à remplir au maximum les espaces laissés libres. Grâce à Donald notre musique a commencé à respirer. Les gens pensent souvent que nous avions des plans établis pour faire évoluer notre style musical. C’est complètement faux. Nous étions signés chez Factory. Et chez Factory, personne n’avait de plan. Aucun groupe ou salarié n’avait conscience de ce qu’il faisait. C’est pour ça qu’il en est sorti autant de bonnes choses. Les meilleures chansons sont provoquées par des accidents.
Vous avez failli collaborer avec Grace Jones qui voulait vous utiliser comme backing band. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Aujourd’hui encore, je ne suis pas certain qu’elle était vraiment au courant de tout ça. C’était plus quelque chose discuté entre conseillers. Grace Jones avait repris Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Nous avions joué en concert avec les Talking Heads. Tony Wilson a eu la super idée de proposer à Grace Jones d’enregistrer une reprise de Houses in Motion des Talking Heads avec nous. Ça ne s’est jamais concrétisé car Chris Blackwell, le patron d’Island Records (chez qui Grace Jones était signée-ndlr.), a entendu parler de ce projet. Il est devenu fou. C’est lui qui produisait Grace Jones. Il avait créé le son qui l’a rendue célèbre. Je suppose que quand il a entendu que des inconnus de Manchester voulaient jouer avec elle, il n’a pas du tout apprécié (rire). Nous ne savions même plus que nous avions les bandes de ce titre. Nous avons un coffre fort avec tous nos masters. Quand nous avons mis le nez dedans pour le coffret ACR:BOX, nous avons trouvé cet enregistrement sans aucun chant. C’était une version guide pour que Simon Topping, notre chanteur de l’époque, pose sa voix pour des essais. On a passé trois jours à essayer de rendre justice à cette version en y ajoutant ma voix et de la trompette pour qu’elle soit disponible sur le coffret. Je suis fier du résultat contrairement aux fans des Talking Heads (rire). Nous avons depuis trouvé une autre version produite par Martin Hannet. C’était la version définitive pour Grace Jones. Nous lui avons récemment demandé si elle voulait chanter dessus. Elle n’était pas intéressée.
En 1983-4, le groupe a traversé une période difficile créativement parlant. Vous n’étiez pas vraiment satisfaits de vos enregistrements. Que s’est-il passé ?
Il était difficile de donner suite à Sextet qui est pour moi l’apogée des débuts du groupe. C’est un album cohérent et jazzy. On y sent une grande liberté. Après la sortie de ce disque, Peter Terrell et notre chanteur Simon Topping ont quitté le groupe. Il a fallu se réinventer. J’ai été désigné chanteur. Je n’étais pas enchanté car j’aimais être le bassiste qui se cache au fond de la scène. C’était dur pour moi. Il m’a fallu 20 ans pour être à l’aise (rire). Après Sextet, nous avons sorti I’d Like To See You Again, un album que je déteste. Et pourtant c’est l’album préféré d’un super groupe de Manchester, The Orielles. Ce sont des gros fans du groupe. La nouvelle génération est étrange (rire).
Comment était-ce de se retrouver chez A&M, un gros label, après être passé chez Factory ?
Il n’y avait pas de grosse différence avec Factory car A&M était en train de s’effondrer financièrement. Le personnel se faisait licencier. Nous voulions du changement. Avoir des gens qui s’occupent de nous, enregistrer dans de grands studios. Il y a de bonnes chansons pop sur Good Force. Mais je trouve que les démos présentes sur le coffret ACR : BOX sont meilleures que les versions définitives. Le producteur Julian Meldenshon avait trop poli le son de l’album. Il était plutôt habitué à travailler avec des grosses pointures comme les Pet Shop Boys.
Financièrement, cela en valait-il la peine ?
Oui car nous avons construit un studio d’enregistrement à Ancoats, près de Manchester, avec l’argent que nous avons gagné. Nous pouvions enfin produire notre musique. C’est là que nous avons enregistré ACR:MCR, l’album suivant. C’est mon préféré du groupe. Nous l’avons livré clé en main à A&M. Nous avons tout réalisé nous-même. Même la pochette. Nous avons quitté le label peu de temps après. Il allait se faire racheter par Universal. Il est impossible de travailler avec eux sur Good Force et ACR:MCR. Universal est une industrie dédiée au cinéma plus qu’à la musique. Nous n’arrivons même pas à les faire ajouter nos disques sur Spotify. Ils ne veulent pas les rééditer non plus. Nous avons dû leur louer ces deux disques pour les sortir sur Mute. Un véritable cauchemar. Heureusement, nous sommes propriétaire des versions alternatives. C’est pour cette raison qu’on les retrouve sur le coffret.
Comme New Order, vous êtes aujourd’hui signés chez Mute Records. Pourquoi vous être orientés vers ce label mythique ?
Ça s’est fait grâce à Andy Robinson, l’un des deux managers de New Order. Il a conseillé à Daniel Miller, fondateur de Mute, de rééditer notre catalogue. L’idée lui a plu. Même dans les années 80 nous rêvions secrètement d’être signés chez Mute. Cela aurait été comme être chez Factory mais en gagnant de l’argent (rire). Nous sommes ravis de la qualité des rééditions. Le premier coffret ACR:SET avait pour but de présenter le groupe à ceux qui nuie le connaissaient pas. ACR:BOX est plutôt pour les fans. Depuis un an, nous enregistrons un nouvel album. Nous le finançons entièrement. À notre plus grande joie, Mute est partant pour nous signer et le sortir. Nous étions inquiets de devoir nous arrêter en si bon chemin. Le point commun avec Factory, c’est qu’ils croient vraiment aux groupes qu’ils signent. C’est ce qu’il y a de plus important pour nous.
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
[one_half]
Le coffret ACR:BOX
de A Certain Ratio
Sorti chez Mute Records/PIAS.
Crédit photo : Michela Cuccagna
Merci à Marine Batal
[/one_half][one_half_last]
[/one_half_last]
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]