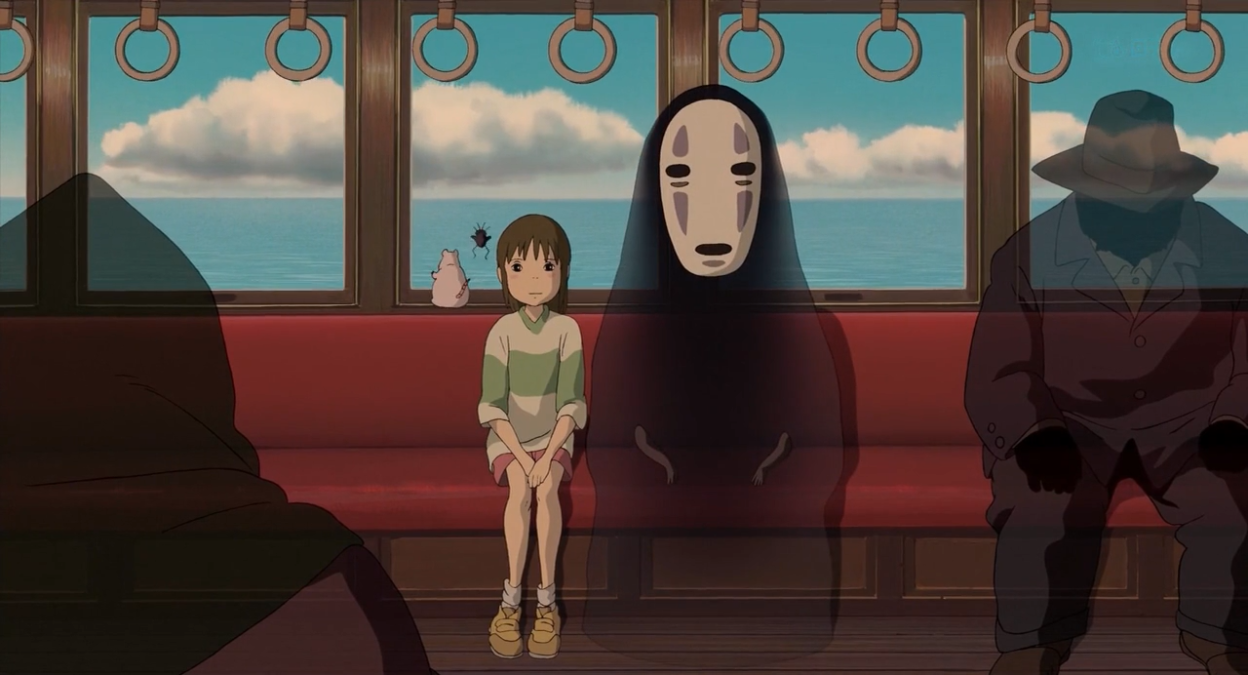Vendredi 28 mai 2017
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]D[/mks_dropcap]ans la fourmilière constante qu’est le Festival, les voisins se suivent et ne se ressemblent pas.
L’attente favorise les discussions, ou au moins l’oreille jetée sur la conversation d’à côté…
Le plus souvent, le voisin est un compagnon bienveillant : c’est cet étudiant taiwanais qui a tenté de m’expliquer pourquoi je n’aimais pas le dernier Kawase, ou ce journaliste Suisse qui a enfin trouvé le soutien qu’il attendait depuis longtemps lorsque je lui ai confirmé que Taxi Teheran était mineur sur le plan cinématographique et Asghar Farhadi très surcoté. Et m’a remercié en m’indiquant un endroit caché dans le Palais où on pouvait se nourrir d’autre chose que de dossiers de presse, qu’il en soit ici remercié.
C’est ce vieux briscard qui m’a expliqué où trouver Le Film Français à 7 heures du matin, avant de le regretter en me demandant de ne pas diffuser l’info sous peine de ne plus le trouver lui-même. Je ne vous dirai donc rien, même sous la torture.
Ce sont ces foules d’amateurs passionnés, souvent des retraités, qui trouvent des invitations et sont tellement ouverts au dialogue qu’ils finissent par vous parler de l’AVC de Norbert et vous empêchent de boucler l’article que vous pensiez finir avant le début de la projection.
C’est cette journaliste qui appelle son enfant avant la projection de l’Atelier, et lui dit qu’il reste 5 dodos avant que maman revienne.
C’est l’acheteuse norvégienne qui me dit que Loveless est formidable, mais pas norvégo-compatible en terme de diffusion, et me conseille dans la foulée Sans Pitié, un film coréen dont la teneur en plomb est apparemment universellement compatible.
C’est ce canadien qui intervient dans ma conversation avec le taiwanais sur Mise à mort du cerf Sacré, et m’explique que ma phrase « Le son était insupportable » se traduit chez lui par « Sound was shit ». Et de vanter l’explicite de sa langue en fustigeant la préciosité des français. Que cet asshole reçoive ici l’expression de mes plus humbles excuses.
Mais dans la cohue, la frénésie permanente engendre aussi quelques frictions. Dans la salle Debussy, les badges jaunes entrent en dernier, et ont droit aux places les plus misérables, dont certaines sont tellement sur le côté qu’elles ne permettent pas de voir la totalité de l’écran. Je maudis triplement le journaliste qui m’a piqué la place à côté de moi pour la projection d’Une femme douce :
- parce qu’il avait un angle de vue plus confortable que moi, contraint à la torsion cervicale
- parce qu’il ne l’a pas honoré en dormant pendant TOUTE LA PROJECTION de deux heures 25.
- enfin et surtout parce qu’il a eu raison de le faire, pendant que je souffrais musculairement et culturellement.
Le voisin, et la foule avec lui, dictent la tendance. Maudits soient les spectateurs qui sortent cinq minutes avant la fin du film, probablement pour arriver les premiers aux toilettes, ou au bar Nespresso du service de presse.
Je me demande encore ce que pouvait bien raconter mon voisin d’urinoir qui twittait d’une main pendant qu’il s’affairait de l’autre. Mais vu qu’on sortait de la projection du très mauvais Kawase, je pense qu’il y avait un lien entre les deux occupations.
Je me suis demandé un moment pourquoi la voisine de projection de Out ne regardait pas dans la bonne direction, avant de comprendre qu’elle dormait.
Je me suis demandé ce que pouvait bien écrire ma voisine sur son portable, notamment pour savoir ce qu’elle pensait des films en compétition. La première fois, c’était en cyrillique. La deuxième, en idéogrammes. J’ai abandonné.
Les écrans sont partout, tout le temps. J’ai cru que j’étais un freak, à me faire 4 films par jours et autant de reviews agrémentées d’une chronique quotidienne. Mais avant la projection des Proies, un journaliste chinois regardait des clips sur son téléphone, et avait à cœur de les faire partager à la cantonade puisqu’il n’avait pas de casque. C’était drôle d’entendre des chants mandarins, mais moins drôle que de le comprendre, apparemment, car il était mort de rire. Ce matin, le voisin devant moi a déplié son mac ¾ d’heure avant la projection d’In the Fade, et il a lancé un film. Un truc d’époque avec Tom Hardy et Jonathan Pryce. Ça m’a irrité parce que je ne savais pas ce que c’était mais rassuré parce je me suis dit que j’avais encore de la marge avant de basculer totalement du côté obscur.
Les séances du jour :
Aus dem Nichts (In The Fade)
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]a vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.
Fatih Akin pulvérise les repères de son héroïne et sonde les cendres : la première partie du film, juste et touchante, esquisse un portrait de femme prometteur, parce qu’il ne délaisse pas certaines zones d’ombre. La seconde qui fait intervenir la justice dans le drame intime, est probablement la plus réussie en terme de mise en scène et de jeu : les duels rhétoriques, le découpage, la confrontation au système dénué d’affect occasionne de belles séquences.
Mais ce n’est pas là la finalité d’Akin : soucieux de grossir le trait, il sombre dans un manichéisme pesant, oubliant tout ce qui pouvait faire la complexité de sa protagoniste, appuyant par des ressorts assez putassiers la compassion du spectateur, pour mieux faire vibrer à l’unisson les désirs de vengeance.
On taira le final totalement invraisemblable en terme d’écriture, et plutôt équivoque dans la morale qu’il propose.
Symbolique lourde, trajectoire cousue de fil blanc, ressorts scénaristiques mécaniques : Fatih Akin ne signe pas là son grand retour au cinéma.
Posoki (Directions)
(Un certain regard)
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]D[/mks_dropcap]irections est un road movie à travers la dystopie de la Bulgarie aujourd’hui, un pays qui reste optimiste, car tous les réalistes et pessimistes l’ont quitté.
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, le propriétaire d’une petite entreprise, qui fait le taxi pour joindre les deux bouts, découvre que le pot-de-vin qu’il aura à payer pour obtenir un prêt a doublé. Le conseil d’éthique qui a examiné sa plainte pour chantage demande maintenant sa part. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ce propriétaire tue le banquier et se suicide.
Cet incident suscite un débat national à la radio sur le désespoir qui règne dans la société civile. Entre-temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs passagers se déplacent dans la nuit, chacun dans l’espoir de trouver un chemin plus clair pour aller de l’avant.
Bien des passerelles peuvent être faites entre ce film et Une femme douce, du réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa : à travers des conversations mêlées, une radiographie désespérée de l’état des lieux d’un pays. A travers son dispositif de mise en scène, Stephan Komandarev pose de gros blocs en plan-séquence qui suivent différents chauffeurs de taxis et leurs interactions avec différents représentants de la société.
Certaines séquences sont justes, d’autres très émouvantes (notamment celle du sauvetage d’un suicidaire en haut d’un pont), et les points de liaisons assez bien amenés. Les coutures de ce systématisme apparaissent tout de même de temps à autre, et le film pêche par excès de longueur, d’autant plus éprouvantes qu’elles sont au service d’un discours au pessimisme généralisé.
Marlina la tueuse en 4 actes
(Quinzaine des Réalisateurs)
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]u cœur des collines reculées d’une île indonésienne, Marlina, une jeune veuve, vit seule. Un jour, surgit un gang venu pour l’attaquer, la violer et la dépouiller de son bétail. Pour se défendre, elle tue plusieurs de ces hommes, dont leur chef. Décidée à obtenir justice, elle s’engage dans un voyage vers sa propre émancipation. Mais le chemin est long, surtout quand un fantôme sans tête vous poursuit.
Petite pépite venue d’ailleurs, Marlina est autant un western qu’une fable féministe, une farce un peu gore qu’une errance onirique.
Son charme étrange provient notamment de la distance affichée entre sa tonalité, soulignée par une musique assez proche de Morricone, et l’extrême rigueur de sa mise en scène. La photographie est impeccable, magnifiant dans des plans d’ensembles majestueux des paysages dorés et montagneux. Les intérieurs, cadrés au cordeau, rappellent l’esthétique japonaise, tout en plans fixes et en découpage des espaces, laissant lentement naître des tableaux dans lesquels la tension s’installe immanquablement.
Portrait de femme vengeresse et résistante, c’est aussi l’occasion d’une satire acerbe sur tous les défauts du mâle dominant, lubrique, jaloux, brutal et stupide.
Doté d’un rythme unique, alternant entre une violence presque picturale et une contemplation poétique, Marlina est une perle aussi singulière que réjouissante.
[mks_button size= »large » title= »Retrouvez tout notre dossier Cannes 2017 ! » style= »squared » url= »http://chk1191.phpnet.org/tag/cannes-2017/ » target= »_blank » bg_color= »#f5d100″ txt_color= »#000000″ icon= » » icon_type= » » nofollow= »0″]