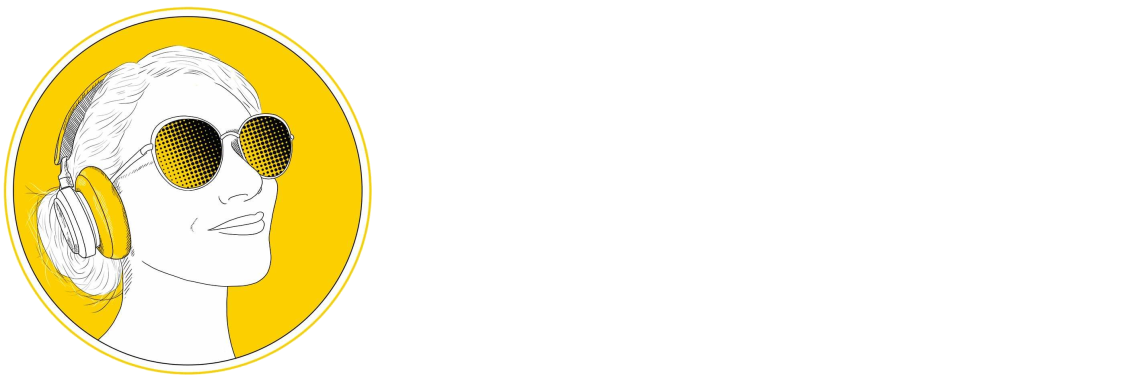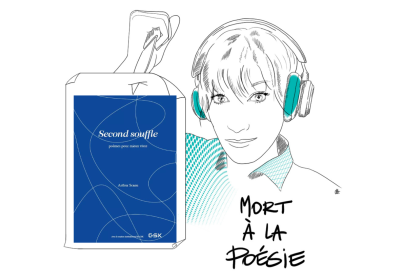Première partie
Pierre imaginait les Boches comme des fantômes, ou des vampires, ou les loups des histoires. Est-ce qu’ils pourraient le manger ? Ça lui faisait peur. Pierre a interrogé Julien, son grand frère, pour savoir s’il allait partir à la guerre, et Julien a dit qu’à seize ans il était bien trop jeune. Pierre a demandé pour leur papa. Ça, son grand frère n’en savait rien. Mais pour rassurer Pierre il a dit que leur père avait fait son devoir en 14 et qu’il y en aurait d’autres à y aller avant lui.
Samedi 26 octobre 1929, pendant que des banquiers américains se jetaient des fenêtres de leurs buildings, balancés du haut du ciel par la crainte de manquer, sa mère poussait sous les ordres de la matrone. Soi-disant que ça passait mieux pour le deuxième. Ou bien on lui avait menti, ou bien le temps lui avait fait oublier la douleur de la première naissance.
Il était finalement né. La matrone avait arrêté de gueuler. Le petit, un garçon, le deuxième donc, la mère avait décidé de l’appeler Pierre parce qu’elle trouvait ça beau. Elle avait dit au père que c’était pour rendre hommage à son travail de granitier, mais c’était faux.
Pierre. Dix ans dans moins de deux mois. La peur de se faire manger par les Boches. La peur qu’ils lui sucent le sang. La peur qu’ils tuent son père et son grand frère, la peur qu’ils lui volent ses jouets et qu’ils pendent ses lapins. La peur de la guerre. La peur. Un lundi. Le 3 septembre.
Et puis, la guerre. Le père ne part pas. Le grand frère non plus. L’attente.
Les gens qui arrivent de partout. Ils sont encore effrayés. Ils ont des accents qu’on n’avait jamais entendus. Ils mettent du temps à comprendre quand Pierre leur dit des mots comme coutiau ou piè. Sa mère finit par lui expliquer que ces mots qu’ils utilisent pour dire « couteau » ou « pluie » c’est du patois. Le patois de Plaintel, sa commune, par une ruse de la langue et une autre de la géographie, tout le monde ne le parle pas. Pierre demande jusqu’où on pourra le comprendre sans peine. Il ne veut pas passer pour un imbécile. Sa mère lui répond qu’elle ne sait pas exactement, jusque Saint-Brieuc c’est sûr, peut-être jusque Lannion. À Rennes, déjà, ce sera plus compliqué : là-bas, ils parlent aussi bien que les Parisiens.
Le discours du maréchal. Le père annonce à ses fils que la guerre est terminée. Il ajoute :
« Cette fois, ça n’a pas été la boucherie pendant quatre ans, on peut au moins admettre ça. Bien entendu, les jeunes de maintenant préfèrent l’amusement à la patrie. Le maréchal, que j’ai croisé une fois de loin pendant la Grande, a raison. Ce qui est à blâmer c’est notre manque de courage ! Notre refus du sacrifice. Parfaitement !
– Arrête donc de parler de la guerre devant les enfants, s’énerve la mère.
– Mais puisque je te dis qu’elle est finie la faillie guerre ! Dame bon Dieu, on ne peut jamais rien dire ici ! Et puis d’ailleurs ce sont les jeunes qu’ont sûrement raison. La Grande et les copains de la commune qui sont morts là-bas, sept rien que de la classe et des infirmes à la pelle, on aurait très bien pu s’en passer. »
La guerre est finie. Même pas un an. La raclée en quinze jours. T’en prends une comme ça à la belote, plus jamais tu touches un carton de ta vie.
Les soldats allemands arrivent. La mère leur trouve une élégance terrible avec leurs beaux uniformes propres et frais, leurs cheveux bien coupés. Rien à voir avec les prisonniers boches qui étaient venus au pays pour travailler en 14-18. Ils sont beaux les Allemands, elle ose dire à table. Le père manque de s’étrangler avec sa soupe, lève les yeux au ciel et ne répond rien puisque, quoi qu’il pense, il a tout juste le droit de se taire.
Pour Pierre, la grande côte à monter à pied jusque l’école et le maître, mauvais comme une teigne, franc comme un âne qui recule. Les coups de sabot en veux-tu en voilà et des volées de règle plus encore. Alors Pierre se tient tranquille, fait le fayot tant qu’il peut mais c’est difficile de ne pas rigoler quand Eugène fait péter ses aisselles. Des fous rires comme ça valent tous les coups de l’autre âne.
Eugène est un enfant de l’assistance, c’est le frère de lait de Pierre puisque la mère l’a nourri au sein, la première année de sa vie. Eugène appelle la mère de Pierre « sa petite maman de lait ». Il n’est pas le seul.
Le jeudi est le meilleur des jours. À onze heures, Pierre part sur le vélo de son frère. Il est trop grand pour lui. Les roues sont ovales, la bicyclette avance à l’amble. Pierre a l’allure d’un meneur de chameaux quand il est assis sur la selle. Il rejoint la carrière où, du lundi au samedi, le père vient arracher de la roche à la Terre. « Bien sûr qu’elle y tient à sa caillasse, la Terre », a coutume de dire le père. C’est pour ça qu’elle leur en fait autant voir. « La maudite ! »
La pierre c’est le granit. On l’appelle granit bleu, ou granit moucheté, mais Pierre lui trouve des accents gris. Une pierre si précieuse qu’on en envoie jusque Paris et même autrefois jusqu’en Amérique. Ça, Pierre a du mal à y croire. Il aurait fallu des bateaux gigantesques pour emporter des blocs de roche comme ceux-là. Ils auraient coulé à la première vague. Pierre pense que le patron du père doit être riche comme Crésus pour posséder un endroit d’où sort tant de bruit. « C’est un monsieur », a l’habitude de dire le père.
Le père s’appelle Léon. Léon Chandemerle. Léon est court comme un gamin. Léon est frisé comme une cocotte. Léon est fort comme trois hommes. Quand il revient de la carrière, il se plaint de son dos, de ses mains qui saignent, de ses yeux qui piquent. Et le lendemain il y retourne.
Pour Pierre, il n’y a rien de plus impressionnant que la carrière. Il n’y a rien de plus impressionnant que les gars qui en sortent. Et dire que son père en fait partie.
Pierre n’a qu’une hâte, en finir avec l’école et venir travailler, son père dit « lutter », à la carrière. Les collègues granitiers de Léon appellent Pierre « petit », « gamin » ou « mignon », selon qu’il est ou non au bon endroit, au bon moment, selon qu’il gêne le passage ou qu’on a un service à lui demander.
Chaque jeudi, c’est le même repas. Dans le carnier qui servait avant-guerre, le dimanche, du temps où on avait le droit de chasser, la mère a mis un petit morceau de pain de trois livres, du pâté de lapin, une omelette à deux œufs encore tiède et un litron de cidre. Parfois un fruit, quand la saison s’y prête et que les oiseaux n’ont pas tout gâté, mais ce n’est pas souvent.
Pierre observe le père et les autres qui déjeunent à même le sol. Ils parlent du boulot abattu. Ils parlent du boulot qu’on abat. Ils parlent du boulot à abattre. Ils parlent de la scie « crocodile » dont Pierre avait la frousse petit à cause d’un album illustré sur l’Afrique.
La moustache du père est couverte de poussière. Le père appelle ça « la transpiration de la Terre » : « Il faut bien qu’elle sue comme nous. » Le cidre, qu’il boit au goulot, lui fait un grand rond orange comme s’il avait du rouge à lèvres. On dirait la mère quand elle s’apprête pour les baptêmes et les fiançailles. Il n’y en a plus guère depuis l’arrivée des Allemands.
Ce qui lui manque le plus, à la mère, ce sont les mariages. Beaucoup de ceux en âge de se marier sont prisonniers en Allemagne, c’est mal commode pour se rendre à l’autel. Et ça ôte l’envie aux autres. Qui oserait prendre du bon temps alors qu’il y a tant de malheureux ?
Pourtant qu’elle aimait ça, la mère : les belles noces, les vêtements de fête, les fines dentelles et les jolies coiffes.
En 37, le mariage du fils Poulain, le neveu d’un conseiller municipal, avait réuni plus de deux mille personnes. Un cortège sans fin. Trois jours à danser et à rire. La commune au complet assise là, sur les bords de deux grands sillons creusés dans le champ du père Latimier. Chacun avait apporté ses couverts les plus précieux pour l’occasion, certains en argent véritable. Il y avait des bouteilles de cidre à se demander où on avait dégoté tout ce verre. Quelle joie. Mon Dieu ! Quelle joie. Et les Allemands qui avaient mis fin à tout ça pour enrichir les marchands de canons, pour donner du tourment à tout le monde.
Après le déjeuner, Pierre joue avec Eugène dans les chemins, derrière la ferme abandonnée de la mère Sagorin. Eugène n’a pas son pareil pour faire voltiger les osselets et les rattraper d’une main. Pierre enrage de ne pas être capable d’en faire autant, mais il est le meilleur à la toupie.
Quand le cœur leur en dit, Pierre et Eugène remontent toute la Côte-aux-Mines. Ils traversent le lieu-dit Sébastopol. Ils poussent jusqu’au bourg tout proche pour rejoindre des camarades et jouer jusqu’à ce que la nuit leur ordonne de rentrer.
Quand une voiture allemande passe, tout s’arrête. Le silence est plus grand encore que lorsque l’instituteur se promène entre les rangs de la classe. Les mères ont prévenu qu’il ne faut pas regarder les Allemands.
Sans qu’ils en aient conscience, leurs jeux changent. Leurs osselets s’envolent pour la dernière fois en novembre 1940. Ils n’entendent plus le bruit des billes depuis la fin de l’année scolaire 1941 et ils s’arrêtent de jouer à chat en décembre 1942. Le 13. C’est un dimanche à la sortie de la messe. Quelques heures avant, Pierre et Eugène, qui sont enfants de chœur, ont eu confirmation que la bonne couchait avec le curé.
« Et comment que vous le savez ? demandent les copains, en cercle, impatients de connaître l’histoire.
– Dimanche dernier, on a caché le tisonnier dans le lit de la bonne, affirme Pierre.
– Et tout à l’heure elle est venue nous trouver dans la sacristie pour savoir où il est ! ajoute Eugène.
– On a juré sur nos têtes qu’on l’avait pas vu, elle ne nous a crus qu’à moitié, mais ça nous a sauvé les miches…
– Et alors ? demande Petit Yvic.
– Alors, pauvre pomme, elle n’a pas dormi dans son lit de la semaine sinon elle aurait trouvé la ferraille et elle a sûrement pas dormi sur les carreaux de ciment ! Le curé a dû lui trouver une place dans son pieu à lui ! »
Telle est la vie de ces petits garçons.
Trois mois plus tard, ça gueule dans la maison. Le père et le grand frère sont prêts à en venir aux mains. La mère pleure, elle les supplie d’arrêter. Ils viennent d’apprendre que Julien doit partir travailler en Allemagne. Ce n’est pas une surprise mais tous espéraient que le moment viendrait plus tard, peut-être même que la guerre serait finie avant.
« Comment veux-tu que j’y coupe ? Je te le demande. Comment veux-tu que j’y coupe !?
– Quand on veut, il y a toujours un moyen. On le cherche, et puis on le trouve !
– T’y as coupé peut-être, toi, en 14 ? T’as fait comme tout le monde, t’es parti avec le troupeau, des obus au-dessus de la tête, de la flotte sous les pieds pendant quatre ans.
– Sauf que moi c’était mon d’voir ! J’avais pas à y couper !
– Eh bien moi aussi c’est mon devoir ! Puisqu’on me dit de le faire, je le fais.
– Ton devoir ?! Dame bon Dieu, une honte d’entendre ça. Une honte ! Bon Dieu.
– Ne jure pas, Léon !
– Ma pauvre femme, je préfère jurer mille fois que d’entendre ça ! Aller travailler pour les Boches, et ce serait son devoir ?! Ah ça me ferait mal de voir mon gars, mon aîné par-dessus le marché, partir chez les Boches parce que c’est son devoir. J’aimerais mieux le voir mort !
– Oh ! Mais comment oses-tu ? Tu dis n’importe quoi, mon pauvre Léon. C’est toi qui devrais avoir honte. Tais-toi donc !
– Bon Dieu de bonne femme ! Merde à la fin. Tu m’entends ? Merde ! Tu veux savoir si je préfère le voir mort ? Eh bien oui, je préfère le voir mort ! S’il faut, c’est moi qui lui donnerai le coup de fusil ! Et en face que je le ferai. Tu peux tout de suite aller chercher les gendarmes et qu’on me coupe la tête. Ah ça, je le jure aussi, tiens !
– Pourquoi que tu veux partir, mon Julien ? On peut aller voir le docteur. Il te trouvera bien un souffle au cœur, quelque chose pour retarder l’appel. Qu’en penses-tu, si on allait trouver le docteur ?
– Un souffle au cœur ? Maman, tout le monde sait que je suis un des gars les plus forts de Plaintel…
– C’est moi qui vais lui faire le souffle au cœur ! Y’aura pas besoin du docteur pour signer les papiers.
– Mais tais-toi donc ! Tais-toi !
– Il a raison, maman. Pas besoin du docteur. On va trouver une solution pour retarder l’appel. Je vais me faire casser un bras ou une jambe.
– Tu vas tout de même pas te faire du mal comme ça. Et puis, qui va te les casser ?
– Je trouverai bien un copain.
– Si ça se sait, tu iras en prison.
– J’ai le choix entre l’Allemagne, la prison, et les cartouches de papa…
– Il a qu’à se cacher !
– Où tu veux qu’il se cache ? Et puis combien de temps que ça va durer cette affaire ? Les gendarmes vont le chercher, s’ils ne le trouvent pas c’est nous qu’ils vont prendre.
– Les autres se cachent bien, eux. Pourquoi qu’il n’y arriverait pas ?
– Et où je pourrais aller, puisque t’es si fort ?
– Tu vas dans les fermes ou dans les bois, comme les autres.
– Comme les autres, comme les autres ! C’est facile à dire, c’est pas toi qui en seras.
– J’ai déjà donné, mon gars. J’aurais voulu te voir dans les boyaux, les mitrailleuses, tac à tac à tac, les…
– Oh, tu nous emmerdes avec tes histoires de poilus ! Tu comprends ? Tu nous emmerdes ! »
C’est la première fois que Julien ose parler ainsi à son père et remettre en cause son passé. Celui dont il est si fier, lui qui n’a jamais manqué une cérémonie d’anciens combattants, lui qui n’a jamais oublié de se découvrir en passant devant le monument aux morts, lui qui rêve encore la nuit des poux et de l’odeur de la mitraille. Léon, d’abord abasourdi par l’audace de son fils qu’il prend pour de la méchanceté, explose.
« Va-t’en de chez moi, fumier ! Va lécher le cul des Boches ! Mais vas-y donc ! Fous le camp, fumier ! Fous l’camp, ou je le jure, je te tue !
– Oh et arrête de gueuler, je m’en vais ! »
Julien embrasse sa mère et fait un signe à Pierre qui n’a pas osé descendre l’escalier. Il dit, audacieux : « Salut la compagnie » et, pour faire enrager son père, laisse la porte ouverte.
Il repasse le lendemain chercher ses affaires alors que Léon est au travail. Julien explique à sa mère qu’il va se cacher comme a dit son père. Il en a parlé avec François, le fils Cadiou, qui doit partir en Allemagne lui aussi. Il a une grande cousine qui pourra les héberger quelque temps. Elle est loin, à plus de cinquante kilomètres. Avant que les gendarmes ne s’embêtent à venir les chercher là-bas, la guerre sera finie depuis longtemps. Julien promet d’écrire dès que possible mais ce sera peut-être difficile. Il faudra aller demander des nouvelles à la mère Cadiou et lui en donner aussi.
« J’ai le cœur gros, et pardon à papa, je ne voulais pas lui faire de peine ni être grossier.
– Tu sais, papa s’en veut aussi. La guerre rend tout le monde fou. Promets-moi de ne pas traîner avec les maquisards, c’est tout ce que je te demande, ils sont fous eux aussi, ils ne sont bons qu’à faire tuer des otages. »
Julien enfourche son vélo, son barda sur le dos. Il s’éloigne, tourne à droite en direction du bourg. Pierre ne le voit plus. Le jeudi, Pierre ne pourra plus aller apporter le déjeuner à son père. À pied, la carrière est trop loin.
Les mois passent. Pas une nouvelle. Malgré son absence, c’est comme si Julien n’avait jamais été aussi présent. Il ne quitte pas les pensées de sa mère, de son père et de Pierre. « Où est-il ? Si on l’avait pris, on l’aurait su, ne crois-tu pas ? J’espère qu’il mange à sa faim. »
Tous les soirs, Pierre prie le petit Jésus pour que son frère aille bien.
Pierre, Eugène, les copains ont un semblant de moustache qui leur pousse. Même Yvic commence à avoir du poil aux pattes, pas beaucoup, mais quand même. Il paraît que les Allemands vont de défaite en défaite, que tout va mal à l’est et que les Anglais vont retenter un coup quelque part comme ils l’avaient fait à Dieppe. Cette fois ça va passer. Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu de soldats dans le bourg, on dit que la plupart se trouvent à Saint-Brieuc et au bord de la mer pour empêcher un débarquement.
Pourtant la tension ne cesse de monter, quelque chose va se passer. Quelque chose de décisif.
Ceux qu’on ne voit plus beaucoup non plus, ce sont les jeunes. Ils sont en Allemagne ou cachés dans les bois. Le patron du père a dissimulé une radio dans son bureau pour écouter les nouvelles. Il sait que si les Anglais et les Américains arrivent jusqu’à Plaintel on risque de lui reprocher la caillasse vendue aux Allemands pour le mur de l’Atlantique. Alors il fait donner par sa femme du ravitaillement et un peu de sous, dès qu’il peut, aux gars des maquis. Et il fait en sorte que ça se sache.
Il y a un mort. Un soldat allemand abattu d’une balle derrière l’oreille dans un fossé sur la route de Saint-Brandan. Le 21 janvier 1944. Du sang sur le givre de l’hiver. Pierre vient voir le mort. Il y a au moins cent personnes autour du corps. C’est l’attraction.
Les Boches deviennent fous, les représailles suivent : huit otages sont fusillés près de Rennes, six maisons sont incendiées et la forêt de Lorge est bombardée à l’aveuglette, dans le but de taper sur les résistants.
Pendant des jours, les soldats passent à toute vitesse, mitraillettes aux portières, à travers les bourgs pour semer la panique, manquerait plus qu’ils rasent les clochers comme ont fait les dragons du roi dans le temps. Les jeunes ne sortent plus des bois, les vieux n’osent plus mettre le nez dehors.
Alors qu’ils marchent sur le bord de la route pour aller relever un collet, Pierre et Eugène sont arrêtés par des soldats. On les emmène à la gendarmerie de Quintin pour les interroger. On fait sortir les gendarmes. Pierre et Eugène ne disent pas un mot, le verbe coupé par la peur. Les yeux tout écarquillés.
Et voilà que les Allemands leur crient dessus. « Il faut avouer ! Avouer ! Qui a tué le soldat ? » Il faut dire puisqu’ils savent, puisqu’ils aident les terroristes, on le sait qu’ils les aident, les terroristes cachés dans les bois. On va les fusiller, ils sont morts, comme les otages de Rennes. Ils ont entendu parler des otages de Rennes ? Eh bien ce sera la même chose. Eux aussi. Eins, zwei, drei. Feu. Morts. Qu’ils avouent ou non. Mais on va aussi tuer leurs parents s’ils n’avouent pas. Eins, zwei, drei. Feu. « Qui a tué le soldat ? Qui ? » Et une grande gifle. « Qui ? » Et des mots encore plus forts, incompréhensibles et terribles. Comme ceux qu’on crie aux fauves dans les cirques et que Pierre a entendus une fois quand il avait sept ans. Des animaux dans une cage. « Qui ? » Ils ne savent pas ? Alors on tuera tout le monde. Eins, zwei, drei. Feu. Les pères et les mères. Eins, zwei, drei. Feu. Les frères et les sœurs. Par leur faute, car ils ne veulent pas avouer. Les larmes ? Bien fait les larmes. « Enfants de salauds. » Et le pistolet sorti, collé sur la tempe d’Eugène, le clic et Eugène qui se fait dessus. L’odeur à vomir. Les gamins, de leur voix de bébé, crient fort comme des adultes : « Mais arrêtez ! Arrêtez ! » Des larmes, des cris. « Arrêtez ! Arrêtez ! – Où se cachent les terroristes ? » Ça au moins ils savent ? Tout le monde sait. Dans quel bois, dans quelle ferme ? « Ils sont où, les terroristes ? Répondez ! Bâtards. » Bons qu’à se chier dessus. « Allez dégagez ! Mais dégagez ! » Deux grands coups de poing sur la nuque.
Dehors il fait froid et il fait nuit. La merde coule le long des jambes d’Eugène. Il frotte ses affaires avec de l’herbe gelée. Honteux. Il faut rentrer, six kilomètres à pied. Le bruit des sabots sur les chemins, les nids-de-poule qui font des crocs-en-jambe.
Morts les osselets qui s’envolent, mortes les billes, les astuces à la bonne du curé. Mort Petit Yvic qui rigole.
Eugène s’effondre dans les bras de sa petite maman de lait. Il a la tête contre ses seins comme quand il avait six mois. Pierre qui parle. Pierre qui raconte. Le collet, les gendarmes qui s’en vont, les cris en allemand, le pistolet sur la tempe d’Eugène. Le clic. Les coups.
Le père écoute.
« Salauds de Boches ! »
La mère va laver les vêtements d’Eugène, il ne faut pas qu’il se fasse de mauvais sang. Elle dit à Pierre de lui prêter une tenue. Elle ajoute : « La belle, celle du dimanche. »
La mère va raccompagner Eugène. Elle expliquera tout, il ne faut plus s’inquiéter. Les Allemands ont voulu leur faire peur, ils ont réussi mais c’est fini, il ne se passera plus rien.
Le père s’en va chez Mathurin Courcoux, le maire, raconter toute l’histoire. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Déposer une plainte ? Pourquoi pas, mais ce sera compliqué. Mieux vaut se taire. Le maire sait de source sûre que la fin de la guerre est pour bientôt, que les Alliés pourraient débarquer plus vite qu’on croit, que le mieux est de se faire discret.
Le maire demande si on a des nouvelles de Julien. Léon n’en a pas. Il en aurait, il préférerait se taire. À qui se fier ? À personne.
Des Histoires pour Cent Ans de Grégory Nicolas
Éditions Rue des Promenades – 13 mars 2018