Depuis la crise des subprimes et, quelques années plus tard, sa mise en faillite, la ville de Detroit (Michigan) est l’objet à la fois de toutes les peurs, mais aussi de tous les fantasmes. Une ville dans tout ce qu’elle a de plus américain : des plus grandes industries automobiles (General Motors, Chrystler) à l’effervescence culturelle (Motown, The Stooges, The White Stripes, Sixto Rodriguez, pour ne citer que les noms les plus connus), elle est dynamique, prospère et à l’image de ses grandes sœurs plus célèbres. Dès le mitan du Xxème siècle, on y observe pourtant un déclin, qui semble toucher son apothéose en ce début de Xxième siècle : beaucoup de bâtiments sont à l’abandon, le chômage explose, l’industrie s’effondre… la ville devient fantômatique. Nous pouvons citer un film, parmi d’autres, qui reflète l’état d’abandon de cette ville sous un angle horrifique et merveilleux : Only Lovers left alive, de Jim Jarmush. En cette rentrée littéraire, deux auteurs français se sont penchés sur cette cité en ruine, annonçant peut-être le déclin de la civilisation capitaliste telle que nous la connaissons.
Alexandre Friederich, déjà l’auteur du remarqué easyJet, est allé à la rencontre des habitants et s’est laissé happé par la cité. À cheval entre récit de voyage et reportage documentaire, il décrit le quotidien d’hommes et femmes qu’on pourrait croire survivants d’une catastrophe ou d’une guerre alors qu’ils n’ont fait que rester dans une ville qu’ils habitent depuis des générations parfois. Rester par contrainte ou parfois par choix. Friederich dort chez l’habitant, ou ce qui fait plus ou moins office de chambre d’hôte collée à la John C. Lodge Freeway, « huit pistes d’autoroute à quelques mètre de [son] lit. Cent vingt mille voitures y circulent chaque jour ». Alternant rappels historiques et paroles d’habitant, l’auteur dresse une cartographie aussi funeste que joyeuse d’une ville où le do it yourself est de rigueur, laissant alors la possibilité à nombre d’habitants de mener leur vie comme bon leur semble, si tant est qu’ils ne soient pas trop exigeants. Fascinant, parfois glauque, souvent drôle, le récit est truffé d’odeurs, de bruits, de visions qui collent à la rétine et nous happent totalement. L’auteur, qui n’a pas froid aux yeux et veut en voir un maximum n’est pas toujours invité à le faire et nous fait penser parfois à la figure clownesque d’Antoine de Maximy dans son émission J’irai dormir chez vous, le sentiment de parfois déranger, de faire tâche dans le décor, surtout quand on est « coiffé, douché, disponible, pas saoul, du moins dans la journée, et blanc ». L’écriture limpide mais parfois fantasmatique de Friederich nous envoûte totalement et nous rend comme hébété voire zombifié à certains moments, jusqu’à cette scène d’une immense beauté où il se rend dans « la plus grande librairie d’occasion du monde », lieu borgésien par excellence, où le monde entier semble entrer en résonance avec lui et lui faire tourner de l’œil, plongeant son lecteur dans un état de sidération dont il se rappellera. Un livre comme un rêve à la beauté diaphane, prophétique, crépusculaire, donc magnifique.
Thomas B. Reverdy aussi a décidé de situer son nouveau livre, Il était une ville, à Detroit. La ville devenant alors le décor d’une fiction où s’entremêlent plusieurs intrigues et personnages dont un Français travaillant dans l’industrie automobile arrivant à Detroit pour redresser la barre de son entreprise et lancer un nouveau projet novateur. Eugène arrive à Detroit quelques semaines avant la faillite de Lehman Brothers qui accélérera le déclin bien entamé de la ville. En parallèle, l’entreprise qui l’a envoyé sur place se désintéresse de plus en plus du projet, ne donne plus de nouvelles et semble l’abandonner. Reverdy s’aventure à raconter la condition d’expatriés, le taylorisme, les dérèglements financiers et hiérarchiques qui touchent l’industrie, laissant son personnage comme ahuri devant ce qui lui arrive, et incapable de trouver une porte de sortie, obsédé par sa réussite professionnelle et par la serveuse du bar qu’il a rencontrée. En parallèle, nous suivons le quotidien, plus intéressant, d’une bande de gamins paumés, errants, cherchant à s’occuper coûte que coûte, souvent en faisant les quatre cents coups, jusqu’à ce que certains soient amenés à disparaître. Reverdy tisse alors, tardivement, une intrigue policière autour de ses enfants qui « s’évaporent », rejouant la partition de son précédent roman, Les évaporés, situé au Japon et s’intéressant à cette tradition qui consiste légalement et sans que personne ne vous recherche à disparaître. À la différence qu’aux États-Unis, quelqu’un qui disparaît – et en l’occurrence des enfants – donne lieu à une enquête menée, je vous le donne en mille, par un enquêteur alcoolique. Il est évident que Reverdy est fasciné par le destin de Detroit, sa géométrie et son état de délabrement, et il nous arrive souvent d’être touchés par certaines réflexions et observations sur cette ruine monumentale (« Traverser la ville me donne toujours l’impression de regarder un porno. Tu sais, une fascination coupable »), mais à vouloir faire un roman social à la française et un roman américain, il fait perdre de sa substance au portrait de ville qu’il semblait avoir l’intention d’écrire, et par la même occasion oublie son lecteur sur le bord de l’autoroute.
Alexandre Friederich, Fordetroit, Allia.
Thomas B. Reverdy, Il était une ville, Flammarion.



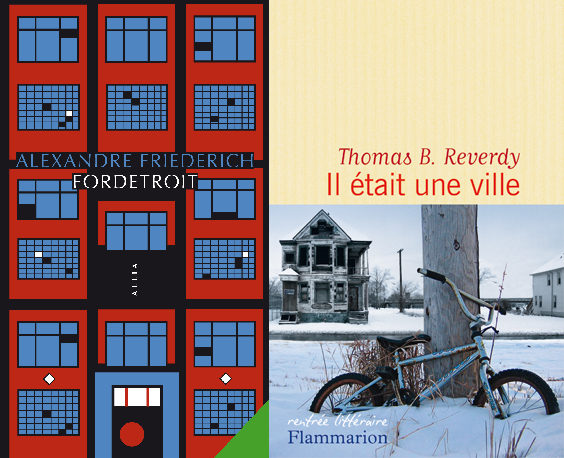
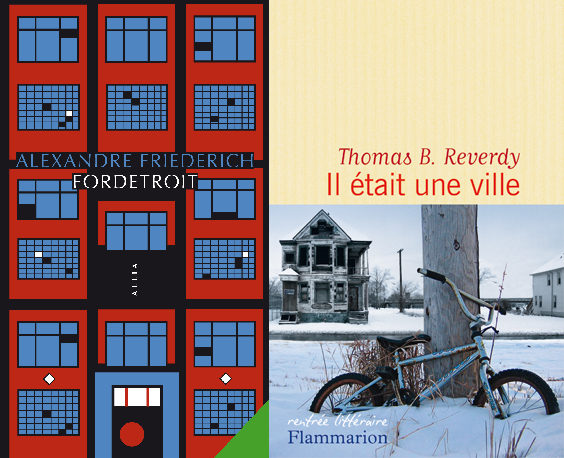















Toujours dans les nouvelles sorties, on peut commencer par la lecture d’ Une si parfaites épouses de Lori Roy qui parle de Détroit de 1958 et finir par Les Monstres / Lauren Beukes.