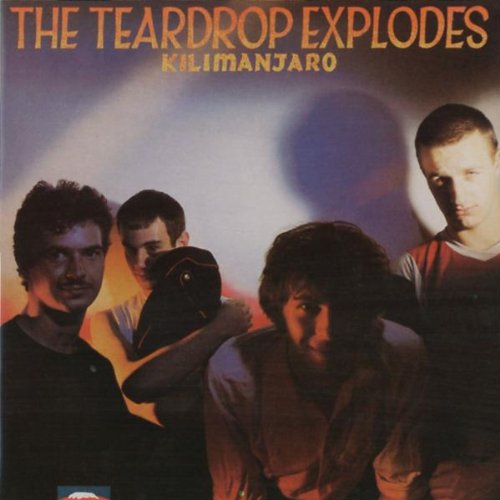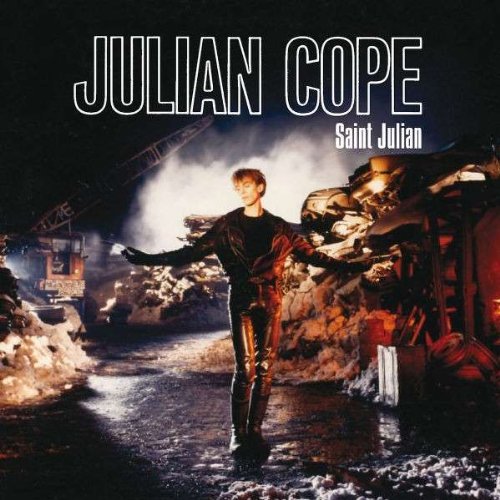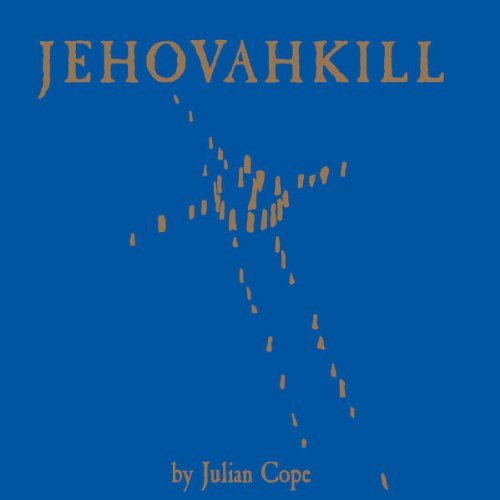L’Addict Team prend quelques jours de vacances (on revient vers le 12 novembre, promis) et comme on sait qu’on va vous manquer, on a décidé de vous emmener avec nous sur notre lieu de villégiature entre Le Pays de Galles et Liverpool, en passant par le Kilimanjaro.
En effet, Julian Cope, génial doux dingue, nous servira de guide touristique au gré de quelques chroniques de ses meilleurs albums par la crème de la crème d’Addict Culture ainsi que votre humble serviteur.
Kilimanjaro (1980), par Beachboy
Julian Cope est né en 1957 au Pays de Galles, grandit à Tamworth avant de poursuivre ses études à Liverpool. C’est là, dans le berceau de la pop anglaise, qu’il commença sa carrière musicale avec des groupes vite formés, vite séparés et en particulier Crucial Three (le musicien de Liverpool est peu modeste, cela va de soi) avec Pete Wylie (The Mighty Wah) et Ian McCulloch, son meilleur ennemi, tout aussi doué que grande gueule. Leurs diverses séparations et engueulades feront par la suite le bonheur de la presse anglaise. Après l’avoir viré une dernière fois d’A Shallow Madness, Julian Cope verra le beau Ian créer Echo & The Bunnymen.
Julian Cope quant à lui forma The Teardrop Explodes en 1978, en compagnie du guitariste Mick Finckler, du batteur Gary Dwyer et de Paul Simpson aux claviers. Leur carrière fut courte mais intense avec Kilimanjaro un premier coup de maitre et puis Wilder, un premier coup de folie.
Kilimanjaro (le musicien de Liverpool…) sort en 1980 chez Mercury (je vous encourage vivement à vous procurer la version Deluxe sortie en 2010 avec un tas de bonnes choses entre singles indispensables et Peel Sessions) et rencontre un joli succès dans les charts anglais. Julian Cope a déjà cette voix ample et puissante et se moque déjà des styles et modes du moment mélangeant allégrement New Wave, Post Punk et Psychédelisme.
L’album commence en fanfare avec 5 bijoux pour une face A de folie : Ha Ha I’m Drowing, Sleeping Gas, Treason ma préférée, Second Head et Poppies In The Field. La basse tenue par Julian Cope est énorme, ça bondit, ça rebondit dans une folle danse de St Guy, Guy Dwyer n’étant pas en reste derrière ses fûts méchamment maltraités.
La face B ralentit à peine le tempo et se fait un peu plus expérimentale, Syd Barrett fricote avec Gang Of Four, Roky Erickson reprend Wire et inversement, les cuivres de Dexys Midnight Runners percutent l’orgue des Doors pour une géniale partouze psychédélique. Certes, la production très années 80 a pris quelques rides et la pochette originale est absolument affreuse mais l’album reste fantastique 35 ans plus tard. et se doit de figurer dans toute bonne discothèque qui se respecte.
La version Deluxe de Kilimanjaro est en écoute intégrale ici.
Fried (1984), par French Godgiven
La suite pour Julian Cope ? Après un deuxième album (Wilder) en groupe, bien plus sombre que ne l’était le premier, et sur lequel il aura largement pris le contrôle, et le lancement d’un hypothétique troisième se terminant en eau de boudin, les Teardrop explosent pour de bon : trop d’égos, trop d’embrouilles (voire de bagarres), trop de courses de buggys sous acides. Son premier album solo, World Shut Your Mouth, sortira au début de l’année 1984, et ne tiendra malheureusement pas toutes ses promesses : si le néo-psychédélisme est toujours bien présent et provoque quelques réussites éparses, le disque est trop peu cohérent et expédié pour convaincre complètement. Ce qui ne sera pas le cas du suivant, qui sortira à peine six mois plus tard : si la réputation d’allumé notoire de Cope n’est plus à faire (le bonhomme semblant décidément suivre la même pente que ses marottes Syd Barrett ou Roky Erickson, mentors en bout de courses des Pink Floyd ou des 13th Floor Elevators), l’album Fried (grillé, cramé) affiche paradoxalement une grande forme sur le plan artistique.

Produit comme son prédécesseur par Steve Lovell, il intègre pour la première fois un nouveau venu dans l’entourage de Julian Cope : le guitariste Donald Ross Skinner, qui partagera ses aventures pendant toute la décennie à venir. Chaque titre du disque renferme en lui-même un monde fascinant : de l’abrasif Reynard The Fox d’ouverture (avec son riff tellurique et son break shamanique) au scintillant Sunspots (seul single extrait, tube en puissance drivé par une mélodie imparable, mais à l’arrivée bide total), de la langoureuse complainte Laughing Boy (du post-rock avec vingt ans d’avance, Julian Cope se rendant compte au mixage final qu’il avait purement et simplement « oublié » d’écrire une ligne de basse pour la chanson) à la prière saccadée et obsédante de O King Of Chaos (conduite par un piano martelé), de l’introspectif et spectral Me Singing à la perfection pop du très XTC Holy Love, rien ici ne laisse penser que le chanteur a perdu le contrôle de quoi que ce soit dans la maîtrise de son art en général ou de sa musique en particulier.
Alors certes, l’image très forte de cette pochette montrant un homme visiblement affaibli, engoncé dans une carapace de tortue, bloquant sur un camion-jouet dans un paysage apocalyptique, l’aura enfoncé un peu plus dans cette aura de gourou post-punk teinté d’un psychédélisme déluré et bariolé. S’il était allé plus loin sur cette route dans la foulée, nul doute que le bonhomme aurait brulé ses ailes au soleil implacable de sa propre originalité. Mais voilà aussi toute sa force : à chaque fois que cela lui pendait au nez, Julian Cope se sera arrêté à la dernière limite, comme un éclaireur qui, parvenu bien plus loin qu’il n’aurait dû, prend le temps de savourer sa position avancée tout en se rappelant au bon souvenir du monde connu.
Pour un temps tout du moins.
La réédition de Fried, sortie en 1996, est en écoute intégrale ici.
Saint Julian (1987), par Davcom
Le contexte : Julian Cope venait de nous laisser un chef-d’oeuvre intitulé Fried. Chef-d’oeuvre qui était tout sauf rassurant (il n’y a qu’à regarder la pochette), sous haute influence LSD. Tout le monde le croyait fou, et le monde n’était probablement pas loin de la vérité. Automutilation avec son micro lors d’un concert à l’Hammersmith Odeon, persuadé qu’il fut un temps une tour d’habitat… Bref, il était allé un peu trop loin dans la défonce.
On le retrouve une trentaine de mois plus tard. Changement de label. Bye bye Mercury – Fontana, bonjour Island. Le changement est radical. Comparé à la noirceur toute relative du précédent, Saint Julian est presque solaire. Un disque pour les (petites) foules avec des (petits) hit singles dedans. Les années MTV étaient nées et tout le monde cherchait un peu son eldorado, quitte à se prostituer un minimum afin d’atteindre les étoiles.
Et quelque part, ce Saint Julian est bien dans la lignée, un brin malade certes, de l’état d’esprit de ce qu’on appelait alors aux Etats-Unis – Julian Cope étant pour rappel Gallois – le college rock. Gros refrains, grosse batterie, gros arrangements. ça claque, ça blinque, mais ça marche. Il tient là ses premiers minis succès commerciaux avec Trampolene et surtout World Shut Your Mouth. A vrai dire, ce ne sont pas les titres efficaces qui manquent sur ce disque. Il y a le formidable Spacehopper, rock’n’roll en diable, Planet Ride et sa batterie synthétique maousse, sa basse slappée et ses choeurs so eighties, Shot Down et sa cavalcade de claviers et la pédale flanger sur la guitare. Mais la véritable apothéose, LE grand morceau de cet album, c’est A Crack In The Clouds, le morceau qui donne le clap de fin, lugubre à souhait, qui vous transperce mélodiquement et vous achève à coups de claviers grandiloquents.
Alors bien sûr, la production n’a pas forcément bien vieilli, comme beaucoup de disques de ces années-là. Il n’empêche que ça reste un album très intéressant, d’autant plus que Julian Cope revenait de très loin, et que les compositions tiennent toujours bien la route pour la plupart. Universal ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’une réédition a vu le jour en 2013 sous forme d’un double CD comprenant moult inédits et autres remixes.
La version Deluxe de Saint Julian est en écoute intégrale ici.
My Nation Underground (1988), Skellington (1989) et Droolian (1990), par French Godgiven
Ce succès improbable sur le papier, compte tenu des antécédents du bonhomme, le poussera à sortir trop vite l’album suivant, le très inégal My Nation Underground, qui pâtira sévèrement d’un manque de cohésion, d’un trop petit nombre de morceaux dignes de ce nom (malgré l’inclusion, pour la première fois, de reprises au programme) et, surtout, d’une démotivation de son auteur, qui avouera avoir réalisé là son pire disque.
En réaction à la pression croissante d’Island, Cope s’enfermera alors avec le fidèle Donald Ross Skinner et le percussionniste Rooster Cosby, pour enregistrer vite fait bien fait le rugueux Skellington, qui sera rejeté par le label, effrayé par des chansons aussi flippées et acides que l’explicite Out Of My Mind On Dope And Speed ou le carrément barré Little Donkey, sur lequel notre héros fait littéralement l’âne, tel les pauvres gamins trop gourmands du célèbre Pinocchio.
Qu’à celà ne tienne, Julian Cope montera sa propre structure pour sortir la chose, et, pris au jeu, se fendra début 1990 d’un autre album encore plus expérimental, le facétieux Droolian, dont les bénéfices iront à son idole de toujours, le vieux routard Roky Erickson, alors en bisbille avec la justice américaine, et incapable de s’offrir une défense correcte.
Ces deux disques, peu faciles d’accès mais nettement plus inspirés que l’on pouvait s’y attendre, permettront surtout au gallois de retrouver sa voix et son identité de rocker psyché cinglé, avant qu’il ne s’attaque, à l’aube de la décennie, à des projets nettement plus ambitieux.
Peggy Suicide (1991), par Davcom
2015. On le sait, l’enjeu écologique est une lutte à mort entre les différents lobbyistes fabriquant un pognon indécent sur le dos de notre bonne vieille planète d’une part, et les diverses associations écologiques d’autre-part, avec au milieu un monde politique semblant incapable d’agir de manière indépendante.
Il y aura bientôt 25 ans, en 1991 très exactement, Julian Cope avait tenté l’essai gagnant d’une représentation pessimiste de l’humanité via le prisme de ses travers écologiques, mais pas que. Cet album : Peggy Suicide, considéré par beaucoup comme étant l’essai le plus abouti de son auteur, tout du moins se disputant le titre avec Fried, autre pierre angulaire de la discographie du doux-dingue Gallois. Peggy Suicide est divisé en 4 phases, toutes numérotées de 1 à 4.
L’album débute par un titre à l’ambiance morne, lourde, sourde et inquiétante, Pristeen, qui se veut une métaphore relationnelle entre l’humain et la terre, sorte de femme idéale dans l’esprit mais où la dominante religieuse et la pensée unique viendraient tout mettre à sac. Double Vegetation traite des différents amalgames qui amène le rejet de l’autre à cause de l’ignorance humaine, de la haine irrationnelle ou encore du racisme primaire. East Easy Rider, si elle est plus légère dans la forme, est toute aussi lourde de sens dans la fond. Le plaisir de conduire ? Oui, mais à quel prix ? Promised Land, aborde le sujet de la fragmentation économique et sociale anglaise tandis que Hanging Out & Hung Up On The Line clôture la première phase avec un rock garage endiablé.
La deuxième phase débute par un morceau d’anthologie aux paroles effrayantes traitant du HIV à travers des paroles glaçantes sur fond de guitares psychédéliques. « You Don’t Have To Be Afraid Love, ‘Cause I’m A Safesurfer Darling ». L’insouciance et les fastes des années 80 sont bel et bien terminés. Drive She Said traite de la pollution automobile et ferme la deuxième phase. La troisième phase s’ouvre par Soldier Blue et se clôt par Leperskin, deux diatribes anti-Poll Tax instaurée par Margaret Thatcher, qui faillit provoquer une émeute à Trafalgar Square en 1991 et qui contribua à faire tomber son gouvernement. La quatrième et dernière phase de l’album est une phase plus expérimentale, à l’exception de Beautiful Love qui sera édité en single ainsi que du dernier morceau de l’album, Las Vegas Basement, qui peut être considéré comme une belle introduction à l’album qui suivra, Jehovahkill.
Musicalement, cet album est un brassage de genres, alternant entre rock garage, rock psyché, folk psyché, avec parfois un gros son, très produit. Après tout nous sortons tout juste des années 80. Une bonne dose d’expérimentation sous influences est de mise, et si on excepte quelques tics de productions propres à l’époque, cet album n’a pas pris une ride et reste très pertinent aujourd’hui. Son titre honorifique de meilleur album (ou de deuxième meilleur album, on va pas se disputer pour si peu) n’est donc pas usurpé.
La version Deluxe de Peggy Suicide est en écoute intégrale ici.
Jehovakill (1992), par Jism
S’il y a bien une chose qu’on ne pourra jamais reprocher au Julian Cope du début des années 90, c’est d’avoir eu une phase créative plus que foisonnante. Pensez donc : après plus d’une dizaine d’années de création musicale, sortir quatre albums en trois ans dont deux doubles et tous d’une qualité constante, ça frise la psychiatrie pour phase maniaque.
Jehovahkill est le huitième album solo du Barde allumé, le quatrième pour Island et le second double album en l’espace d’un an. Si, pour beaucoup de critiques, Peggy Suicide reste le meilleur album post-Fried, Jehovahkill, pour ma part, lui est supérieur. Et égal dans la forme. Égal car, comme Peggy Suicide, le disque se scinde en plusieurs phases et que, musicalement, il est aussi diversifié.
Ce qui le différencie reste sa conception, bien plus chaotique. Prévu à la base comme un simple Lp de onze titres, mal mixé certes, Island se fit un plaisir de détester l’objet et en particulier Slow Rider, qualifiée par le personnel comme la pire chanson écoutée en ce bas monde. Après d’âpres discussions, Cope, plus droit dans ses bottes encore qu’un Jospiniste rigoriste, refuse de changer d’un iota son disque, et encore moins le mixage, mais en revanche propose cinq morceaux en supplément. Curieusement Island accepte l’idée et ce simple qui devait s’appeler Julian H Cope devient Jehovahkill, nouveau double album rallongé d’une quinzaine de minutes par rapport au mix d’origine.
Ce qui le rend supérieur maintenant c’est le fait que Cope va au bout de sa vision des choses et de sa conception de la musique. Depuis toujours l’auditeur qui suit ses tribulations sait qu’il porte à la musique et ses parias un amour quasi inaltérable. Il s’est tout de même distingué en étant le premier à reconnaître le génie de Scott Walker, au moment où celui-ci était encore moins qu’un loser, en sortant la compile Fire Escape In The Sky ou en rendant un hommage plus qu’appuyé à Syd Barrett. Jehovahkill va lui permettre de rendre hommage à tous ses héros, radicaliser son propos et faire un pied-de-nez monumental à sa maison de disque.
L’album commence avec Soul Desert, morceau de transition dans lequel Cope prend ses marques direct (du Cope pur jus donc avec intro d’une belle douceur, montée en puissance tout du long et explosion finale) et semble s’interroger sur sa relation à Island (« I was lost and loveless in your soul desert, I was packed and kicking to your alien land »), ainsi que sa position quelque peu aliénante au sein de sa maison de disque : »I Need Security But I Hate Safe There » affirme-t-il sur le morceau suivant No Hard Shoulder To Cry On.
Après cette courte intro, plutôt grinçante, Jehovahkill peut vraiment démarrer. Avec Akhenaten, Cope entre dans le vif du sujet et ne s’en éloigne que pour quelques titres (le comique, dépressif et introspectif, Julian H Cope ou l’angoissé et schizo Know notamment). Il y développe ses convictions sur le Paganisme, plutôt anticléricales comme on peut s’en douter, s’interrogeant sur la pertinence du symbolisme de la croix (la couverture montre l’alignement de Callanish, créé 300 ans avant l’apparition du christianisme), remettant en cause tout au long du disque l’hégémonie du christianisme et s’attirera au final les foudres de l’église (notamment avec le single Fear Loves This Place dont le sujet semble être l’inaction de l’église à propos des violences).
Musicalement, c’est dans la lignée des textes : obsessionnel et sans concessions. Le programme est aussi riche que Peggy Suicide, mais surtout plus extrême car, si sur son précédent Lp Cope arrondissait les angles, le rendait présentable, ici, c’est loin d’être le cas. Jehovahkill est rêche, brut de décoffrage et semble se contrefoutre de plaire ou non à qui que ce soit. Il est une sorte de réceptacle à toutes ses obsessions musicales, un véritable bouillon de cultures en quelque sorte.
Entre folk lo-fi barré (Julian H Cope), krautrock sous haute influence du Detroit des années 60 (Necropolis), space rock (The Subtle Energies Commission), CAN sous acides (Poet Is Priest…), B.O épique (le fabuleux The Tower), folk flippé (Know ou Up-Wards at 45°), tous les styles y passent. Cope enquille les morceaux de bravoure avec une régularité certaine (outre le remarquable The Tower, on dénombre pas moins de huit très grandes chansons dans ce disque) et d’autres par moment plus anecdotiques (mais pas moins excellents) voire dispensables (si je devais faire la fine bouche, je retirerai Akhenaten et Fa-Fa-Fa-Fine ou le très dispensable Peggy Suicide Is Missing).
Pourtant, si on observe bien, opposer comme je peux le faire Peggy Suicide et Jehovahkill peut sembler complètement déplacé. En effet, on peut se demander si inconsciemment l’un et l’autre ne forment pas qu’un seul et même album. Outre un foisonnement musical évident (pour lequel les deux albums semblent s’opposer : Peggy Suicide est plus ouvert et abordable, Jehovahkill plus claustro), les deux partagent la même vision pessimiste de l’humanité sous deux angles différents : l’écologie pour Peggy Suicide, la religion pour Jehovahkill. Pour étayer cette théorie, il suffit juste d’écouter Peggy Suicide puis dans la foulée Soul Desert (rappelant curieusement le Las Vegas Basement, dernière chanson du Peggy Suicide), tout Jehovahkill et enfin de jeter un œil au dernier titre de l’album, Peggy Suicide Is Missing et recommencer. Vous verrez, c’est assez saisissant.
Néanmoins ce qui fait aussi le charme de Jehovahkill reste l’histoire entourant ce disque. Car comme j’ai pu l’écrire plus haut, outre sa conception chaotique, les propos tenus dans ce disque n’ont pas plu à tout le monde (notamment à l’église anglaise). Island, en froid avec lui depuis quelques temps, a d’ailleurs sauté sur cette occasion pour le virer une bonne fois pour toutes en prétextant que le disque ne s’était pas assez vendu. Prétexte complètement infondé puisqu’il faut savoir qu’au final il s’est mieux vendu que Peggy Suicide, en atteignant la 20ème place des charts (contre la 23ème pour Peggy), et que la tournée qui suivit sur Londres fut sold-out (d’ailleurs, face à cette conduite lamentable du label, le NME, du temps de sa superbe, avait mis Cope en couverture avec un bandeau « espèce en voie de disparition ». Couverture sur laquelle Cope ne fit aucun commentaire). A moins que ce ne soit au final ses propos sur U2 qui aient précipité son départ d’Island (« U2 = quatre têtes dans un même trou du cul »). Toujours est-il qu’au sortir de Jehovahkill, Cope se retrouve plus libre que jamais et en profite pour faire enfin ce qui lui plaît. Mais ça, bien sur, c’est une autre histoire que mes collègues Addictiens vont se faire un plaisir de vous narrer.
La version Deluxe de Jehovahkill est en écoute intégrale ici.
Autogeddon (1994), par Davcom
Enfin, ce qui lui plaît… à l’époque, pour sortir des disques, il fallait nécessairement un label. Après le lynchage par Island, Julian Cope trouve refuge chez Echo, une filiale de Chrysalis qui accueille des gens comme Moloko, Marc Almond ou encore I Am Kloot. Première livraison : Autogeddon. Le sujet : l’écologie.
Il s’agit en fait d’une diatribe contre la culture automobile et la pollution massive qu’elle engendre. Ce n’est pas la première fois qu’il aborde le sujet, puisqu’il en était déjà beaucoup question sur Peggy Suicide. Musicalement, cet album est une suite assez cohérente du précédent Jehovahkill, avec son folk bluesy sinistre qui approcherait presque certains travaux de Roger Waters via le titre Madmax, du folk sinistre avec Autogeddon Blues ou encore Don’t Call Me Mark Chapman (vous savez, celui qui… ), sa touche punk illustrée par I Gotta Walk ou encore un OVNI country and western dont, à l’heure où j’écris ces lignes, plus de 21 ans plus tard, je n’ai toujours pas compris toutes les subtilités. Un bon rock plus classique avec Ain’t But The Wrong Way et l’album se termine avec S.T.A.R.C.A.R., titre à rallonge de plus de 11 minutes qui offre à cet album une très belle conclusion.
En termes artistiques, cet album est un bon cru. En ce qui concerne Julian Cope, on peut se faire un peu de souci. Il se passionne de plus en plus pour les menhirs, il adopte une coiffure on ne peut plus bizarre et l’impression d’avoir affaire à un des types les plus cintrés de la planète rock est bel et bien présente. Le transformation en druide n’est plus très loin.
20 Mothers (1995), par Davcom
1995. Retenons la date, car cette année-là, Julian Cope sortit ce qu’on peut affirmer comme étant son dernier album de musique pop. Surtout qu’après deux albums plutôt introspectifs, celui-ci paraitrait presque solaire. Retour en arrière assez étonnant, avec des sonorités très claires et des chansons somme toute assez simples. Il le définit d’ailleurs comme étant un disque de Love Songs qui tourne autour de son environnement familier : sa famille, sa maison, son voisinage. Alors, champêtre et bucolique Julian ? Juste le temps de 4 chansons sur un disque qui en compte 20. Le bougre s’est encore bien joué de nous. Tout comme Peggy Suicide et Jehovahkill, 20 Mothers est subdivisé en 4 phases.
Il est évidemment difficile de ne pas faire de rapprochement avec les précités, mais ce 20 Mothers s’en tire très très bien, grâce à ce subtil mélange de chansons pop directes et ses comptines de dérangé mental. Notamment, on retiendra la première phase plus légère dans l’ensemble. Pour la phase 2, un grand morceau, Highway To The Sun et une tentative d’électro-dance légèrement incongrue avec Just Like The Pooh Bear. La troisième phase est plus synthétique avec des sonorités eighties, la quatrième partie mélangeant le tout en apportant une touche plus Space Rock qui sera un peu la marque de fabrique de l’album suivant, Interpreter.
La carrière de Julian Cope prendra ensuite une tournure beaucoup plus confidentielle. Il continuera à sortir des disques tout en se prenant pour un druide en cuir noir et képi, arborant barbe de druide et jouant de temps en temps aux antiquaires.
Epilogue : les années Head Heritage (1997 – ?), par French Godgiven
Visionnaire un jour, visionnaire toujours : après avoir tâté des grandes maisons de disques comme des gros labels indépendants, Julian Cope se mettra définitivement à son compte à la mi-temps des années 90, en montant sur la toile (qui n’en était alors, pour rappel, qu’à ses balbutiements) son propre site, lui permettant d’exposer ses vues parfois controversées sur tout sujet polémique lui tenant à coeur, comme de sortir et de distribuer ainsi, directement à ses fans, toute sa production, que ce soit sous son nom propre ou celui de ses multiples alias tels Queen Elizabeth, Brain Donor ou encore la série des albums méditatifs Rite.
Notre homme trouvera même le temps de se faire une solide réputation de musicologue averti avec les sorties en 1995 de Krautrocksampler puis Japrocksampler en 2007, ouvrages qui feront à la fois date et figures de référence pour les genres traités.
Pour ceux qui, bien qu’intéressés, seraient rebutés par la pléthorique et impressionnante discographie de notre ermite préféré, sachez qu’une récente compilation, Trip Advizer, regroupe les moments les plus significatifs de sa carrière solo entre 1999 et 2014.
Pas mal pour un type qui aura dû perdre le Nord pour se trouver lui-même.
La compilation Trip Advizer (The Very Best Of Julian Cope 1999-2014) est en écoute intégrale ici.