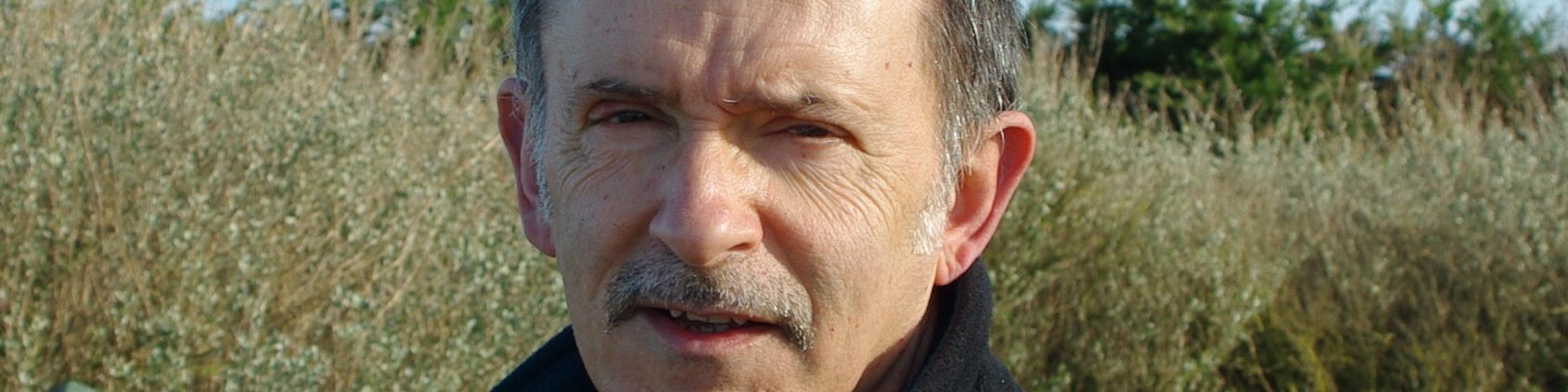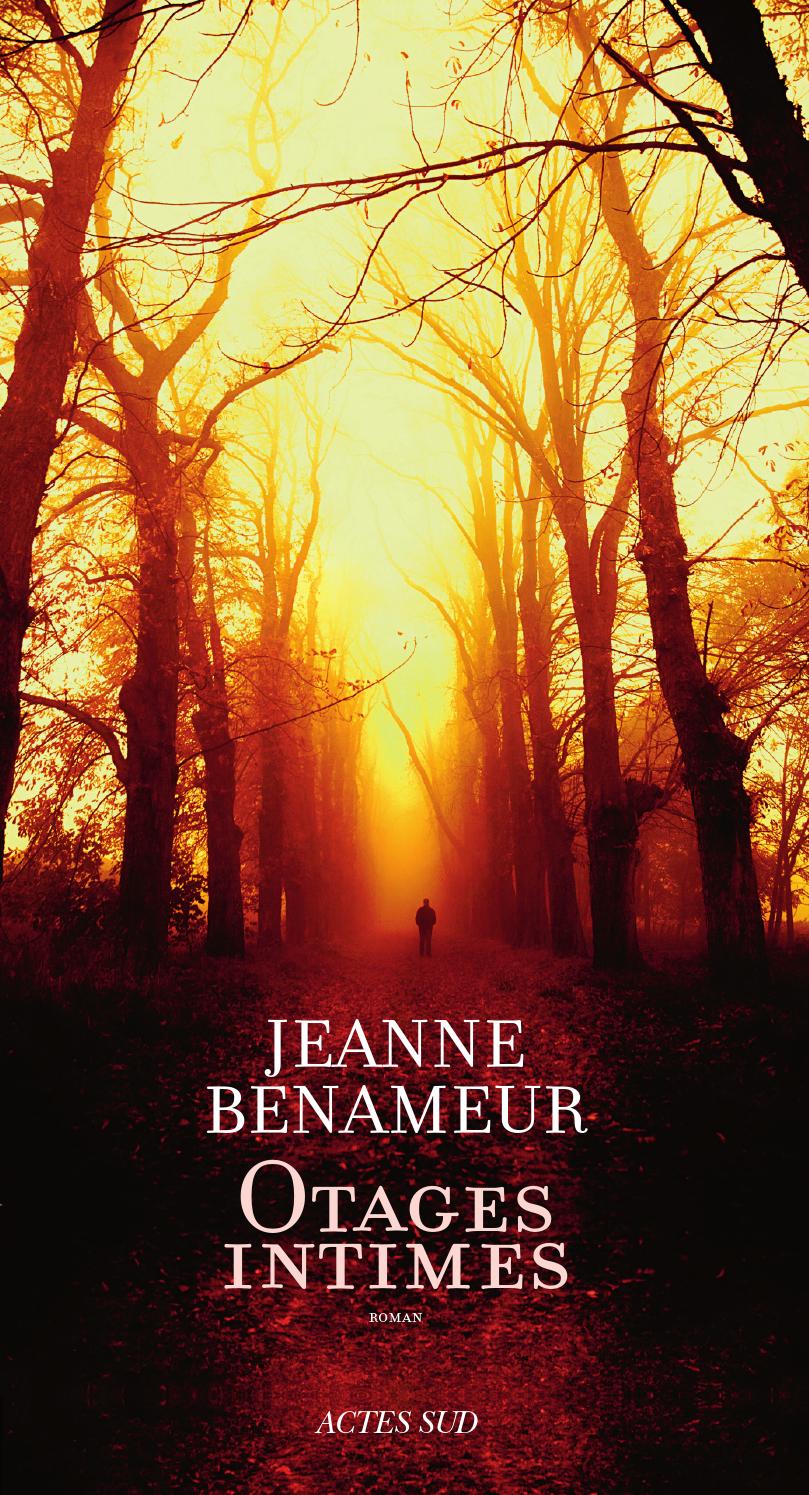[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#dd3333″]Ç[/mks_dropcap]a ne tient à rien une rencontre. Un écrivain qu’on reconnaît, aux premiers mots d’un livre quand on se donne la peine de s’y projeter. C’est ce qui s’est produit avec Sigolène Vinson en ce qui me concerne, il n’y a pas longtemps. Des mots qui vous absorbent et qui vous contiennent. Des mots arides, palpitants, exigeants, superbes. Un style minimaliste et minéral. Des phrases courtes. Un paysage rude et vierge. Sans esbroufe. Comme un endroit pas facile d’accès, pas évident, avec des codes qui lui sont propres et qui renferme un joyau.
Les livres de Sigolène Vinson ressemblent à la Corse.
C’est pour ça que j’ai envie de vous parler du plus singulier, Le Caillou (paru chez le Tripode en 2015).
Une jeune femme étrange vit à l’écart du monde dans son appartement parisien. Totalement improductive dans une existence qui ressemble à un ermitage farouche. Son voisin, monsieur Bernard, vient de mourir. On a transporté son corps dans un sac. Elle aimait bien monsieur Bernard. Il n’était pas raciste (« souvent les voisins sont racistes »). Et ils avaient noué une curieuse relation. Le vieil homme voulait retenir son visage. La sculpter. Il la dessinait sans cesse. Voulait la saisir. Pendant des après-midis, elle a posé pour lui. A chaque fois il finissait par fracasser la sculpture de son visage, et la recommençait le lendemain. Après sa mort, elle reprend la quête, jusqu’en Corse où il a sculpté son regard dans la roche.
On commence avec pas mal de sourires, plongés dans l’ironie mordante, l’autodérision et l’humour noir. Cette distance cynique qui rend les désarrois supportables et les désespoirs polis. Elle est belle et improbable cette héroïne, serveuse dans un café juste parce qu’elle est amoureuse d’un mec qui se met toujours à la même table. Et puis peu à peu elle devient proche de monsieur Bernard. Elle potasse ses livres d’art. Elle va mettre ses pas dans les siens, aller à la découverte d’elle-même, de ce qu’il a vu en elle. Sa beauté dont elle ne faisait pas grand chose et le squelette que l’on devinait sous son visage. Elle emprunte les chemins de son vieux voisin après sa mort pour percer le mystère de la fascination qu’il avait pour elle, la surnommant parfois sa madone. Jusque dans la retraite qu’il s’accordait parfois en Corse. Jusqu’à ce portrait d’elle qui l’obsédait.
Elle va découvrir ce pays comme elle va à la découverte d’elle-même. Ces gens bourrus et taiseux qui lui demandent de ne pas parler, elle qui l’ouvre pourtant si peu. Ceux pour qui « sac à foutre » devient un mot d’amour. Cette étrangeté, cette inversion des conventions qui lui ressemblent tant. Elle porte cet esprit en elle, cette indépendance farouche. Rien de ce qu’elle fait n’est aligné ou normal. Monsieur Bernard l’avait comprise : elle veut devenir un caillou. Ne plus ressentir, être impassible devant toutes les vicissitudes, connaitre l’apaisement et la sérénité. Et il a voulu la représenter dans la roche. Dans une matière forcément difficile à travailler, rude et indomptable. Quelque part en Corse, sous la brûlure du soleil, les assauts des embruns. Dans cet endroit étrange parsemé de statues de la Vierge. Dans le rocher, il n’a capturé l’essence que de ses yeux, à elle d’achever son visage après lui, grâce à la trousse à outils qu’il a laissée derrière lui. Cela deviendra la tâche de sa vie à elle. Un curieux héritage. On verra avec elle s’écouler le temps et la vieillesse arriver. La vie passer.
Un peu à l’écart du monde et finalement en plein dedans.
On est là, dans cette réalité onirique, auprès de cette femme insaisissable. Dans cette ambiance de poésie singulière qui frappait déjà dans Courir après les ombres ou dans Les Jouisseurs, à paraître fin août aux éditions de l’Observatoire. La langue de Sigolène Vinson ressemble à un sortilège. Elle est nue est sans fioritures, comme un morceau en version acoustique. Elle va directement à l’essentiel. Au cœur de la sensation sans la forcer. Sans trop d’adjectifs et sans effets superflus. Pourtant l’ivresse est là. Forte et entêtante comme l’essence d’un destin. De ces vies que l’on ne comprend jamais vraiment mais dont le mystère finit par envahir le regard. C’est comme une métaphore qui s’incarne directement dans un texte. ça vit. On ressent la pulsation de chaque phrase.
C’est beau comme un voyage dont on ne reviendrait pas vraiment.
L’alchimie des mots, on ne sait jamais vraiment pourquoi ça bouleverse. Et à chaque roman d’elle, on se retrouve comme un con, ému comme à la fin du Vieil homme et la mer de Hemingway. Elle a cette force là. Cette allégorie primitive qui vous met K.O. C’est un concentré de poésie, ça transpire à chaque paragraphe. C’est puissant. Ça ne laisse pas indifférent. Ça fait sourire, ça déroute, ça fait ressentir, ça fait frissonner. Ça ressemble au monde s’il était beau. Farouchement beau. Comme un rocher. Comme un caillou qui a tout supporté, même la solitude.
Car il y a de la sauvagerie ici, de l’indomptable, de l’inviolé et de l’indicible. Ça chamboule comme la première fois qu’on écoute une musique qu’on aime, sans comprendre vraiment tout ce qu’elle finira par évoquer pour nous. Comme le premier pied qu’on pose dans un pays inconnu qui nous contient déjà.
Venez-voir. Suivez-moi. Le chemin est étroit et pas indiqué sur les cartes. Mais dans ce caillou-là, il y a un trésor.
C’est bien de lire comme on découvre des terres inconnues. On a l’impression d’être au premier matin du monde, des mots qu’on découvre comme s’ils étaient pour nous, comme si c’était la première fois qu’on les voyait résonner si fort.
C’est pas si souvent que nos regards blasés se refont une virginité.
C’est pas si souvent qu’on ouvre des livres qui subjuguent.
Ça transfigure le quotidien, les choses telles qu’elles sont,
Des moments qu’on garde comme des cailloux dans les chaussures.
Le caillou de Sigolène Vinson est paru aux éditions Le tripode, 2015.