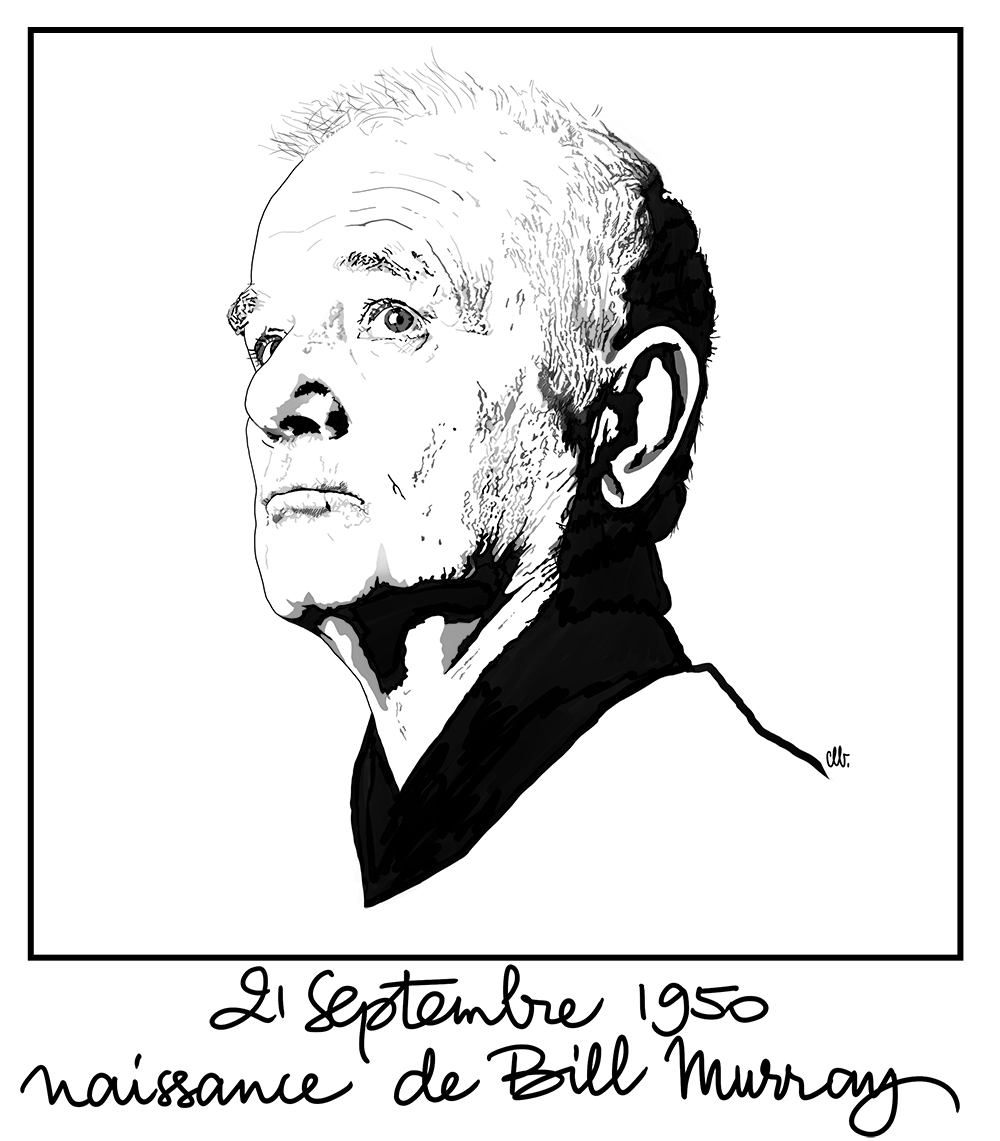[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]vant de tenter d’attraper au vol le manège spiralaire de Lost Highway et de trouver un siège libre sur l’une de ses Cadillac rutilantes, restons sur les bancs qui l’entourent, réservés aux parents émerveillés des sourires de leur progéniture qui, finalement, ne font rien d’autre que tourner en rond.
Lost Highway est alors un film noir à la plastique impeccable, où les brunes et les blondes sont mystérieuses, les jalousies mortifères et les riches d’affreux pervers. Sur une pellicule glacée, racée et brillante, l’américanité dans toute sa splendeur, un cinéma qui s’autocite et se déploie, instantanément classique, comme dans la séquence d’apparition d’Alice Wakefield sur « This magic moment » de Lou Reed.

[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]ost Highway est, en outre, un film de Lynch, qui contamine un paysage classique de ses obsessions déjà bien rodée dans sa filmo. Les couloirs de Blue Velvet, les bruitages de ventilation oppressante, le road trip de Sailor et Lula, la pénétration dans la chair (fugace, mais fondamentale, au moment des passages de Fred Madison à Pete Dayton, et retour) et les visages déformés de Eraserhead, voire d’Elephant Man.
Eraserhead, cauchemar sans fond, n’incitait pas véritablement à la résolution : on s’abîmait volontiers dans un univers parallèle et anxiogène.
Lost Highway, par son ancrage dans une mythologie, voire dans des stéréotypes fascine et excite, et donc déconcerte d’autant plus par sa construction. Le thème de la schizophrénie est un grand classique de l’exploitation du point de vue : deux personnalités, deux réalités qui se complètent, s’opposent ou se répondent. Ici, c’est bien plus problématique.
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]ynch est d’une perversité redoutable, parce qu’il dissémine tout au long de cette route sans fin une série d’indices malicieusement dédiés à nos esprits formatés par des décennies de film noir et des siècles de littérature. Tout semble construit de manière à ébaucher la possibilité d’une résolution de l’énigme. La dualité des personnages masculins, la brune et la blonde, le père/pervers, et l’unique homme mystère au centre de tout cela… Un monde nocturne et huis clos auquel répondent les extérieurs de carte postale du pavillon des Dayton (écho du générique d’ouverture de Blue Velvet, encore…) Les cadres photos, les lieux, les convergences, autant d’éléments qui nous amènent à considérer le film comme un puzzle qu’on nous défie d’être en mesure de réassembler.
Et là, le cauchemar commence. Parce que le puzzle n’est qu’en deux dimensions, parce qu’un chronotope ne suffit pas, parce qu’une ligne directrice est insuffisante.
Je ne reviendrai pas sur toutes les théories possibles sur le rêve et la réalité, sur les fantasmes et la dimension psychanalytique, qui tous ont droit de cité.
Ce qui m’intéresse, c’est de considérer que les deux récits pourraient être considérés comme deux bandes clairement séparées avec, de temps à autre, des passerelles, des échos, des béances qui font que l’une semble être le revers de l’autre. Les routes qui ouvrent et ferment le film, qu’elles aillent dans des directions opposées, se rejoignent à l’infini ou non, en sont l’élément programmatique. Lynch construit une impossibilité dont le titre se fait l’écho : une autoroute perdue, c’est d’une beauté absolue, parce que c’est impossible, parce que c’est fantasmable. Nous sommes ici, au sens étymologique du terme, au cœur même de l’utopie.
Pourquoi, alors, ne pas s’arrêter et considérer le film comme cette escroquerie (« je construis une énigme insoluble en te faisant croire que tu aurais pu parvenir à le faire ») ?
Parce que nous sommes des voyeurs.
Le thème du regard traverse tout le film. La fascination de la VHS qui filme l’intérieur de l’appartement, les flics qui surveillent Pete et le regardent surtout baiser (dans certains des passages les plus drôles du film : « Fucker gets more pussy than a toilet seat »), ses parents avachis devant la télévision, les films pornos, voire les snuff movies… On ne parle que de ça.
Les flics sont justement le pivot de cette quête du sens. A partir de la métamorphose de Fred en Pete, ce sont les seuls à créer un lien concret entre les deux mondes (à l’exception de l’homme mystère, mais son statut fantastique nous le fait assimiler à une réalité onirique et parallèle). Inopérants, passifs, ils veulent démêler l’écheveau du récit et percer l’impasse exégétique. D’où la dernière phrase d’un des inspecteurs :
“There is no such thing as a bad coincidence”.
C’est exactement ce que tend à se dire le spectateur, et Lynch lui envoie ici un contre-indice assez magistral et provocateur.
Le spectateur au centre du film, interpellé dans une séquence fugace mais primordiale : lors d’une traversée du couloir de son labyrinthique appartement, Fred s’arrête un instant, troublé, l’œil plein d’effroi, comme souvent, à une nuance près : il vient de regarder la caméra, c’est-à-dire nous. Il vient de nous voir. Nous sommes aussi son cauchemar et son hallucination.
Le pied de nez assimilé, le désir de revoir le film ne s’en émousse pas pour autant.
Parce que nous sommes aussi obsessionnels que Fred, aussi bouillonnants que Pete, voire aussi priapiques que Dick Laurent. Parce que Renee et Alice sont les objets de toutes les quêtes et que les trajectoires convergent toutes vers cette femme sublime, elle aussi utopique. Fred ne peut la posséder par impuissance, Pete croit le faire mais n’est qu’un objet pour elle. Alice Wakefield, « le champ du réveil », est la lucidité imposée à l’homme de l’impossible possession de la femme. Que ce soit par ses amants, ou par toute les voies de traverses, le porno, le fric, le SM… Rien n’y fait. L’intense et troublante scène du strip tease de Renée un flingue sur la tempe en est l’illustration. Qui domine ? Qui vampirise ?
Avant de disparaître, Alice conclut à l’oreille de Pete :
« You’ll never have me ».
C’est là le sujet du film, et la grande réflexion sur les pouvoirs suggestifs de l’image. Voir et avoir, telle est la question. Voir une femme possédée dans un film porno n’est pas la posséder.
Revoir Lost Highway n’est pas le maîtriser. Mais cette frustration, ces préliminaires infinis, cette érection sans orgasme, c’est la définition du cinéma que nous propose Lynch : parce que post coitum anima tristis, ce film est celui du désir sans fin.
https://youtu.be/jFlLTMYd_98