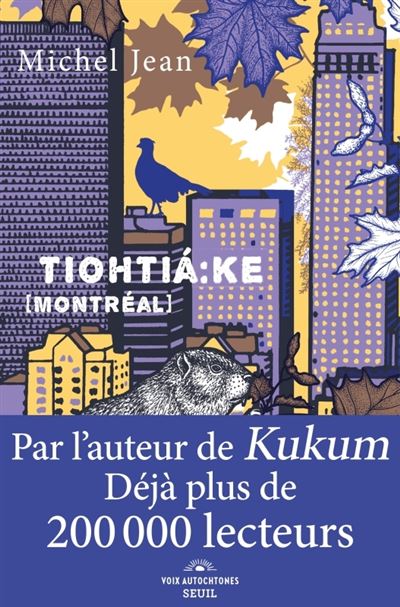à tout juste 18 ans, Elie est condamné à dix années de prison pour avoir tué son père, alcoolique et violent. Mais une sanction bien plus lourde l’attend : pour le jeune Innu, c’est aussi le bannissement à vie de sa communauté. Il ne pourra pas rentrer sur la réserve, chez lui. Sa peine purgée, il est condamné à errer.
En quelques pages introductives, le décor est posé. Elie rejoint le sinistre cortège des sans-domicile de Montréal. Un drame ordinaire, comme il en est dans toutes les villes du monde. Mais il est une particularité pour la métropole québécoise : si les Premières Nations représentent moins de 1% de ses habitants, elles constituent près de 10% des sans-abri, comme l’indiquent une note de l’éditeur probablement fondée sur une enquête de TV5 Monde. Un chiffre qui ne doit rien au hasard : « traumatismes historiques, déracinement, perte de repères, parcours de vie difficile, racisme, discrimination, dépendance, violence et pauvreté« , autant de facteurs qui fragilisent et peuvent mener à la rue les populations autochtones (« Le milieu de l’itinérance en pleine tempête« , Centraide du Grand Montréal, 18 janvier 2022).

Elie est le produit de cette histoire traumatique. Comme tous ses compagnons à sa suite, les personnages du roman représentent chacun une facette des profondes blessures engendrées par la politique de destruction de la culture amérindienne menée par le Canada aux XIXe et XXe siècles. Si l’auteur ne s’attarde pas sur ces années de plomb, c’est pour mieux poser le regard sur leurs conséquences. Comme pour rappeler qu’il ne suffit pas, loin de là, de décréter que la page est désormais tournée. Michel Jean raconte, avec simplicité, sans démonstration appuyée, les destins brisés par des secousses qui n’en finissent pas de répliquer.
Le roman s’inscrit
dans la lignée
des romans d’apprentissage,
et non dans celle
des romans noirs
L’un des points forts de Tiohtiá:ke est assurément les différents portraits proposés à travers les personnages. Si Elie est au centre de l’intrigue, ses compagnons ne sont pas secondaires. On s’attache, instantanément, à ces clochards célestes dont la lutte pour la survie ne freine jamais l’élan de solidarité. Au contraire, ils forment une troupe unie par-delà la disparité de leurs origines : qu’ils soient Innu, Inuit, Nakota, Cri ou Anishinabe, ils se retrouvent dans les mêmes lieux, notamment le square Cabot, du nom de l’un des premiers explorateurs européens venus heurter ce coin du monde. Peut-être un même rapport à la ville, à ses tours de bétons et d’acier, à son air vicié… Peut-être pour l’auteur une façon de suggérer que la Renaissance Amérindienne passera par le rapprochement de ces peuples qui se sont parfois disputés.
« Une fine neige tombe sur le square Cabot, blanc linceul tapissant ses souillures, lissant ses aspérités et créant une sensation de calme et de silence au milieu de la ville. La neige ramène toujours Elie à la forêt. Il adorait suivre la trace des lièvres près du campement et poser ses collets où ils se prenaient parfois. Leur chair servirait à les nourrir et leur fourrure à fabriquer des vêtements. Il n’a pas vu cet animal depuis des années, mais il saurait encore comment le chasser. Ce que l’on apprend dans l’enfance s’inscrit en nous pour de bon ».
─ Michel Jean, Tiohtiá:ke [Montréal]
Le roman s’est ouvert sur une rupture, mais il se déploiera autour des liens tissés entre les individus. Des liens indispensable à la survie, tant matérielle que psychique, des sans-abris. Le collectif n’est pas un mot creux pour les rescapés du Square Cabot. Michel Jean ne s’attarde pas sur les éclats de violence, inhérents à la vie dans la rue ; il préfère remonter à sa source, l’agitation intérieure, le repli sur soi, la peur. Sans repère ni avenir, Elie se dénigre constamment sans même s’en rendre compte ; et même lorsque le destin commence à lui sourire, il est encore contaminé par ce sentiment de ne plus rien valoir. L’auteur s’attache aussi aux étapes pour s’en sortir : des rencontres, des coups de main, des gens qui prennent soin les uns des autres. Et ce retour à la nature qui peut apaiser l’esprit malmené pour tout Amérindien.
C’est finalement un sentiment de fraicheur qui se dégage de cette lecture. Le texte s’inscrit dans la lignée des romans d’apprentissage, et non, comme pourrait le laisser penser le sujet, dans celle des romans noirs. Qu’importe que le roman puisse sembler empreint d’un certain angélisme ; qu’importe que son personnage évite bien des chausse-trappes constitutifs de la vie dans la rue. Que ceux qui craindraient de plonger dans un sinistre récit des bas-fonds se rassurent : le récit n’a rien de glauque. Bien au contraire, avec son style clair et limpide, l’auteur montre un chemin et fait la part belle à ce qu’il reste de l’humanité lorsque l’on a tout perdu.