L’une des plus grandes joies et satisfactions de la vie d’un lecteur est de découvrir un jeune auteur à la parution de son premier roman et, les années filant, d’observer son évolution, de voir ses mots qui changent, de comprendre ses obsessions, de trouver ses angles morts. Il nous accompagne en arrière plan, comme un lointain ami qui se rappelle à notre souvenir au bout de quelques années et qui, bien qu’ayant un peu changé, paraît toujours aussi proche de nous. Certains disques, ou parfois une chanson, peuvent être la bande son d’une tranche de vie, d’un moment, agréable ou désagréable, mais qui devient associé à un instant : réécouter une chanson peut nous replonger des années en arrière, et nous faire revivre des sentiments enfouis. Il est plus rare de relire un livre, mais essayez, je vous assure qu’il se passe quelque chose de cet ordre. C’est alors avec une grande joie que je me suis replongé dans les deux premiers romans de Pierric Bailly, à l’occasion de la parution de son troisième, L’Étoile du Hautacam. L’occasion était trop belle, je me suis également entretenu avec Pierric Bailly et y ai découvert un jeune homme passionnant et chaleureux (l’entretien est à lire ici).
Polichinelle, naissance d’une langue
Pour ne rien vous cacher, j’avais déjà relu deux ou trois fois Polichinelle, qui exerce sur moi un pouvoir de fascination et d’émerveillement que j’aimerais partager. Paru lors de la rentrée littéraire 2008, j’avais été attiré par certains articles de presse qui décrivaient Polichinelle comme un roman générationnel à « la langue bien pendue », « drôle et décapant », « ébouriffant », qu’ouvrir ce livre était « accepter de se prendre une gifle mémorable », et j’en passe. Il n’en fallait pas plus au lecteur compulsif que j’étais pour me précipiter dessus. Une époque où je lisais essentiellement de la littérature étrangère et où les quelques auteurs français que je suivais (Éric Chevillard, Régis Jauffret, Jean-Philippe Toussaint), bien que me fascinant par leurs plumes et leurs univers, me paraissaient loin de certaines préoccupations, en bref : c’étaient déjà de vieux sages. Ce jeune Pierric Bailly (né en 1982, il a alors 26 ans), dont la seule photo disponible était un portrait sur lequel il est à peine souriant, le regard légèrement embué, une casquette grise vissée sur la tête : le portrait d’une jeunesse mi-désabusée, mi-nonchalante à laquelle on ne la fait pas à l’envers, celle à laquelle je pensais appartenir.
« J’étais scotché à mon siège, comme à bord d’une bagnole qui démarre en trombe, le rythme cardiaque s’accélérant en proportion égale à la vitesse de la voiture. »
La « gifle mémorable », je me la suis effectivement prise en lisant Polichinelle. Dès les premières phrases, j’étais scotché à mon siège, comme à bord d’une bagnole qui démarre en trombe, le rythme cardiaque s’accélérant en proportion égale à la vitesse de la voiture. C’était pareil, je ne pouvais plus m’arrêter, ni même cligner des yeux de peur d’en perdre une miette, tourner les pages revenait à changer de vitesse, un léger moment de flottement, de décélération, avant de repartir de plus belle.
Dans un premier temps sidéré par l’écriture – empruntant au rap, au slam, à la poésie urbaine et aux joutes verbales pour la rythmique et la rime récidiviste – j’ai ensuite été happé par le propos – une bande de jeunes dans le Jura passant leur été à faire des conneries, flirter et tchatcher. C’est quoi ce truc ?, me suis-je demandé à maintes reprises, ça ne ressemblait à rien de ce que j’avais pu lire, il y avait une énergie folle, j’étais en compagnie des personnages de roman les plus loufoques et réalistes à la fois que l’on puisse imaginer, qui maniaient une langue aux frontières du patois, du verlan, de l’argot, totalement libre et débridée, affranchie. Je les entendais, je les voyais, je faisais partie du voyage.
Ces héros de l’ordinaire font leurs courses à Shopi, achètent des Monster Munch, sniffent du Nesquik, écoutent Missy Elliott et Michael Jackson, parlent de Loana et Jenifer, conduisent une AX, et se foutent de la musique de leurs parents, notamment de Souchon et Voulzy. Ils sont aussi drôles que pathétiques, ont les mêmes désirs consuméristes que tous les ados du monde, aspirent à l’amour et à la déconne. Et bien sûr, comme ils sont en pleine cambrousse pendant les vacances d’été et qu’il n’y a rien à faire, ils jouent aux petits délinquants sans arrière-pensées criminelles, juste pour le fun.
S’il n’était qu’un portrait d’une jeune génération vivant à la campagne, le livre serait déjà une réussite, mais il est bien plus que ça. Il y a tout d’abord un travail sur la langue d’une étonnante profondeur. L’auteur a observé ses petites sœurs et leurs amis, a pris des notes compulsivement sur leurs manières, leur parler, et ces longues observations quasi-anthropologique (le premier jet du roman comportait 1500 pages !) ont été la matière première de ce livre fascinant. Il n’est pas question uniquement de vocabulaire employé, la structure elle-même de la phrase, de la narration, est sous influence orale, et il arrive bien souvent que le narrateur (Lionel, le plus vieux de la bande, le seul à être majeur) se laisse emporter par le flow.
Johannes passe la fin de l’après-midi à gribouiller les murs du vestiaire. Johannes il graffe comme il écrit. Son écriture d’écolier. Comme il copierait une leçon. Et sans aucun relief. Il a volé une bombe de noir, il m’a dit ce sera pour les ombres, et il ne sait même pas où elles vont, les ombres.
Il écrit nos six prénoms, comme sur l’agenda d’une copine, tu lui notes un mot doux, ma puce je t’aime fort, big kiss et tout, il écrit ce genre de trucs, on était six, on était sales, on était soûls, on était seuls, sans les soucis, sans les sous aussi, alors on était souvent assis.
Enfin, Pierric Bailly y a instauré un grain de sable, d’étrangeté, qui, nous le verrons, sera un fil rouge reliant les livres suivants. Dans Polichinelle (anagramme de Lionel Elpich, notre narrateur), les personnages ont des caractéristiques physiques mouvantes, malléables, comme des personnages de pâte à modeler, ou de cartoon, de polichinelle : Jules a un cul à la place du ventre, Johannes un trou dans l’épaule qui lui sert d’étagère pour trimbaler son poste, Laura a un sein et trois langues, etc. Ce côté loufoque, étrange, et à priori hors propos, crée une juste distance avec le lecteur qui, non seulement comprend que, comme la langue, rien n’est figé, que l’adolescence est un terreau de mutations, et qu’il a sous les yeux un spectacle et non une « chronique sociale ».

**********
Michael Jackson, l’amour en trois dimensions
Michael Jackson est le titre de roman le plus bâtard de la littérature, pour la simple et bonne raison qu’il ne s’agit pas d’un roman sur Michael Jackson. Il en est pourtant question, ici ou là. Dans les conversations de nos protagonistes qui ont le chanteur américain comme référence, comme ils peuvent citer Britney Spears ou Mariah Carey. Ou encore quand l’un des narrateurs se rend compte que son père est né le même jour que le chanteur et qu’ils fêtent tous les deux leurs cinquante ans. Enfin, il y a deux intermèdes dans le roman, entre la première et la deuxième partie, et entre la deuxième et la troisième, ces intermèdes décrivent les premières scènes et dialogues des clips de Michael Jackson, Thriller et Remember the time. Dans le premier nous y voyons le chanteur (encore noir), avouer à son amoureuse qu’il n’est pas comme les autres, et de se transformer, la pleine lune apparaissant, en loup-garou. Dans le second, en Égypte ancienne, la reine s’ennuie terriblement et demande à ce qu’on la divertisse, apparaît alors dans un tour de prestidigitation, un Michael Jackson blanc comme neige qui viendra la séduire et lui rappeler le temps où ils s’aimaient.
De quoi parlons-nous au juste ? Quel est le rapport avec ce roman qui, je l’ai dit, ne parle pas de Michael Jackson ? Pierric Bailly sème le trouble et s’amuse avec nos nerfs dans ce roman « en trois dimensions », comme il est indiqué sur la quatrième de couverture. Les trois parties que constituent le livre ont chacune pour narrateur un prénommé Luc. Le premier a 18 ans, est né le 15 mars 1988, arrive tout juste à Montpellier pour s’inscrire à l’université, section Arts du Spectacle, et veut être producteur de cinéma, le second a 22 ans, il est né le 15 mars 1985, et entame son Master 1 dans la même filière, le troisième a 26 ans, il est né le 15 mars 1982, est diplômé et exerce le métier de cadreur-monteur. Chacun de ces Luc rencontre une Maud avec qui il va vivre une histoire d’amour, la première a 21 ans, elle est en Master 1 de psychologie, la deuxième a 22 ans et fait ses études aux Beaux-Arts, la troisième a 23 ans et a intégré Sciences Politiques. Tout comme le chanteur qui, d’une période à l’autre, va changer de couleur, être le même sans être le même, nos personnages sont ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait différents. Partant de ces premières observations, pouvons-nous en conclure que Pierric Bailly nous propose ici une variation sur la métamorphose ? Ce pourrait être une piste, mais aussi une manière d’intellectualiser et de conceptualiser un roman qui n’est peut-être ni intellectuel ni conceptuel. Alors revenons à nos moutons.
On se souvient de Polichinelle, cette jeunesse dans le Jura, à Lons-le-Saulnier, du narrateur Lionel passant l’été avec sa petite sœur et les amis de celle-ci. Nos trois Luc semblent être des variations plus âgées de Lionel – in extenso de Pierric Bailly qui prête beaucoup de ses traits à ses personnages. Ces trois Luc, bien que nés à quelques années d’intervalle, ont ce même passé jurassien et leurs cursus universitaires et professionnels coïncident. Les variations sur le personnage sont concentrées sur ses expériences amoureuses et sexuelles avant de rencontrer Maud. Les trois Maud, en revanche, sont radicalement différentes, l’une « n’est pas très jolie, les cheveux mi-longs et frangés à la Betty Page, et un peu boulotte« , mais pleine d’entrain et d’énergie, la seconde, plus belle, croqueuse d’hommes et légèrement cynique et suffisante, surjouant la posture d’étudiante en Beaux-Arts, revenue de tout, la troisième, plus adulte, plus intello aussi, a un regard acéré sur les choses.
« Pierric Bailly n’est ni un poseur ni un théoricien et c’est avec des mots simples et un sens de l’observation aigu qu’il nous décrira telle ou telle situation. »
De sexe et d’amour, il en est beaucoup question dans Michael Jackson, peut-être d’ailleurs ne s’agit-il que de cela. À travers les expériences que traversent les trois Luc et Maud, qui selon leur passé n’auront pas les mêmes attentes, les mêmes projets, les mêmes désirs, on voit se dessiner le portrait d’une génération pour qui amour et sexe sont extrêmement liés et pour qui ce sont bien plus que des enjeux personnels et émotifs mais des manières d’être au monde, de se montrer sous tel ou tel aspect. La présence de deux autres personnages, amis des Luc et Maud, est également au cœur du roman : Claire et Ronan. Dans un premier temps ils se rêvent en acteurs porno professionnels puis leur carrière va au fur et à mesure décoller, en même temps que leur relation amoureuse va s’intensifier. Leur relation et leur passion du sexe, en fil rouge dans tout le roman, seront un axe et un point de repère autour desquels les autres personnages évolueront en réaction, en opposition ou en accord avec cette sexualité libérée.
Lorsqu’il vient d’arriver à Montpellier, Luc 18 ans se fait rapidement inviter par des camarades de fac à une soirée qui s’orientera rapidement en partouze, mettant Luc quelque peu mal à l’aise. Contrairement au récent film Bang Gang qui nous montrait une jeunesse partouzeuse dans une mise en scène triste et sans caractère, sans point de vue et sans audace, laissant les acteurs-personnages bien seuls avec leurs corps, Pierric Bailly décrit ces scènes avec beaucoup d’intelligence et d’humour, nous rappelant que le sexe n’est pas un objet sans corps et sans esprit.
Côté amour, que l’on ait 18, 22 ou 26 ans, les enjeux ne sont pas les mêmes pour Luc et Maud, les premiers se mettent à nu en toute confiance, en toute complicité, naïfs et innocents, quitte à trop s’exposer et se mettre en danger. Les seconds, au contraire, feront semblant, tout le temps, de tout, toujours dans la méfiance, toujours à scruter les défauts de l’autre et dans l’appréhension que tout s’arrête alors que rien n’a commencé. Enfin, les derniers, avec leurs activités d’adultes, de vacances à Prague, et leur aptitude à tout se dire, à enfin trouver une réelle complicité sexuelle, pourraient nous paraître plus sereins, sur la bonne voie pour que le couple fonctionne sur la durée, mais sont-ils plus heureux pour autant ?
Même si amour et sexe semblent être au cœur de ce roman, les notions de territoire, de ruralité et d’urbanité sont, comme dans Polichinelle, au centre des questionnements de l’auteur. Luc étant le seul des personnages à venir de la campagne, il a un côté éminemment exotique, ses amis le voyant comme un « Nature boy exilé », lui qui a une affiche de Richard Virenque dans sa chambre parce qu’il aime passionnément le cyclisme et le Tour de France, ce qui provoque l’hilarité autour de lui.
Dans certains milieux, et c’est le cas parmi les étudiants à l’université, on n’évoque jamais Richard Virenque sans y associer un rire comprimé ou une tentative de blague autour de ses maladresses syntaxiques et se sa voix d’ornithorynque. On ne salue pas ses performances sportives au premier degré, comme on le fait pour un champion mieux né et qui pratique le tennis ou l’équitation. Le cyclisme est un art mineur, Richard Virenque un athlète de variété.
À travers cet exemple et bien d’autres, Pierric Bailly dresse un portrait d’une France coupée en deux, où les gens qui ont des goûts « populaires » peuvent être marginalisés par ceux qui entretiennent une culture élitiste et un certain snobisme. Il nous rappelle aussi que ces personnes ne se rencontrent quasiment jamais, et qu’il faut qu’un mec de la campagne aille à la ville pour que cette confrontation existe. À partir de ce simple constat, il n’est pas difficile d’établir un parallèle avec toute minorité, quelle qu’elle soit, se retrouvant dans un milieu qui n’est pas le sien. Mais Pierric Bailly n’est ni un poseur ni un théoricien et c’est avec des mots simples et un sens de l’observation aigu qu’il nous décrira telle ou telle situation, sans nous en donner une analyse ou une conclusion édifiante.
Son enjeu, avant toute chose, n’est rien d’autre que l’écriture. Moins marquée stylistiquement que dans Polichinelle, la narration de Michael Jackson est plus blanche, plus neutre, laissant les écarts langagiers aux dialogues toujours nombreux et parfois fleuris, même si l’argot et le langage d’étudiants citadins ne sont pas les mêmes que ceux des lycéens ruraux. Pierric Bailly rend même la lecture plus simple pour les non-initiés en faisant de ses Luc des êtres candides qui, lorsqu’ils rencontreront une abréviation ou un mot d’argot que le commun des mortels ne pourrait comprendre, expliqueront au lecteur ce qu’untel a voulu dire en faisant mine de découvrir en même temps que le lecteur de quoi il s’agissait. L’humour, quant à lui, est toujours présent mais ce n’est plus dans les situations et les dialogues (qui faisaient le ressort comique de Polichinelle), mais dans le regard des trois Luc, légèrement distant, sarcastique ou narquois parfois, mais jamais méchant, faisant mouche à chaque fois.
Maud ne me convie pas à venir la prendre dans la cabine d’essayage. Nous sortons sans sac, et elle s’allume une cigarette. Quand je la vois fumer, je me dis toujours qu’une fellation serait meilleure pour sa santé.
Autre variation sur la jeunesse, Michael Jackson est un roman fascinant aux multiples entrées d’un auteur qui semble tout mettre en œuvre pour danser avec ses démons et mettre en scène ses métamorphoses, comme le roi de la pop en quelque sorte.
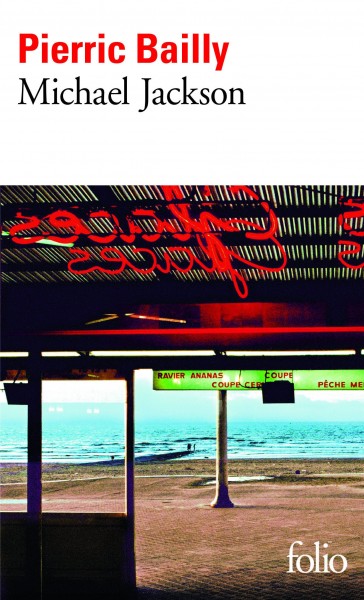
**********
L’Étoile du Hautacam, blockbuster intime
Paru en janvier 2016, ce troisième roman de Pierric Bailly que j’attendais avec bien plus que de l’impatience m’a complètement décontenancé, tout comme la lecture de Michael Jackson m’avait déstabilisé en son temps. Qu’attendais-je d’autre de cet écrivain qu’il me trouble à nouveau, me pousse dans mes retranchements, me gratte et me dérange ?
Tout commence par l’enterrement de Sarah, la grand-mère de Simon, dans une petite église de Stellange, ville sidérurgique de Moselle cernée « par cinq collines de taille moyenne, situées quasi à égale distance les unes des autres, une disposition en étoile qui lui valait son étrange patronyme ». Simon a fait le déplacement de Bagnolet, banlieue parisienne dans laquelle il habite, et c’est avec une certaine surprise qu’il découvre à la cérémonie la présence de Mariette, son ex après douze ans de vie commune, et de leurs amis communs. Peu de temps après et suscitant la surprise de ces derniers, Simon décidera de tout lâcher pour effectuer un retour à la terre. Abandonner Bagnolet, le milieu du cinéma dans lequel il galère depuis tant d’années, ses amis qui ne le comprennent plus, pour venir s’installer dans la maison de Sarah, repartir de zéro, vivre chichement, éventuellement se remettre de sa rupture d’avec Mariette. Dernière petite soirée avant le départ, dernières bouteilles vidées, adieux amers, et Simon prend le volant. Au bout de plusieurs kilomètres sur l’autoroute, sous la pluie, Simon veut prendre une sortie pour s’arrêter sur une aire de repos et, surpris par un animal dans ses phares, donne un coup de volant. Écran noir.
Après une séquence de réveil étrange, entre rêve et réalité, hallucinante et dérangeante, sans explication rationnelle, Simon poursuit sa route pour se rendre sur l’Étoile du Hautacam, autrement dit le village de Stellange perché à quinze kilomètres d’altitude sur un conduit de béton armé posé au pied des Pyrénées, aux abords de Tarbes. L’Étoile est un lieu étrange, ensoleillé 365 jours par an, dont le port de lunettes de soleil et chapeau est obligatoire, où le gratin de la jet-set a coutume de se rendre en vacances pour s’y montrer. Autrement dit l’endroit le plus hype qui soit. C’est aussi un lieu de villégiature ultra-touristique où il fait bon venir passer juste la journée lorsqu’on en a les moyens. Mais Simon n’y va pas pour la frime, il retourne simplement sur son lieu de naissance et s’inscrit dans une boite d’intérim pour être balayeur à mi-temps sur l’Étoile, de quoi avoir un petit revenu et du temps pour s’occuper de la maison. Même si les stars de passage sur l’Étoile sont parfois mentionnées, Simon va surtout fréquenter les quelques habitants du village, dont Jamila, la patronne du Cosy, le snack de la place du village. Jamila et Simon étaient amis pendant leur enfance et ne s’étaient pas revus depuis le départ de Simon, une complicité amoureuse va alors s’installer puis s’épanouir.
« L’écriture (…) se veut plus modeste et plus neutre, même si Pierric Bailly manie toujours à la perfection l’art du dialogue. »
Parsemé de rebondissements et d’extraordinaire qu’il serait cruel de dévoiler aux futurs lecteurs, le troisième roman de Pierric Bailly raconte par le détail le quotidien de Simon, Jamila, et de ce village aussi fascinant que mystérieux. Au cœur de l’intrigue se jouent les mécanismes classiques de tout conte qui se respecte : incarnations du Bien et du Mal s’affrontent jusqu’à une fin digne des plus grands blockbusters, où l’intime et le grand spectacle, l’amour et le grand-guignolesque, fusionnent en une explosion émotive rarement ressentie.
Ce n’est plus la jeunesse qui est ici décrite, mais la précarité confrontée à un monde de paillettes (les scènes où Simon exerce son boulot de balayeur à l’aube, quand le village ne s’est pas encore réveillé, sont très belles), la difficulté à être fier de soi lorsque ceux qui « réussissent » s’affichent avec autant d’impudeur et de vulgarité. La nécessité, alors, de faire de sa vie un spectacle lorsque l’on est entouré par une société du spectacle. Simon est-il en train de rêver ? Est-il dans le coma ? Vit-il réellement cette histoire ? Le flou et l’incertitude planent sur tout le roman, mettant le lecteur dans une certaine situation d’inconfort, n’ayant pas pour habitude que le fantastique et l’irrationnel se substituent aussi longtemps au réel. Le curseur de l’imaginaire étant poussé à son maximum, l’écriture quant à elle se veut plus modeste et plus neutre, même si Pierric Bailly manie toujours à la perfection l’art du dialogue. Encore une fois il est possible d’en faire plusieurs lectures sociologiques même si l’on ressent très bien que ce n’est pas l’intention de l’auteur qui est avant tout un raconteur d’histoires.
Sous des allures de livre à grand spectacle teinté de fantastique, de science-fiction et d’étrangetés, L’Étoile du Hautacam s’avère être le livre le plus triste de son auteur, le moins incarné aussi en un sens. Il serait facile de voir en Simon un nouvel avatar des personnages précédents des romans de Pierric Bailly : comme Lionel il revient sur un territoire qui n’est plus le sien et se tient pour observateur plus qu’acteur de la population bigarrée qui l’entoure, et comme les trois Luc il a fait carrière dans le cinéma et ne se nourrit plus d’illusions depuis longtemps. Mais ici, la narration à la troisième personne faisant son travail de distanciation, on imagine moins l’auteur ancré dans son personnage, un auteur qui aurait pris de la hauteur, en quelque sorte.

Les trois romans de Pierric Bailly sont parus chez P.O.L, Polichinelle et Michael Jackson sont également disponibles en Folio.
Retrouvez notre entretien avec Pierric Bailly ici.
Feuilletez les premières pages de ses romans :





















