[dropcap]C[/dropcap]’est toujours stimulant de commencer l’année avec une naissance. Les éditions Agullo l’ont bien compris, puisqu’elles lancent en ce mois de janvier une collection de textes courts, judicieusement baptisée Agullo Court. C’est avec Yan Lespoux que cette nouvelle série prend son envol, un auteur dont le nom est bien connu des amateurs de romans noirs : Yan préside en effet aux destinées d’un des blogs les plus en vue sur le sujet, encoredunoir.com.
[divider style= »solid » top= »5″ bottom= »5″]LA CHRONIQUE
Presqu’îles parle du Médoc. Pas celui où l’on fait le tour des châteaux et des grands crus, plutôt celui qu’on traverse sur la route de l’océan, en chemin vers le Pays basque, ses plages et ses sites de surf. Une région de pinèdes, de marais, de bruyères, où les nappes de brume dissimulent les champignons aux yeux des touristes, mais pas à ceux des Médoquins. Entre mer, dune et forêt, c’est là que Yan Lespoux a passé toute son enfance. C’est aussi de là qu’il est parti, et c’est là qu’il revient régulièrement, comme aimanté par ses racines, son enfance et son adolescence. La région accueille des touristes l’été, mais ceux-là resteront à jamais des étrangers à cette région : « Un Médoc de forêts de pins, de lacs, de pistes cahoteuses, de chasseurs, de chevreuils, de champignons« , comme l’écrit Hervé Le Corre dans sa préface.
C’est donc à travers 33 textes courts que Yan Lespoux a choisi de donner vie aux habitants de cette région-là, les Médoquins. De relever le défi: raconter une histoire en quelques pages, et, dans une grande économie de mots, animer des personnages et leur choisir un destin, raconter un bout d’existence enraciné en un lieu à la fois à nul autre pareil et universel. Ce n’est pas la moindre des réussites de ce recueil que de saisir la nature humaine tout en l’inscrivant dans une géographie à la fois naturelle et sentimentale. Chassez le naturel : il y a bien quelques cadavres dans les histoires de Yan Lespoux. Mais leurs morts sont tellement absurdes qu’elles suscitent à la fois l’effroi et le sourire, comme si la vanité de la vie des hommes s’inscrivait justement là, entre tragédie et comédie. Dans ces nouvelles-là, tout est dans l’entre-deux, entre mer et dune, sourire et larmes, vie et mort, envie de rester et désir de partir. Et rien n’est jamais sûr.
Le Parisien, c’est une sorte de Bordelais.
Yan Lespoux
En lisant Presqu’îles, j’ai retrouvé un état d’enfance, celui où, petite, je lisais des contes avant de m’endormir, sans pouvoir me résoudre à m’arrêter. Allez, encore un et j’éteins la lumière… Je prends le pari que vous aussi, vous veillerez jusqu’au bout de ces Presqu’îles entêtantes. Au bout du compte, vous aurez l’impression d’être un peu moins étranger à ce pays médoquin. Mais ce ne sera qu’une douce illusion…
[divider style= »solid » top= »5″ bottom= »5″]L’ENTRETIEN

Ces textes, tu les mijotais depuis un moment ou bien tu as tout écrit après avoir conçu l’idée du recueil et de ses thématiques ?
Ils ont été écrits sur 3 ou 4 ans. Au départ, il n’y avait pas de projet. Un jour, je suis rentré chez moi dans le Médoc. Comme d’habitude, je prends des nouvelles de tout le monde, et on en vient à parler d’un type qui était là quand j’étais gamin. Un gars qui avait eu une drôle de vie : il avait tué deux mecs venus le dépouiller… Cette nouvelle-là, qui s’appelle « La loi de l’Ouest », est la seule qui soit pleinement véridique. » Le lendemain, j’ai un message de Caroline Bokanovski, des éditions des Équateurs, qui me dit qu’elle a lu le texte, qu’elle trouve ça bien et qui me demande de lui envoyer le prochain texte. J’en parle à Hervé Le Corre, qui m’incite à écrire d’autres textes. Ce que j’ai fait… J’envoyais mes textes à Hervé au fur et à mesure, et il me disait ce qu’il en pensait. Quand je ne lui en envoyais pas, il me disait que ça faisait un moment qu’il n’avait pas eu sa dose de Médoc ! Au bout d’un moment, j’en ai eu une douzaine et je les ai envoyés à Caroline Bokanovski, qui m’a répondu qu’elle ne publiait pas de nouvelles, mais que si je pouvais développer le texte sur le Cantabria et en faire un roman, ce serait intéressant. Je n’avais pas cette envie-là. Je voulais écrire sur les lieux, les gens, faire une mosaïque de portraits, de situations qui dise ce que c’était que de vivre au quotidien dans cet endroit-là.
Une notion revient tout au long du recueil, celle de l’étranger.
C’est un thème qui me touche personnellement, l’idée de savoir d’où on est, à quel point on est attaché à un endroit, ce qui fait notre particularité. J’ai grandi dans le Médoc, j’en suis parti et j’y reviens régulièrement. Donc je suis de là, et je n’y suis plus… Les choses ont changé, les gens meurent, partent, arrivent… Tu grandis là, à cet endroit, toute l’année, et pendant quelques mois il y a des gens qui arrivent, qui s’installent pour quelques semaines, et tu n’es plus chez toi… En plus ils te disent que tu devrais t’estimer heureux qu’ils viennent car ils te font vivre ! C’est une drôle de dualité.
Quand tu retournes là-bas, tu te sens étranger ?
Je me sens partagé : c’est là que j’ai grandi, c’est là que j’ai ma famille, mais je n’y suis plus. Quand j’y vais, je me sens chez moi avec ceux que je connais depuis toujours, mais je sais aussi que dans le regard des autres qui sont là depuis 5 ou 10 ans, je suis parti.
On te considérerait comme un déserteur ?
Non, en fait tous mes copains d’enfance ou d’adolescence sont partis. Certains sont revenus… On se retrouve toujours avec plaisir. Partir, c’est un peu naturel à un moment… Cela donne des situations un peu bizarres, un peu ambiguës. Quand tu vas aux champignons, tu peux croiser un type qui te dit : « Qu’est-ce que tu fais là, toi? »
Justement, les champignons ont, eux aussi, leur importance dans tes nouvelles.
Paradoxalement, je ne vais jamais aux champignons quand je ne suis pas chez moi. Depuis que j’habite dans l’Aude, jamais je n’y suis allé. Je n’y vais que quand je retourne dans le Médoc…
La végétation, la bruyère, les pins, les champignons : tout cela compose un paysage que les touristes ne connaissent pas forcément.
Eh oui, les touristes traversent, ils ne s’arrêtent pas !
Et la chasse ?
Toute ma famille chasse, je crois que cette région fait partie de celles où on trouve le plus de chasseurs. De mon côté, je n’ai jamais chassé, mais c’est une ambiance dans laquelle j’ai baigné pendant toute mon enfance. La chasse fait partie de la vie quotidienne. Il aurait été impensable de ne pas en parler.
Pour en revenir au paysage, aux dunes, aux arbres, aux nappes de brume, à la faune et à la flore, tout cela occupe une grande importance dans tes histoires, et pourtant Presqu’îles, ça n’est pas du « nature writing » !
Autant j’adore lire des descriptions lyriques de la nature – James Lee Burke et le bayou en particulier – autant ça ne m’intéresse pas de les écrire. Je voulais décrire la nature dans laquelle on vit, pas forcément celle devant laquelle on s’arrête pour l’admirer. Et surtout, je voulais parler des gens d’abord.
Justement, tu as une façon très particulière de détailler les mouvements des personnages. Dans une nouvelle, il n’y a pas beaucoup de place pour développer l’aspect psychologique, donc c’est par leurs gestes qu’ils s’expriment.
Je voulais vraiment faire des textes très courts, du coup, ce qui s’imposait, c’était de décrire des personnes dans leurs actions et à travers leurs mouvements. J’ai vraiment fait attention à cela : les mouvements, les mots, les regards. Il fallait que pour chaque personnage, il y ait un petit quelque chose qui dise ce qu’ils sont.
Et ce travail sur les surnoms, j’imagine que tu t’es bien amusé avec ça, car le lecteur, lui, s’amuse bien. Cette pratique du surnom, est-ce qu’elle est spécifique de la région ?
Non, je crois qu’elle est répandue. Là où je vis, dans l’Aude, je joue à la pelote basque, je fais partie d’un club. Et au fil du temps, je vois émerger les surnoms, c’est très amusant et très naturel. C’est quelque chose qui m’a toujours intrigué, comment les surnoms surviennent.
Tu as un surnom, toi ? Ou peut-être en as-tu un sans le savoir, comme un de tes personnages ?
Non, en fait j’ai un peu hérité de celui de mon père, qu’on appelait le grizzly. Parfois, on m’appelle le petit grizzly, mais ça n’a rien de systématique.
Pour en revenir à cette idée d’étranger, à un moment, un de tes personnages dit : « Le Parisien, c’est une sorte de Bordelais. » Peux-tu développer ?
Le Médoc, c’est un lieu très particulier… C’est aussi pour ça que j’ai voulu faire figurer des citations au début du livre, avec notamment Eric Holder qui venait du nord et qui est venu s’installer dans le Médoc. Si tu vas à Bordeaux, que tu discutes avec des Bordelais et que tu dis que tu es Médoquin, il y a toujours un petit blanc, et souvent une remarque rigolarde du genre « Ah oui, le pays des sauvages ! ». Pour eux, le Médoc c’est un lieu de barbarie où les gens passent leur vie à chasser, à violer leurs enfants… C’est un stéréotype qui existe depuis très longtemps, intégré par les Médoquins eux-mêmes. Une identité collective s’est construite en opposition au voisin. On s’approprie des stéréotypes positifs ou négatifs. C’est un phénomène qui me passionne : j’ai fait mes études à Pau, dans le Béarn, et là-bas, le barbare, c’était le Basque… Je me suis amusé avec ça : décrire la vie des gens sur place, entrecoupée par la vie des « étrangers ». Le Bordelais, le Parisien, l’Arabe, l’Ecolo, le Portugais de Madrid. En fait le Bordelais est détesté partout : dans le Béarn, au Pays Basque, dans le Médoc… Un peu comme le Parisien en fait.
Et le Charentais aussi, une espèce un peu particulière !
Celui-là, il habite de l’autre côté de l’estuaire de la Gironde, il y a donc une frontière naturelle. En plus les Charentais ne parlent pas la même langue : en Médoc, c’est encore l’espace occitan, de l’autre côté de l’estuaire, c’est la langue d’oil. Quand j’étais petit, c’était la légende ! On vivait l’arrivée des Charentais comme l’invasion des Huns : ils arrivaient en masse pour ramasser en masse les bidaous qu’ils revendaient après, et ils repartaient aussi vite qu’ils étaient venus. On repérait les plaques des voitures : des 17 partout…
Dans tes nouvelles, les morts sont particulièrement absurdes. Tellement qu’on en oublie d’être triste.
Pour moi, c’est le reflet de l’absurdité de la vie et de la mort. Je ne sais pas s’il y a des morts intelligentes.. Mais parfois, elles font rire, effectivement. Dans ma famille, ils sont tous chasseurs et il y a aussi beaucoup de pompiers. J’ai grandi avec des histoires d’accidents, parfois particulièrement étranges.
Et cette histoire de premier noyé de la saison ? Elle est présente dans Presqu’îles, mais elle semble être importante pour toi, tu l’évoques parfois dans tes statuts Facebook…
Chez nous, c’était un événement, une sorte de rituel d’ouverture de saison. C’était LE sujet de conversation dès le mois d’avril, les premiers beaux jours. Les gens arrivent, ils partent en pédalo et ils meurent d’hydrocution parce qu’en avril, l’eau est quand même froide…
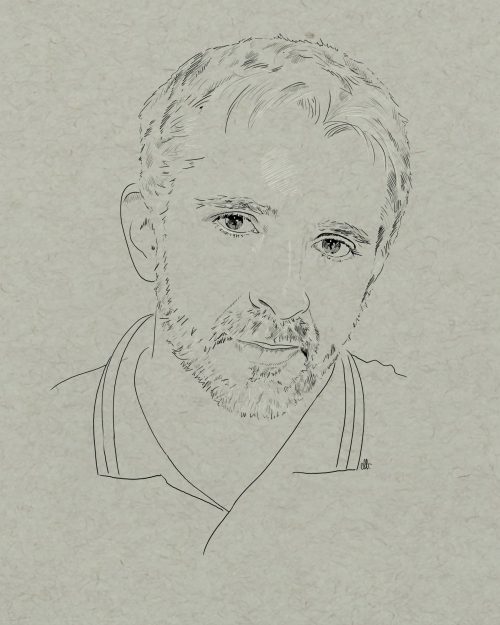
Pour en revenir au surnom, tu n’as pas peur qu’on t’appelle l’Écrivain, maintenant ?
On verra, ce serait rigolo… C’est vrai que je me suis posé la question.
Tout de même, toutes ces vies qui se fracassent dans l’absurdité, c’est une approche typiquement noire. Et puis tu fais aussi appel à un contexte historique – naufrageurs, incendiaires, etc.
Je ne voulais pas spécialement me raccrocher à ce contexte-là, mais montrer qu’en fait les destins dont je parle peuvent survenir partout. L’idée que les choses changent, que c’était mieux avant, ou pas. Que le changement n’est pas forcément bon. Comme dans l’histoire de ce vieux qui discute au café, qui voit la nécrologie de son copain dans le journal, et qui rentre chez lui dans sa bicoque toute pourrie, au beau milieu d’un lotissement flambant neuf. Il y a ceux qui arrivent à sauter dans le train en marche, et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas. Comment ceux-là vivent-ils ? Je rattache tout cela à des lieux parce que je les connais intimement, tout simplement.
Il y a aussi une approche souterraine de ces vies-là : les incendiaires, les naufrageurs, les cultivateurs et les voleurs de weed…
Ces choses-là arrivent partout, mais surtout dans les régions sinistrées économiquement. L’incendiaire, c’est un cas un peu particulier : il se sent dépossédé de chez lui. Il devient incendiaire malgré lui, en quelque sorte. Les naufrageurs, c’est lié aux stéréotypes qu’on évoquait tout à l’heure. C’étaient souvent des bergers qui s’étaient spécialisés dans le pillage des épaves. Quant à ceux qui volent les plants de cannabis, c’est devenu une vieille pratique, c’est plus lucratif que les champignons. Dans ces régions-là, où il n’y a pas de boulot en-dehors de quelques jobs saisonniers, les gens trouvent des expédients, de quoi joindre les deux bouts. Certains font pousser le truc, les plus paresseux le volent. Même chose pour les canards… Les gens essaient de s’en sortir et ils le font avec plus ou moins de panache ou d’efforts.
Tes deux personnages féminins sont vraiment au bout du bout… Et en plus toutes les deux vivent et/ou meurent au milieu des champignons !
Il n’y avait pas d’intention, c’est sans doute mon inconscient qui travaille… On va peut-être m’appeler le Mycologue, finalement ! Quand je suis arrivé dans l’Aude, des tas de gens arrivaient là parce que tout est moins cher, qu’il y a le soleil. Et puis l’hiver, ils s’aperçoivent que c’est dur, qu’il n’y a pas de travail, qu’il faut absolument avoir une voiture… C’est un mirage. Cette fille et ses champignons, c’est ça, c’est un mirage. Elle se rappelle ses vacances de petite fille, elle revient sur les lieux, et là le rideau se déchire. Dans le grand quart Sud-Ouest où j’ai vécu, c’est un phénomène de plus en plus fréquent.
On trouve deux petites incursions dans le monde de la musique : ta nouvelle sur le chanteur et celle sur le concert des Pogues. Celle sur le chanteur est particulièrement cruelle : pourquoi ?
Cette histoire est une extrapolation à partir d’une observation. Dans la région vivait un ancien chanteur qui avait connu un ou deux succès, mais il était devenu une espèce d’épave. Je l’ai croisé deux ou trois fois, et ça m’avait marqué : il était incapable de sortir de son passé, d’avancer… Alors j’ai extrapolé, je lui ai inventé une grosse bagnole américaine. Je ne voulais pas juger, et surtout pas être plus cruel envers lui. J’ai voulu être le plus juste possible. On a tous nos qualités, nos dons ou notre absence de dons et on essaie d’avancer, d’avoir un peu de bonheur, et on prend des chemins différents. Et puis parfois, on n’a pas de chance, tout simplement. Ce chanteur, je ne voulais pas le juger, juste le regarder
On est écartelé entre l’attachement aux racines et le désir de partir. Et on a finalement l’impression que notre destin ne dépend pas du fait qu’on reste ou qu’on part.
Exactement. En fin de compte, je pense que ce n’est pas nous qui choisissons : les circonstances le font à notre place. Face aux gens qui affirment qu’ils ont choisi de rester, ou de partir, je suis toujours dubitatif. On est ballotté par la vie qui nous amène là ou ailleurs, ça se passe plus ou moins bien, et voilà. C’est lié à ma perception de la vie et de son absurdité.
Tu te positionnes un peu entre les deux puisque tu reviens souvent vers tes racines, même si tu vis ailleurs.
C’est vrai, mais je ne sais pas vraiment quelle est ma place. Dans la dernière nouvelle du recueil, celle de l’enterrement, c’est de cela que je parle.
Pour terminer, évoquons le concert des Pogues SANS Shane MacGowan. Là encore, on est en absurdie ! Surtout quand on s’aperçoit que parmi la bande de potes qui se réjouit d’aller au concert, la plupart ne sait même pas qui ils sont…
Ce concert a existé, j’avais envie d’en parler. C’est un souvenir fort, et c’est un des derniers textes que j’ai écrits. La structure commençait à prendre forme, j’ai écrit celui-là et celui sur le gars qui tombe amoureux d’une fille qui, finalement, part avec un joueur de djembé. J’avais envie de parler de l’adolescence, de la façon dont on vit l’adolescence dans ces lieux-là : tu es à la fois dans un espace d’une immense liberté, tu peux aller à l’océan, dans les bois. Et en même temps, tu es enfermé là. Tu as la sensation que rien ne peut arriver de bien, que tout foire : ce concert des Pogues, c’est ça. J’avais envie de parler de toutes les périodes de la vie : l’enfance, l’adolescence, la vieillesse.
Comment as-tu choisi l’ordre des nouvelles ?
J’y ai beaucoup réfléchi. J’essayais de voir, au fur et à mesure que j’écrivais, les thèmes qui revenaient. Je ne voulais pas qu’il y ait plusieurs textes « plombants » d’affilée, j’ai voulu équilibrer les ambiances, distinguer différentes thématiques qui se reflètent dans les titres des différentes parties. A posteriori, j’ai essayé de les placer dans un ordre qui me semblait logique. La structure est une sorte de pyramide en miroir : Les règles, Etre d’ici, Etrangers, Intermède, Noyades, La vie en face, Intermède musical, et puis on redescend avec Etrangers (2), Etre d’ici (2), Les règles (2), S’en aller, revenir.
Je suis toujours perplexe face à des nouvelles : comment parvient-on à s’arrêter, à conclure ? Comment décide-t-on de raconter une histoire en deux pages ?
Moi, mon plus gros travail, c’est plutôt d’en rajouter ! Naturellement, je suis plutôt dans la brièveté, j’aime bien aller droit au but, je n’aime pas trop les fioritures. Mais bien sûr, il n’y a pas de modèle pré-établi. Certaines nouvelles viennent d’un souhait simple : pour « Le noyé », par exemple, je voulais tout simplement écrire une journée parfaite à l’océan. Et puis très vite, un cadavre a débarqué… En revanche, certaines autres me sont venues par leur fin : je voulais arriver à une chute, une conclusion bien précise. Parfois j’ai la fin, parfois j’ai le début, parfois c’est une idée générale. Mais globalement, je voulais des choses qui soient un peu percutantes.
Y compris dans les chutes, j’imagine ?
Là encore, c’est très différent. Parfois il faut que je travaille à mes chutes, parfois elles s’imposent. Il y a très peu d’histoires où j’avais un fil, du début à la fin. En fait, j’ai surtout retravaillé les entrées en matière : une fois rentré dans le texte, ça va ! J’adore les textes courts. Ces dernières années, j’ai été extrêmement impressionné par le travail de Larry Fondation, son fonctionnement en flashes, et aussi par les nouvelles de Larry Brown. Evidemment, je n’ai pas essayé d’arriver au niveau d’épure de Fondation, mais je voulais qu’on entre vite dans le texte, et qu’on en sorte vite aussi. Et si on considère les textes de Fondation, on s’aperçoit qu’ils forment un ensemble cohérent. C’est ce que je voulais obtenir avec Presqu’îles : que ces histoires forment un tout. Au fur et à mesure que j’écrivais, au cours des relectures aussi, j’en ai écarté quelques-unes : je voulais avoir des petits fils conducteurs entre chaque texte (les champignons, les noyés, les surnoms, la Vierge phosphorescente…) et j’ai donc écarté ceux qui étaient en rupture.
Et le titre, comment l’as-tu choisi ?
On voulait quelque chose de court. Le Médoc, c’est considéré comme une presqu’île. Va pour Presqu’île. C’est Hervé Le Corre qui a suggéré qu’on ajoute un s, pour mieux rendre compte à la fois de la multiplicité et de l’unité de ces textes.
Quel effet cela fait-il de devenir écrivain ?
J’ai eu l’immense chance d’être bien entouré, comme je te le disais au début de notre conversation. J’étais content d’avoir écrit ces textes-là… Et puis finalement Sébastien Wespiser, des éditions Agullo, a voulu les publier. Agullo ne publiait pas de nouvelles, du coup ils ont créé une collection de « courts » baptisée… Agullo court. Et voilà, j’inaugure la série et j’en suis heureux parce qu’au final, c’est aussi une belle aventure entre copains. J’ai beaucoup de chance.
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
[one_half]
Presqu’îles de Yan Lespoux
Préface d’Hervé Le Corre
Collection Agullo Court
Agullo, janvier 2021
[button color= »gray » size= »small » link= »http://www.agullo-editions.com/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/AgulloEditions » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/agulloeditions/?hl=fr » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/Agullo_Ed » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]
[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]




















