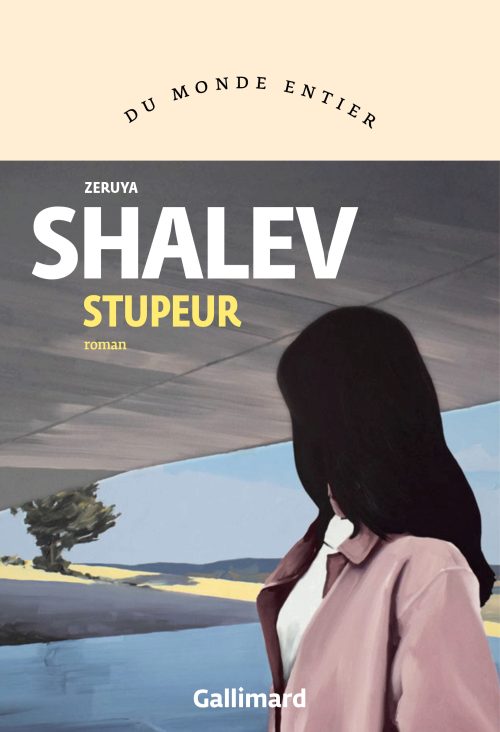Il n’était pas simple de commenter le dernier ouvrage de Zeruya Shalev lors de la rentrée littéraire d’automne alors que le contexte géopolitique plaçait une nouvelle fois cette portion inflammable de la planète au devant de l’actualité. Cela ne l’est sans doute pas beaucoup plus après plus de cinq mois de conflit et face à une situation humanitaire catastrophique. J’ai néanmoins retrouvé l’envie de me plonger dans Stupeur, et de rendre ainsi hommage, aussi, aux courageuses positions prises par Zeruya Shalev dénonçant dès le début du conflit « les seules divisions possibles au Moyen-Orient. Non pas entre les juifs et les arabes, mais entre les modérés et les extrémistes, entre les pragmatiques et les fanatiques » (Le Monde 11 octobre 2023).
Zeruya Shalev
est passée maître
dans l’exploration
de l’âme humaine.
Et c’est d’ailleurs, on le sent, toujours un peu malgré elle, malgré une envie parfois intense de tenir le passé et le présent de son pays un peu sur la marge, que l’histoire d’Israël s’infiltre insidieusement dans les romans de Zeruya Shalev et ce de manière de plus en plus intense, parution après parution. Car avant d’êtres des israéliens aux prises avec la grande histoire, les héros des romans de Zeruya Shalev sont en premier lieu des hommes et des femmes aux prises avec leurs vies. Il ne faut d’ailleurs que quelques pages à chaque fois pour découvrir, ou se rappeler, que l’écrivaine israélienne est passée maître dans l’exploration de l’âme humaine et que ses profondeurs y sont sondées avec une pertinence folle et une certaine délectation.
Lire un roman de Zeruya Shalev c’est un peu comme rentrer en soi-même, accepter que le roman projette en vous ses questions, ses analyses qui, disséquant au sclapel les ressorts de l’agir des personnages, font aussi de jolies et belles incisions dans nos cerveaux abasourdis de tant de clairvoyance. Avec Stupeur, c’est dans la psyché de deux femmes que nous allons ainsi nous immerger. Deux femmes qui n’auraient jamais dû se rencontrer puisque Mano qui vient de s’éteindre est le père de la plus jeune, Atara, mais qu’il fût aussi le premier mari de l’autre, la très vieille Rachel avant de la renier, sans condition et surtout sans explication il y a plus de soixante-dix ans. C’est pourtant sur les silences et les non réponses de Mano, cultivés avec une fille qu’il aura mal-aimée et avec une femme qu’il aura rejetée, qu’un fragile pont pourra être jeté. Car au moment de mourir alors que c’est Atara qui est à son chevet, c’est à Rachel qu’il va s’adresser, rendant inévitable leur rencontre.
« Elle a prétendu dormir, et maintenant, le sommeil lui tourne le dos, s’éloigne, s’est-il envolé pour toujours, lui aussi ? Elle a l’impression que, jusqu’à son dernier souffle, elle ne dormira plus. Que ses paupières gèleront, laisseront ses yeux écarquillés se dessécher et finir par se détacher de leurs orbites puis tomber tels des fruits pourris. Ce sera sa punition pour s’être dérobée à son invitée, pour avoir flanché, exactement comme il avait flanché, lui, à l’époque. Car elle aurait pu trouver un prétexte pour se débarrasser de son fils, ou proposer à la fille de Mano d’attendre qu’il s’en aille en s’installant un petit moment dans un café du centre commercial. Mais, par peur, elle a simulé l’indifférence.
Insupportable et inacceptable, voilà ce que c’était. Une tranche de vie amputée, une parenthèse qui a voltigé pendant des années, et un beau jour, voilà qu’elle atterrit devant ta porte et t’oblige, en tes vieux jours, à revenir à des temps anciens qui n’ont abouti à rien. »
─ Zeruya Shalev, Stupeur
Approchant acrobatiquement Rachel, Atara va découvrir que celle-ci et son père ont été des terroristes du Lehi (Lohamei Herut Israë), engagés contre la domination britannique au Moyen-Orient et qu’ils ont donc fait parti de ce mouvement sioniste non religieux, dans un moment de l’histoire israélienne peu commenté auprès des nouvelles générations. Mais cette première rencontre entre les deux femmes, ce premier carrefour, n’est qu’un des multiples embranchements, une des multiples ramifications tissées par l’histoire des personnages de ce roman. Habitant en effet des villes différentes, représentant des convictions ou des polarités politiques différentes chacun d’eux va apporter, via son parcours, une touche d’une couleur particulière, formant ainsi sous nos yeux une mosaïque complexe à l’image des fragmentations de la société israélienne. Que ce soient les enfants d’Atara issus de deux mariages dont « l’enfant paradis » Eden qu’elle a eu avec Sander son mari actuel, ou les enfants de Rachel, militant de gauche pour l’un et adepte des Hassidim de Braslav pour l’autre, ils représentent tous une minuscule pièce d’un immense puzzle.
Aussi quand Atara est propulsée au cœur d’un brusque événement dramatique , l’histoire des protagonistes semble se poursuivre comme autant de trajectoires diffractées dans le tube d’un kaléidoscope. Enfermées dans leurs interrogations, dans leurs pensées, Atara et Rachel à qui Zeruya Shalev donne alternativement la voix au fil des chapitres questionnent leurs choix et leurs décisions, passées et futures. Comment se libérer d’un passé qui reste un mystère, comment réparer des blessures anciennes, ou comment assumer les conséquences de nos assentiments ou de nos refus? Et c’est en effet l’impensable qui va obliger chacun des personnages à aller chercher au plus profond de lui-même des ressources, des repères, pour pouvoir continuer et savoir comment agir. Le juste ou le bien, ne leur sont désormais plus immédiatement donnés, mais ils se doivent d’être reconstruits. Le roman tendu jusqu’à son terme par un suspens intense met enfin en scène un personnage inattendu, l’espace. Celui qui sépare les hommes et les femmes établis dans des zones différentes, celui du Wadi qu’Atara observe inlassablement depuis sa maison, et celui qui nous tient éloigné de l’autre en vertu de nos croyances ou de nos convictions. C’est donc à une recomposition de cet espace que les derniers carrefours, embranchements ou changements de cap de l’intrigue vont servir, afin pour chacun de presque tout reprendre au début; comme le fit Rachel après l’abandon de Mano, comme le fit Atara quand elle quitta son père, comme nous devons tous le faire à chaque fois que l’existence nous propose une ligne brisée plutôt qu’une ligne droite.