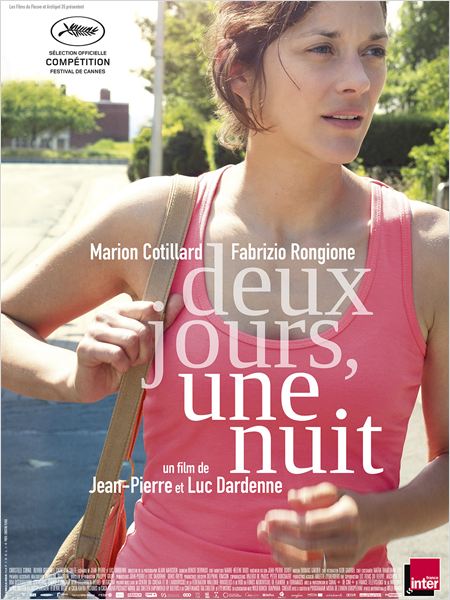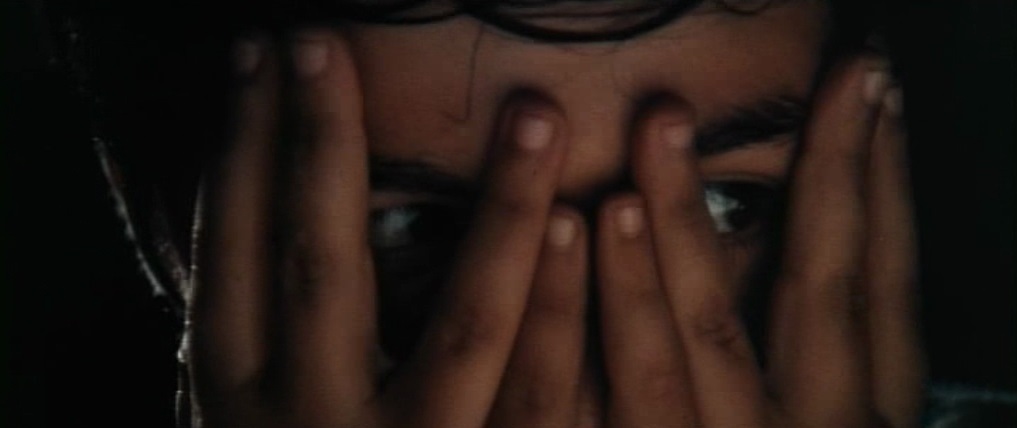[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#d91616″]J[/mks_dropcap]ean-Pierre Melville est sans conteste le chef de file du film noir à la française. Pourtant, peu d’ouvrages lui ont été consacrés alors qu’il est admiré et étudié en France comme à l’étranger. À l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, rétrospectives et sorties de DVD se multiplient, et c’est tant mieux. Ce livre est particulièrement bienvenu, puisqu’il existe finalement assez peu d’ouvrages disponibles dédiés à ce cinéaste majeur.
Antoine de Baecque a pris le parti de la biographie, abordée sous l’angle multiple du « portrait en huit poses », une tâche ardue puisqu’il s’agit de brosser le portrait d’un homme qui réussit le tour de force de réunir les suffrages des cinéphiles et ceux des amateurs de cinéma populaire. Huit angles donc, correspondant chacun à une tranche de vie du metteur en scène dont l’existence, ponctuée de zones d’ombre soigneusement ménagées, constitue à elle seule un véritable film noir…
Au fil des chapitres, généreusement illustrés de superbes photos dont certaines sont inédites, le texte dévoile, en même temps que l’évolution du cinéaste, ses thématiques majeures, voire ses obsessions.
Tout commence avec l’enfance du petit Jean-Pierre Grumbach (le vrai nom de Melville), né en 1917, et qui reçoit pour le Noël de ses six ans… une Pathé-Baby à manivelle. Les caméras se succèderont entre les mains de l’enfant, puis de l’adolescent parisien qui choisira comme premier mentor son oncle Arthur Grimbach, antiquaire de renom, introduit dans les milieux du music-hall.
Parallèlement au cinéma, le jeune Jean-Pierre se construit une culture littéraire, avec une préférence pour les romans policiers, de Fantômas à Dashiell Hammett. Il devient un cinéphile passionné, passe ses journées au cinéma, et se forge une solide culture cinéphilique en même temps qu’une esthétique personnelle.
L’arrivée de la Seconde Guerre mondiale va constituer une étape décisive : le jeune Grumbach sera combattant et résistant. C’est au moment de son engagement très précoce qu’il adoptera son nom de résistant : Melville, qu’il gardera jusqu’à la fin. Melville combattra de 1937 à 1945. Il perdra son frère Jacques en 1942, abattu lors d’une mission qui consistait à transporter une somme d’argent à destination du Général de Gaulle… La guerre, la résistance, le combat : autant de thèmes auxquels Melville restera fidèle, du Silence de la Mer à L’Armée des Ombres.
Melville dira d’ailleurs : J’ai tenu absolument à ce que Le Silence de la Mer soit mon premier film.
Autre période marquante pour lui : la pré-nouvelle vague et la nouvelle vague. Il dira carrément en 1962 : La Nouvelle Vague ? Je l’ai inventée en 1937. Premier film en décor naturel, avec des acteurs inconnus : en effet, Le Silence de la Mer, tourné en 1947, correspond bien aux critères.
Entre 1947 et 1959, Melville vit une traversée du désert. Mais, rétrospectivement, se dit plutôt satisfait d’avoir mangé de la vache enragée… Même s’il nourrit envers cette nouvelle vague une rancœur durable, malgré son amitié passionnée avec Jean-Luc Godard – lien rompu brutalement pour des raisons restées floues… Sa carrière redémarre difficilement avec Les Enfants Terribles, d’après Cocteau, sorti en 1950.
Puis, c’est Quand tu Liras cette Lettre, qui sort en 1953 et réunit à l’écran Juliette Gréco et Philippe Lemaire, tous les deux à contre-emploi. Un mélodrame grâce auquel il compte, avec un brin de cynisme, renouer avec un public populaire, et surtout gagner suffisamment d’argent pour acheter les locaux du XIIIe arrondissement qui deviendront les mythiques studios Jenner. 1000 m2 de terrain vague. Le premier film qu’y tournera Melville sera Bob le Flambeur. Les studios brûleront intégralement en juin 1967 et Melville perdra ses archives, ses photos, des livres et des scénarios non réalisés.
À l’époque, il est en plein tournage du Samouraï, premier film avec Alain Delon qui retrouve dans l’œuvre de Melville le rôle joué un temps par Belmondo, transfuge de Godard, dans Léon Morin Prêtre, Le Doulos et L’Aîné des Ferchaux, qui marquera la brouille entre les deux hommes. Il faut dire que Jean-Pierre Melville a un sacré caractère… Il enchaîne les disputes, les portes claquent, Ventura, pendant le tournage de L’Armée des Ombres ne communiquait avec lui que par l’intermédiaire d’un assistant.
Personnalité complexe, ombrageuse, jalouse : Melville est à l’image de ses films, tout d’ombre et de lumière. Solitaire, il s’enferme volontiers dans son bureau, à l’écart de tout, tous rideaux fermés. Politiquement, l’image est brouillée : Je me sens plutôt anarchiste qu’anticonformiste. Disons que je suis anarcho-féodal, dira-t-il au mensuel Galerie en décembre 1970.
Jean-Pierre Melville, une vie fait aussi la lumière sur la fascination exercée sur le cinéaste par les États-Unis et leurs metteurs en scène. Il connaît bien les États-Unis, il y a beaucoup voyagé, et s’approprie aisément l’esthétique particulière des grands films noirs, notamment The Asphalt Jungle de Huston, qu’il adapte avec talent à sa propre vision sombre, solitaire, stylisée. Deux Hommes dans Manhattan, puis L’Aîné des Ferchaux, seront en partie tournés aux États-Unis.
L’auteur du livre observe : Le film montre comment deux villes se superposent, la ville-plan mentale de Melville, abstraite et rigoureuse (…) et la ville-cadre enregistrée par la caméra sur la peau même de Manhattan... Deux films qui seront des échecs à leur sortie : salles vides, mépris de la critique… Ces déceptions constitueront un autre tournant dans la carrière de Melville.
La sixième partie du livre s’appelle « Le maître du polar », et on y apprend que Melville fréquentait volontiers le milieu, et entretenait même des relations avec des prisonniers. De la vie au cinéma… Le Doulos, Le Deuxième Souffle, Le Samouraï : Melville affirme ses marques, donne corps à son amour du polar à la fois pour son goût du genre et pour l’aspect formel spectaculaire et le mode de récit simple et populaire. Stylisation des décors et des costumes, emprunts à l’esthétique hollywoodienne avec les fenêtres à guillotine, les trench-coats à la Bogart, les chapeaux : la parenté est évidente et délibérée. Solitude, trahison, fatalité du destin : tout est là… Le charme du héros melvillien est violemment crépusculaire.
Antoine de Baecque n’hésite pas à relancer le débat du parallèle entre Melville et Bresson, qui agaçait prodigieusement Melville puisqu’on lui prête volontiers la réplique : Désolé, c’est Bresson qui fait du Melville ! Le personnage du Samouraï incarné par un Delon glacial, dépourvu d’émotion, est emblématique de l’image que laissera Melville dans l’esprit des cinéphiles.
Les trois derniers films du cinéaste, L’Armée des Ombres (1969), Le Cercle Rouge (1970) et Un Flic (1972) accentueront encore le pessimisme absolu qui émane de son œuvre. L’ouvrage considère que Le Cercle Rouge est le « film-somme » de son auteur, avec ses trois personnages (Bourvil, Delon, Montand) pratiquement statufiés dans leur solitude, chacun de leur côté du bien et du mal. L’inexorable, le destin, l’absence totale de douceur et de tendresse, traduite par l’absence totale de femmes dans le film, la performance d’acteur d’un Bourvil malade, bouleversant… tout est là pour faire du Cercle Rouge l’apogée de la carrière d’un cinéaste singulier. Le film rencontre un véritable triomphe, à la fois public et critique.
C’est encore avec Delon que Melville tournera son prochain et dernier film, Un Flic, troisième volet d’une trilogie où Delon incarne un flic à la marge, qui partage une amitié trouble avec un trafiquant de drogue patron de night-club, et une tendresse amoureuse avec Cathy (Catherine Deneuve). Là où Le Cercle Rouge avait étonné par sa maîtrise esthétique mais aussi scénaristique, Un Flic surprend, voire déçoit, car visiblement Melville a voulu faire la part belle au style, au détriment du scénario… Melville est amer, déçu par le semi-échec du film, mais s’attaque néanmoins à un nouveau scénario, où Montand est supposé incarner un détective privé. Le 1er août 1973, il dîne avec son ami Philippe Labro et s’effondre, victime d’une rupture d’anévrisme, dans sa 56e année.
Les derniers chapitres se penchent sur la gloire posthume du cinéaste. Devenir immortel… et puis mourir, tel était le désir de Jean-Pierre Melville. Les influences plus ou moins revendiquées se multiplient (de Fassbinder à John Woo en passant par Kaurismäki, Tarantino, Jarmusch, Jacques Audiard…). Cinéastes américains et asiatiques s’emparent de son style, se réclament de lui. Scorsese lui voue une admiration sans limite.
Le grand mérite de ce livre est de permettre aux cinéphiles de revivre la naissance, l’essor et l’apogée d’un cinéaste hors normes, grâce à un texte à la fois informatif et vivant. On appréciera au passage le grand format de l’ouvrage, qui permet une mise en valeur remarquable des photos superbes qui l’illustrent.
Pour conclure par une touche pratique, si vous ne savez pas quoi offrir à un(e) ami(e) cinéphile, voilà l’idée parfaite !
Jean-Pierre Melville, Une vie, de Antoine de Baecque
Le Seuil – 12 octobre 2017