[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]es livres des éditions Zulma se reconnaissent au premier coup d’œil. A leurs couvertures bien sûr, qui se déclinent en couleurs et en formes subtiles depuis 2005 grâce au « flair » de Laure Leroy et au talent du graphiste David Pearson.
A leur contenu surtout : Zulma nous fait connaître les littératures du monde entier, avec un discernement et un goût certain, qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à Laure Leroy, la directrice éditoriale de la maison. Douze livres par an, douze romans parfaitement édités et traduits, présentés à leurs lecteurs fidèles dans une robe de papier d’une élégance unique et inimitable. Laure Leroy a bien voulu nous recevoir et nous parler de sa conception de l’édition. Un grand merci à elle.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de Zulma ?
La maison a été fondée en 1991, puis refondée en 2006. Cette date correspond à un changement dans la ligne éditoriale, et aussi au choix du graphiste David Pearson pour les couvertures. Au bout de 15 ans, j’ai eu envie de faire table rase, de regarder ce qui était bien et ce qui l’était moins, de relancer la maison. Quand Zulma a été créée en 1991, j’avais 23 ans. A cet âge-là, on a plein de courage et d’envies, on veut s’essayer à plein de choses. En 2006, j’ai eu la sensation que je pouvais avoir une proposition différente, plus structurée. Dès 2005-2006, l’idée a été de publier peu de livres et en même temps de développer une grande ouverture sur le monde, qu’il s’agisse de littérature française ou du monde entier. J’ai aussi voulu travailler sur des langues moins traduites, trouver des voix nouvelles et passionnantes. Des voix uniques pour dire le monde et sa diversité, une manière de raconter, une vraie histoire, une sensibilité. C’était donc un grand écart sur le plan éditorial, simultanément à la décision de limiter le nombre de livres publiés chaque année. Avant, je publiais de très bons auteurs, des essais également, mais cela ne cadrait plus dans le nouveau projet. Là, pas de théâtre, pas de poésie, pas de sciences humaines, pas de littérature de genre. Mais de la fiction, romans et nouvelles. Je ne voulais plus courir plusieurs lièvres à la fois mais, très précisément, faire découvrir en France ces voix du monde.
Comment décririez-vous la différence de démarche entre la publication d’une traduction et celle d’une œuvre francophone ?
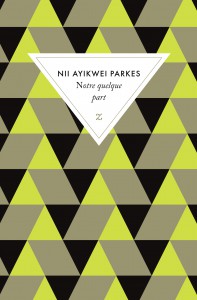
Le travail de prospection, déjà, est radicalement différent. Dans la mesure où je publie très peu d’auteurs anglo-saxons, je travaille énormément avec les traducteurs. Mon travail va être de trouver le bon traducteur, celui avec lequel j’ai de vraies affinités littéraires et avec qui je m’entends bien. Celui-ci va faire le passeur pour me faire découvrir des œuvres qui n’ont pas été traduites en français et pour lesquelles je pourrai m’enthousiasmer.
Est-ce pour cela que sur votre site, on peut faire une recherche par traducteur, ce qui est rare ?
Oui, exactement. Ce livre-là, par exemple (Notre quelque part, de Nii Ayikwei Parkes), est le premier roman d’un jeune auteur ghanéen : c’est la traductrice Sika Fakambi qui me l’a proposé. Ce livre a été très remarqué pour la qualité de sa traduction, puisqu’elle a obtenu le Prix Laure Bataillon et le Prix Baudelaire de la traduction. C’est un livre que j’aurais adoré si je l’avais découvert toute seule, mais j’aurais été bien embêtée pour la traduction. Car c’est un texte qui se caractérise par un jeu sur la langue, sur les différents modes de communication dans un petit village du Ghana où les gens peuvent se parler en anglais, en pidgin ou en twi, la langue qui est pratiquée dans ce village. C’est donc Sika Fakambi qui m’a proposé ce roman, apportant du même coup le problème et la solution.
En janvier 2017, nous publions le premier volume d’une tétralogie traduite de l’indonésien. Même chose, cela fait plusieurs années que je recherchais les ayants droit de cet auteur-là, Pramoedya Ananta Toer, et en même temps je cherchais à qui j’allais pouvoir confier cette traduction une fois le problème des ayants droit résolu.
Justement, comment avez-vous connu cet auteur-là?
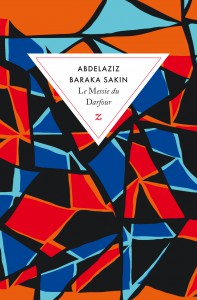
On dit toujours que la France publie beaucoup plus de traductions que d’autres pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. C’est vrai au sens où on publie des auteurs et des œuvres auxquels on offre une véritable réception. En revanche, on trouve de nombreux textes d’auteurs écrits dans une grande variété de langues qui sont traduits en anglais, même s’ils ne sont pas vraiment publiés. Ces traductions anglaises permettent d’en prendre connaissance. L’année dernière, j’ai publié Le Messie du Darfour, d’Abdelaziz Baraka Sakin, traduit de l’arabe par Xavier Luffin. C’est Xavier Luffin qui m’a contactée pour me proposer deux ou trois auteurs soudanais et érythréens. Il avait traduit quelques pages de chaque auteur. A un moment, je me suis prise de passion pour Abdelaziz Baraka Sakin. J’ai pu lire en anglais deux de ses romans, l’un qui était traduit mais non publié, l’autre qui était publié chez un microscopique éditeur, tellement microscopique qu’on ne le trouve même pas sur Amazon.
En revanche, le roman indonésien de Pramoedya Ananta Toer est, lui, publié chez Penguin, et j’ai pu le lire sans difficulté. Mais il y a de nombreux textes traduits du tamoul, par exemple, auxquels on peut accéder grâce à leur version anglaise. Il existe en Inde un système qui assure la traduction en anglais des principaux textes. Ils ne sont pas forcément faciles à trouver, mais c’est néanmoins faisable… C’est grâce à cela que certains de ces textes parviennent jusqu’à nous, ou encore grâce aux traducteurs.
Douze titres par an, c’est relativement peu… J’imagine que vous éprouvez plus de douze coups de foudre littéraires par an ?
Oui, c’est vrai. Mais il y a d’autres facteurs. J’ai cherché pendant longtemps un auteur indonésien. A chaque lecture, je retombais sur Pramoedya Ananta Toer… Ma quête a consisté à trouver les ayants droit de cet auteur-là. Les démarches ne sont pas faciles, donc le coup de foudre ne suffit pas, il faut aussi pouvoir trouver, faire traduire, publier. Le pacte, pour moi, c’est d’offrir au public ce que j’aime. Et pour publier ce que j’aime, c’est parfois un long parcours. Qui, encore une fois, passe souvent par les traducteurs. Et puis j’aime des choses assez variées : ce sont des livres qui m’ont touchée, que j’ai trouvé marquants. Mais je ne considère pas que je ne publie que des chefs d’œuvre ! En revanche, je publie des livres forts, qui vont vous toucher, vous émouvoir, changer votre regard sur le monde, qui peuvent prendre leur place dans notre bibliothèque imaginaire, dans notre monde constitué de toutes ces voix d’écrivains, tous ces univers qui coexistent. Ça ne veut pas dire que c’est un chef d’œuvre, mais c’est un beau livre, un bon livre, qui va vous donner du plaisir, qui possède une vraie richesse d’émotion, de langue, de regard. Tout cela pour dire qu’on peut être sous le charme d’un livre, totalement bluffé ! Mais ça n’est que le début: après, cela prend beaucoup de temps.

Ce fameux pacte que je signe avec le lecteur passe aussi par le questionnement de ceux avec qui je partage des affinités littéraires. Souvent, je demande à ces personnes-là : « Mais toi, qu’est-ce que tu as vraiment aimé? » Si on s’adresse à un agent littéraire ou à un confrère éditeur, on n’a pas cette démarche-là. Ils vont parler d’un livre qui a bien marché, qui a eu de bonnes critiques. Ils ne vont pas me dire ce qu’ils ont vraiment aimé, ce qui les a vraiment touchés personnellement. Donc avant de réussir à trouver, dans la masse des propositions, le texte qui a une vraie vibration humaine, littéraire, poétique, cela demande un travail de fou ! Alors que si je vais voir directement quelqu’un avec qui je sais avoir des affinités, c’est beaucoup plus rapide. Cette personne peut d’ailleurs être un agent littéraire… Par exemple, j’échangeais avec l’agent littéraire de l’auteur israélien Benny Barbash; elle a commencé à me décrire les nouveautés qu’elle avait à proposer pour l’année. Je l’ai arrêtée : « Pourquoi ne me parlez-vous pas plutôt d’un livre sorti il y a 10 ans et que vous n’avez jamais vendu en France? » Et elle m’a parlé de Benny Barbash, un auteur auquel elle était très attachée, dont elle se souvenait encore 10 ans plus tard. Depuis, j’ai publié 4 ou 5 livres de cet auteur.
Alors évidemment, pour les auteurs français, c’est tout à fait différent. Il n’y a pas d’intermédiaire. Ce que vous voyez là, la pile appuyée sur mon bureau, ce sont tous les manuscrits que j’ai reçus depuis fin octobre…
Lire des manuscrits, est-ce que cela constitue la majorité de votre travail ?
Non, pas du tout. 90% de mon travail, c’est d’aboutir un projet et de le porter, de le diffuser, de le faire connaître. D’où la volonté de ne publier que 10 à 12 livres par an. J’ai besoin de maîtriser le travail éditorial. Effectivement, je peux avoir 25 coups de foudre, mais soit j’embauche 3 personnes de plus, soit je les publie par-dessus la jambe sans avoir le temps de les promouvoir.
Comment vous situez-vous dans le monde éditorial actuel, laminé par le marketing, la rapidité, le zapping ? On a l’impression que vous incarnez tout le contraire: la pérennité, la curiosité…

Nous ne faisons pas d’énormes best-sellers, mais nous faisons beaucoup de « long sellers », des livres qui marquent les esprits et les lecteurs, qui créent un attachement. Nous n’avons pas forcément un déferlement médiatique autour de nos publications, il est donc capital pour nous de savoir créer ce lien-là. Au Salon du livre par exemple, beaucoup de visiteurs viennent nous voir et nous disent : « Ah, vous êtes ma maison d’édition préférée… » En fait, on s’aperçoit parfois que ces visiteurs-là ont lu 4 de nos livres, c’est tout. Il faut donc démultiplier le nombre de lecteurs qui ont lu 4 de nos livres pour réussir à faire vivre une maison d’édition. A l’échelle d’un lecteur, 4, c’est beaucoup !
Vous avez une identité très forte, tant en termes de contenu que de contenant. Quand, comme cette année avec Marcus Malte et son Garçon, vous obtenez le Femina, j’imagine que c’est très important pour vous comme pour lui.
C’est magnifique, bien sûr. Mais comme on n’a pas le marketing, la déferlante médiatique, le seul outil qui nous reste, c’est de donner envie de lire aux prescripteurs. Et donc surtout aux libraires : là encore, le pacte de confiance est décisif. Un libraire a moins le droit de se tromper : quand il a ses fidèles clients à qui il conseille régulièrement des livres, il n’a pas vraiment droit à l’erreur ! Et Zulma répond souvent à cette exigence-là. En retour, le lecteur devient très exigeant. Il attend de nous des choses vraiment différentes, inattendues. Si soudain on faisait quelque chose de trop « mainstream », il ne comprendrait pas !
Donc vos critères sont à la fois très précis et très diffus. Si vous avez un responsable marketing dans la maison, il doit s’arracher les cheveux !
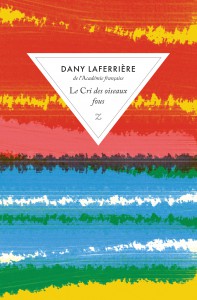
Oui et non, car les ventes sont là. Ça fonctionne sur l’addition de un livre + un livre + un livre… Il y a trois ans maintenant, nous avons créé une collection de poche, Z/a, qui publie 8 titres par an. Quatre d’entre eux sont issus de notre catalogue, quatre autres peuvent provenir d’autres éditeurs ou directement d’auteurs qui n’ont pas été publiés chez nous, mais qui auraient pu l’être et qui ont vraiment une affinité, une couleur… Je me suis prise de passion pour la littérature haïtienne, et j’ai donc publié en poche plusieurs classiques haïtiens, des livres magnifiques qui n’étaient connus que par un public spécialisé. Je pense qu’on a contribué à les faire découvrir. Nous avons d’ailleurs également ressorti les trois premiers romans de Dany Laferrière dans cette même collection. Le poche nous permet aussi de toucher un autre public, qui achète différemment, et c’est une autre manière d’éclairer notre démarche éditoriale.
Quand vous dites que vous ne faites pas de littérature de genre, qu’entendez-vous exactement par là ?
Dans Zulma première formule, nous avions une collection de romans noirs, avec entre autres Pascal Garnier et Marcus Malte. Quand j’ai lancé la nouvelle formule, j’ai pensé que ces deux auteurs-là avaient tout à fait leur place en littérature dite « générale » et je leur ai proposé de rester chez Zulma. Pascal a vraiment eu de très beaux succès à ce moment-là, et Marcus aussi puisque lorsque nous avons publié son Garden of Love dans notre collection de littérature, il a remporté le Prix des Lectrices de Elle dans la catégorie « roman policier »! Donc pour moi, ce n’est pas une question de genre : ces auteurs-là viennent nous apporter une voix singulière, un regard, et c’est de la littérature. Ce sont tous deux de magnifiques écrivains. En fait, c’est plutôt une affaire de marketing et de rayon en librairie…
Est-ce que ça vous agace un peu quand vous voyez que Marcus Malte publie ses Harmoniques à la Série noire ?
Oui bien sûr ! Mais en même temps, Les Harmoniques est un roman noir parfaitement identifié. Il y avait donc une vraie logique dans cette démarche. Les choses se font très naturellement, il n’y a aucun ostracisme de ma part envers le genre « noir ». Et puis pour moi, une collection de romans noirs, il faut que cela vive… Et comme j’ai décidé de publier 12 titres par an, voilà ! En fait, ma spécialité est la diversité. Je ne peux pas faire vivre une collection de romans noirs, ou de SF : ce serait 12 livres de plus, et on passerait à une manière de travailler différente. Il ne faut pas oublier, comme je l’ai dit un peu plus tôt, que la démarche de publication de littérature étrangère est longue et souvent compliquée.
Si vous aviez un souvenir à raconter sur votre carrière d’éditrice, que choisiriez-vous ?
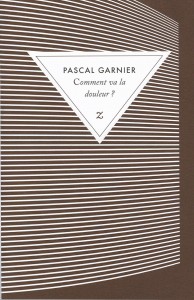
Un souvenir très joli : quand je cherchais la maquette des couvertures de mes livres. J’ai interrogé pas mal de graphistes, j’avais en tête une idée très précise mais très abstraite. Je voulais que ce soient de très beaux objets de papier, avec de grands rabats susceptibles d’accueillir les textes promotionnels, dont je ne voulais pas en 4° de couverture, je souhaitais que les couvertures puissent se dérouler, je voulais un beau papier, de la belle typo, sans pour autant tomber dans l’édition un peu précieuse. La littérature en France est encore très « typographique », alors que les mêmes éditeurs, lorsqu’ils publient de la littérature étrangère, mettent des jaquettes, de la couleur, etc. Je voulais avoir quelque chose de très classique, et en même temps une totale variété en termes de couleurs. Je ne voulais pas que ce soit figuratif, presque un hommage au travail d’imprimeur. Je voulais que les livres puissent parler pour eux-mêmes : « Je suis un objet littéraire, mais pas chiant. » J’ai découvert à Londres le travail de David Pearson, et j’ai fini par lui écrire. Il m’a dit oui tout de suite, on s’est parlé, trois jours après il m’envoyait une maquette, et c’était exactement ce que j’attendais. Le premier titre à bénéficier de cette magnifique couverture, c’était Comment va la douleur de Pascal Garnier.
Il s’agissait de pouvoir décliner cette solution sur le long terme…
Oui, et je voulais aussi que la couverture identifie immédiatement Zulma. Avec David Pearson, c’est une vraie réussite. C’est vrai, cela coûte plus cher à imprimer, on utilise des Pantone, etc., mais le résultat est là… Un bel objet qu’on a envie de garder avec soi.
Qu’est-ce que ça fait quand on apprend qu’on a le Prix Femina ?
C’est magnifique ! J’ai été immensément contente pour Marcus, pour son livre bien sûr mais aussi pour toute sa démarche, son univers, son intégrité. Je suis très attachée à ses livres, je l’aime beaucoup et ça a été un immense plaisir. Le téléphone a sonné ici, j’ai décroché, j’ai raccroché, j’ai poussé un énorme cri de joie et on s’est toutes tombé dans les bras les unes des autres. Toute l’équipe était en liesse, et ça aussi, c’est un moment magnifique pour Zulma. Tout ce travail, toute cette énergie, cette passion, cette pugnacité récompensés. Cela ouvre une audience énorme : à ce jour, on en est à 70 000 exemplaires, et sûrement 70 000 lecteurs heureux. C’est une magnifique reconnaissance (voir ici la chronique de Le garçon, de Marcus Malte).
Pouvez-vous nous dire un mot sur votre collection Ceytu, où vous traduisez en wolof des « classiques » ?
Nous avons créé cette collection l’année dernière avec Boubacar Boris Diop, avec l’idée de publier trois titres, puis de se laisser le temps de les travailler, notamment sur les questions de commercialisation, qui sont très compliquées. C’est une sorte d’exercice en « live » : au lieu de chercher la solution au problème et puis de la mettre en œuvre, nous avons fait l’inverse. Une sorte de laboratoire, en quelque sorte. Traduire du français au wolof, c’était un geste politique pour dire que toutes les langues ont des choses à apporter.
Et côté revues ?

Nous diffusons la revue IntranQu’îllités, dirigée par le poète haïtien James Noël. Et puis j’ai proposé à Hubert Haddad de réunir un comité de rédaction autour de la revue littéraire Apulée, qui « émet » depuis le monde méditerranéen et qui se veut une revue de littérature et de réflexion, avec un autre point de vue sur la littérature qui ne soit pas franco-français. Apulée, c’est vraiment la revue de la maison.
C’est une autre façon d’exprimer votre vision de l’édition ?
Je publie beaucoup de littérature étrangère. Nous ne nous contentons pas de publier un auteur, il s’agit pour nous de publier une œuvre. Nous suivons les auteurs de livre en livre. J’avais vraiment envie que la maison ait une revue, car je trouve que c’est quelque chose de vivant, de joyeux. Dans le prochain numéro, il y aura un très beau texte signé par une jeune femme, Myriam Gaume. C’est l’histoire d’un tout petit village de pêcheurs en Tunisie, qui présente une particularité : c’est là qu’échouent tous les cadavres de noyés. Toute la vie du village en est bouleversée : on ne peut pas ne rien faire ! Que faut-il faire, comment faut-il le faire ? C’est un texte de 15-20 pages que je n’aurais jamais eu l’occasion de publier ailleurs que dans la revue. La générosité, le plaisir de l’accueil: dans Apulée, il y a plein d’écrivains que je n’aurais jamais publiés et que je ne publierai peut-être jamais. Mais c’est une magnifique occasion de découvrir de nouvelles voix.
Vous traduisez très peu de littérature anglo-saxonne. Est-ce un vrai choix « politique », ou l’envie délibérée d’aller ailleurs.
Je voulais effectivement aller là où les autres n’allaient pas. Et puis la langue anglaise relève de la culture dominante, même si bien sûr on trouve en langue anglaise des auteurs qui ne sont pas « mainstream ». Je n’ai aucune hostilité, je suis angliciste de formation et j’adore la littérature anglo-américaine…
Voulez-vous nous parler de l’actualité de Zulma ?
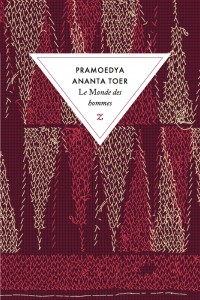
En janvier, nous publions le premier volume d’une tétralogie indonésienne signée Pramoedya Ananta Toer. Il a écrit le « Buru Quartet », qui s’appelle ainsi parce qu’il a passé de nombreuses années enfermé dans le camp de Buru, « le goulag des mers du sud », où il n’avait le droit ni de lire ni d’écrire. Il a donc commencé à raconter cette histoire à ses co-détenus. C’est un vrai feuilleton romanesque, un bildungsroman, la prise de conscience d’un jeune Indonésien, qu’on prend en 1880, élite de la nation, journaliste qui écrit en néerlandais, mais qui se rend compte qu’il ne sera jamais qu’un moins que rien aux yeux des colons et de ses confrères néerlandais. A ce moment-là, il se tourne vers sa langue et publie exactement ce que les Néerlandais n’attendent pas de lui. Comme ce roman est écrit en situation d’incarcération, il est marqué par des rebondissements liés à ce contexte. Le premier volume, Le monde des hommes, sort maintenant, en janvier. Le deuxième, qui sort en mars, s’appellera Enfant de toutes les nations. C’est écrit de telle manière qu’on a la sensation que l’auteur vous raconte une histoire, rien qu’à vous.
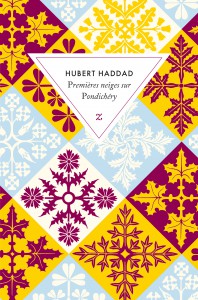
Et puis il y a le nouveau roman de Hubert Haddad, Premières neiges sur Pondichéry. Haddad nous emmène toujours dans toutes sortes d’endroits. Après le Japon, nous le suivons en Inde où nous rencontrons un musicien israélien qui profite d’une invitation à un festival de musique en Inde pour claquer la porte à Israël. On se rend compte que ce personnage a été blessé dans son corps – il est aveugle. L’Inde c’est les odeurs, les sensations, l’air sur la peau… L’auteur nous transporte dans ces paysages de sensations, et le héros découvre à Fort Cochin l’antique synagogue bleue, vestige d’un village juif installé là il y a des millénaires. C’est presque un conte en même temps qu’une réflexion sur le judaïsme. Avec deux grandes questions : si Israël avait été fondée ailleurs ? Et si le judaïsme avait prospéré là, en Inde ?
Éditions Zulma, 18 rue du Dragon – 75006 Paris
| Le site des éditions Zulma |


















