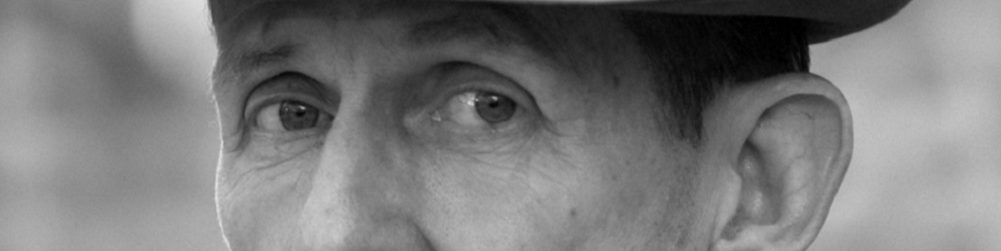[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#326e99″]L[/mks_dropcap]e quatrième roman de Grégory Nicolas, Des Histoires Pour Cent Ans, vient de paraître aux éditions Rue des Promenades. Il y a quelques jours, Addict-Culture vous offrait un chapitre inédit de ce très beau roman. Il ne manquait plus qu’un entretien avec l’auteur. Le voici. En toute liberté.
Des Histoires Pour Cent Ans est une vraie réussite, et surtout le résultat d’une ambition, d’une volonté d’ampleur qui apparaît tout de suite, dès les premières pages. Peux-tu nous parler de cette volonté-là ?
Je me suis lancé dans ce projet d’histoires pour cent ans il y a deux ans et demi. Et dès le départ, je voulais qu’il y ait beaucoup de personnages. J’aime bien tout ce qui est choral, j’ai voulu me frotter à l’exercice. C’est donc parti très vite. Trop vite. À un moment, je me suis retrouvé bloqué dans la narration. Je n’ai jamais mes histoires du début à la fin. Là, j’avais juste la dernière scène, depuis longtemps. J’avais les époques, les personnages. Quand je suis arrivé à la partie contemporaine, où le lien se fait entre les grands-parents et les petits-enfants, je me suis retrouvé bloqué. J’en ai parlé avec ma femme, ça me peinait beaucoup, je n’avais pas assez de temps. Nous avons donc pris la décision de me donner un an pour finir le livre. Je peux dire que c’est grâce à elle que j’ai pu terminer ce roman, ça a été un gros sacrifice. Donc pendant un an j’ai pu prendre le temps. Poser les personnages, travailler sur l’histoire, faire de la recherche documentaire, ce que je n’avais jamais eu le temps de faire. Cette amplitude, elle est probablement due au fait que j’ai eu ce temps.
On retrouve avec plaisir tes thématiques préférées : la Bretagne, le vélo, le vin, la famille.
Parfois, on réfléchit un peu trop. J’ai toujours peur de m’enfermer dans des thèmes. Du coup, je me suis dit, à un moment donné, qu’il fallait que j’arrête d’écrire sur la Bretagne. Sur le vélo. Sur le vin. Puis j’ai réfléchi et j’ai compris que tout ça, c’était moi, et qu’il n’y avait aucune raison pour que je me censure ! La Bretagne, je l’explore ; les relations entre les gens, c’est ce qui me fait vivre ; le vin, c’est ma passion ; et le vélo c’est mon histoire familiale. C’est en réfléchissant à tout ça que toutes les connexions se sont faites. Le premier titre du livre, c’était « La guerre en jean slim »! Parce que je me suis toujours demandé comment les petits gars comme nous, de la génération des années 90, se comporteraient en situation de guerre. Il fallait trouver un moyen de déclencher une guerre, et c’était le vin.
La première partie est enracinée dans la famille, dans le territoire et dans l’histoire. Et tout à coup, on passe dans la fiction, voire l’imaginaire avec la partie plus contemporaine et la « guerre du vin »!
Je fonctionne beaucoup à partir de fantasmes. Il fallait que je trouve le procédé narratif qui allait me permettre de faire évoluer mes personnages et de tisser les liens entre eux qui les amèneraient là où je voulais.
[mks_pullquote align= »left » width= »300″ size= »22″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#326e99″]
Quand j’étais petit, je voulais « faire écrivain », comme d’autres veulent « faire pompier », astronaute ou paysan
[/mks_pullquote]
Revenons au point de départ : le désir d’écrire, ce qui a déclenché l’écriture chez toi.
Quand j’étais petit, je voulais « faire écrivain », comme d’autres veulent « faire pompier », astronaute ou paysan. Mais je n’avais aucune idée de ce que c’était. Et pourtant, dans ma famille, les livres n’avaient pas une place importante. En revanche, on s’est toujours raconté des histoires. Mon grand-père s’asseyait en bout de table, on était 25 à l’écouter nous raconter ses courses de vélo ! Dans ma famille, on a plus une tradition orale qu’écrite : certains sont dans le spectacle, la chanson. Mais je voulais faire écrivain, et ça m’est resté. C’est la seule chose sur laquelle je n’ai jamais eu de doute. J’étais un bon élève, pas une âme rebelle. Je faisais consciencieusement ce qu’on me demandait, y compris lire. Et puis j’ai pris mon indépendance et je me suis mis à écrire. Mais je ne savais pas comment faire, donc j’ai commencé à lire seul, beaucoup. Du coup, je lisais Blondin et j’écrivais comme Blondin !
Quand on n’est pas entouré par des gens qui lisent beaucoup, comment est-ce qu’on choisit ses lectures ?
Je lisais des choses très grand public, mais aussi des choses plus pointues que les profs me faisaient lire. Pour moi, l’école a été décisive : je n’aurais jamais lu Voltaire tout seul ! À partir de là, je me suis créé une communauté d’auteurs que j’aimais, comme Marcel Pagnol ou Louis Pergaud. J’ai lu La Guerre des Boutons trente ou quarante fois ! Après, je suis parti faire un tour du monde… Et j’ai écrit mon premier manuscrit. Sans dire à personne que j’étais en train d’écrire, tant que je n’ai pas eu terminé.

Tu as commencé directement par un roman, sans passer par des nouvelles, par exemple.
J’ai fait un roman tout de suite. Mais à ce moment-là, j’écrivais de façon très académique, un peu ampoulée… Puis j’ai créé un blog. J’avais fait mon tour du monde, j’avais donc des choses à dire, et j’y mettais de l’humour aussi, des clins d’œil en toute liberté. C’est là que j’ai compris qu’il ne fallait pas que je copie, qu’il fallait que je fasse mon truc à moi. Et je me rappelle très exactement le jour qui a fait qu’aujourd’hui je publie des romans. J’en ai d’ailleurs parlé dans une nouvelle publiée sur Addict-Culture… [NDLR : à lire ici] J’étais en Australie, dans un bus, et il y avait une fille qui pleurait. J’ai regardé le titre de son livre, et c’était L’Été Meurtrier de Sébastien Japrisot. Aussitôt, je suis allé dans une librairie où on trouvait des livres français et, coup de bol, ils l’avaient. Quand j’ai lu ce livre, j’avais l’impression qu’il me parlait. Depuis, à chaque fois que j’écris, j’essaie de retrouver l’émotion que j’ai ressentie en le lisant. J’ai développé des techniques, j’ai analysé, et j’ai écrit les histoires que j’avais envie d’écrire.
Un jour, j’ai vu un gamin qui apprenait à faire du vélo avec son père. Et je me suis demandé comment on apprenait à faire du vélo si on n’avait plus ni père ni mère… C’est de cela qu’est venue l’idée de Là Où Leurs Mains Se Tiennent. La rencontre déterminante ? Celle avec Charlotte Bayart-Noé, mon éditrice de Rue des Promenades: il y a quatre ou cinq rencontres qui vous changent la vie, Charlotte en fait partie. Elle a vraiment changé ma vie… Elle m’a fait rencontrer des gens que je n’aurais jamais rencontrés, lire des auteurs que je n’avais jamais lus, comme Fallet, Vialatte, où je me suis profondément retrouvé. Au fur et à mesure, j’ai pris confiance en moi. Et je me suis dit qu’il fallait que je construise quelque chose de global. Parce que je ne veux pas que ça s’arrête. Je ne veux pas faire trois livres, et puis terminé. Je veux que ça dure.
Comment expliques-tu l’évolution considérable qu’on constate dès qu’on lit les premières pages de Des Histoires Pour Cent Ans ?
Le travail, pour commencer. J’ai beaucoup travaillé, j’ai beaucoup lu aussi. Et puis je dois dire que Facebook m’a fait découvrir des gens et des auteurs que je ne connaissais pas : bien utilisé, c’est un outil formidable ! Dès le début, je savais que je voulais faire quelque chose de plus ambitieux.
Cette façon que tu as de nouer les relations entre tes personnages, de plonger dans les histoires familiales, comment l’as-tu apprise ?
Attention, il ne s’agit pas de souvenirs de famille, mais de choses inventées. Mais bien sûr certains détails sont inspirés de la réalité : Pierre, c’est mon grand-père, mais mon histoire, c’est le fantasme que je projette sur la vie de mon grand-père. Donc, plutôt que des souvenirs de famille, ce sont des souvenirs inventés que j’ai projetés sur mes personnages. Et puis il y a la technique narrative. La façon d’écrire diffère entre la première et la deuxième partie. Pour la première partie, j’ai fantasmé la langue de l’époque et la façon dont les auteurs pouvaient utiliser la langue. Il y a un autre auteur qui a joué un rôle déterminant dans l’écriture de ce livre : Bernard Clavel. C’est quelqu’un qui a eu le Goncourt en 1968 puis qui a « glissé » vers une image d’auteur « ringard » : c’est l’auteur type que les petites dames achetaient chez France Loisirs… C’est mon beau-père André, à qui le roman est dédié, qui m’a donné à lire Les Fruits de l’Hiver en me disant qu’il était certain que ça me parlerait. Et effectivement : il avait une façon de caractériser ses personnages qui m’a encouragé à essayer d’être au plus près des gens. Dans ce roman-là, il y a 100 pages qui parlent uniquement du fagotage du bois, et c’est mythique, c’est une scène qui me fait vibrer.
[mks_pullquote align= »right » width= »300″ size= »22″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#326e99″]
La littérature populaire, ça n’est pas nécessairement de la soupe !
[/mks_pullquote]
Une forme de littérature populaire, c’est à cela que tu es attaché ?
Oui, une littérature populaire de qualité. À l’époque de Clavel, il y avait plus de place pour la lecture, qui n’était pas encore concurrencée par d’autres loisirs. Pour en revenir à la progression de mon écriture, je pourrais la comparer à ma progression dans mon métier d’instit’. Je pense que suis un meilleur instit’ maintenant qu’à mes débuts : ce qu’on perd en naïveté, on le gagne en expérience et en technique. Faire des livres, c’est aussi de la technique. Et surtout, j’écris dans la joie : je m’éclate vraiment en écrivant, mais je pense aussi au lecteur. La littérature populaire, ça n’est pas nécessairement de la soupe !
Je vais revenir sur mon travail avec Charlotte. Elle n’est pas une personne qui dit ce qui ne va pas, ce qu’il faut alléger, couper, etc. C’est quelqu’un qui pose beaucoup de questions. Quand je sors d’un rendez-vous avec elle, c’est certes un peu dur. Mais toujours, ses questions ont un sens et je me dois d’y répondre. Par exemple, elle m’a dit qu’il fallait que je trouve le moyen de rendre crédible cette histoire de guerre civile, et elle avait raison.
Justement, à propos de cette « parabole » du vin, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle est importante pour toi ?
Ce que j’aime dans le vin, c’est aussi ce que j’aime dans la littérature et chez les ébénistes : le génie humain. Le vin, c’est un climat, un sol et une main : s’il n’y a pas ces trois choses-là, il n’y a pas de vin. Quand on remet en cause le vin, sous couvert de sécurité, d’hygiénisme, on se prive d’une partie du génie humain. Attention, je suis pour qu’il n’y ait pas d’accidents de voiture ! Le vin, la vigne, je trouve ça magnifique. Mais je sais qu’on peut aussi estimer, à l’inverse, en regardant des vignobles, qu’à la place il devrait y avoir des bois et des forêts et que les vignobles, c’est une main-mise totale de l’homme sur la nature. J’estime que le vignoble est le résultat de l’appropriation d’un territoire par l’homme, certes, mais que le résultat est beau…
Je m’intéresse beaucoup à l’histoire, et je jetterai un pavé dans la mare : j’adore la France ! Quand on a la chance de déguster un repas dans un restaurant étoilé, on s’en rappelle toute sa vie. Mais je me rappelle aussi la première fois où j’ai mangé en tête à tête au restaurant avec mon fils, qui avait un an et demi : on a mangé une saucisse purée, j’ai bu un verre de vin… Et ça aussi, je m’en rappellerai toute ma vie ! Dans ma famille, on ne lit pas, on ne cuisine pas, on ne boit pas, mais les repas sont exceptionnels parce qu’on est à table, on parle, on s’écoute, on rit fort. Chez moi, ça n’est pas « Famille, je vous hais ! ». Dans ma famille, tout le monde a été très libre : quand j’ai voulu me mettre une boucle d’oreille, ma mère m’a accompagné chez le bijoutier. Quand j’ai voulu me teindre les cheveux en blond, elle m’a envoyé chez le coiffeur ! Donc quand j’ai voulu écrire des livres, pourquoi pas.
Dans ce livre-là, on ressent cette liberté, en particulier par rapport à Mathilde est Revenue. Du coup, il y a une ampleur, une générosité.
Il faut dire que Mathilde, c’était un peu un huis clos. Et puis je reviens toujours au temps et au travail : pour ce dernier roman, j’ai eu le temps, j’ai pu travailler comme je voulais. Et puis bien sûr, mon évolution personnelle y est pour quelque chose. Sans oublier que j’étais là sur un temps long : un siècle d’histoire à travers mes six personnages principaux. Pour moi qui adore l’histoire et qui ai fait des études d’histoire ! Je me suis imposé des contraintes procédurales : le langage, avec cette langue d’autrefois que j’ai essayé de retrouver, et cette écriture plus blanche pour la deuxième partie. Des contraintes qui libèrent, en quelque sorte.
Tes personnages de femmes sont très beaux, notamment celui de Perrine.
Perrine, ça pourrait être ma grand-mère. J’ai toujours imaginé ce qu’auraient pu faire mes parents à mon âge. Ma grand-mère, comme Perrine, aurait pu se faire tondre à la libération. Toutes ces femmes-là, qui ont été tondues et tabassées, leur vie n’était pas terminée… Et c’est ça qui m’intéressait vraiment. La vie après, comment la vie continue.
Et cette terrible histoire des Lebensborn ?
Quand j’ai écrit mon histoire, j’étais persuadé comme tout le monde que les Lebensborn étaient un dispositif destiné à engendrer de parfaits petits aryens. Alors que j’ai appris plus tard qu’il s’agissait, plus simplement, de repeupler l’Allemagne… Mais à l’époque, personne ne le savait, l’histoire cadrait parfaitement avec ce qu’on savait. J’ai donc placé le Lebensborn dont il est question dans mon histoire dans le Jura, près de la ligne de démarcation, en forme de clin d’œil à Bernard Clavel dont on parlait tout à l’heure.
As-tu déjà commencé à travailler à ton prochain roman ?
Depuis trois mois, j’ai fait une pause. Pour l’instant, c’est la sortie du roman, j’en parle, j’en profite ! Mais le prochain roman est déjà commencé : ce sera l’histoire d’un bateau. Et bien sûr, il y aura de la famille… mais je me suis fixé une nouvelle contrainte (nouvelle pour moi) puisqu’il y aura une partie d’auto-fiction. Dommage, on me dit que ce n’est plus la mode !
Facebook des éditions Rue des Promenades – Facebook
Un grand merci à Maryan Harrington pour les photos de Grégory Nicolas faites le week-end dernier au Salon du Livre Paris.