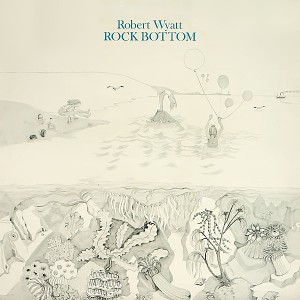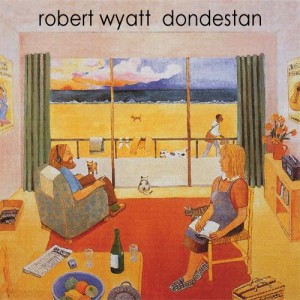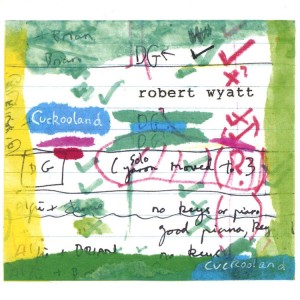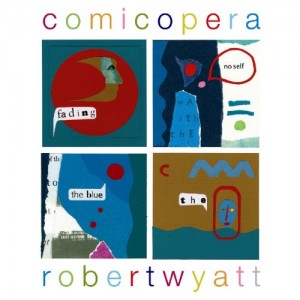Heureux qui voit le jour au sein d’une maisonnée ouverte aux humeurs libérées et excentriques, de celles dont la Perfide Albion a le secret. Cela peut être une expérience déterminante si l’on s’intéresse aux choses de l’art.
Catalyse ultime, le fait d’avoir comme voisin de chambre un tout jeune poète Beatnik australien qui s’en ira plus tard former Gong permet de comprendre à quel point une vocation artistique peut être prédestinée.
On touche à l’écriture, on se passionne pour la peinture, puis c’est l’évidence, on frappe sur des futs en écoutant Charlie Mingus. Ne restait plus donc qu’à savoir où sévir alors que la terre entière vibrait au son du Rock and Roll et du Mersey Beat.
Mais pour ça, il faut inventer un son. Créer une mouvance musicale à la fin des sixties équivaudrait à penser qu’allumer un barbecue au pied d’un volcan en activité puisse changer le cours des choses.
1966 : Londres est une vaste champignonnière. La contreculture et le psychédélisme vont bientôt battre leur plein, et s’imposer en maîtres seuls capables à gérer les réactions en chaîne que de géniaux illuminés comme The Beatles et Pink Floyd s’apprêtent à déclencher. Les temps n’étant décidément pas à la petitesse, il fallait voir grand. C’est donc d’une petite ville du Kent, réputée pour sa cathédrale et ses marchés de Noël, qu’un autre mouvement se crée, non concurrentiel mais parfaitement complémentaire, l’idée générale étant d’insérer le Jazz là où Londres proposait le sitar, et, dans les grandes lignes, de substituer John Coltrane à Ravi Shankar.
L’école de Canterbury était née. Gong, Soft Machine, Hatfield & the North, Henry Cow, Gilgamesh, National Health, Caravan, Camel et d’autres en feraient les beaux jours. On y découvre aussi comme partout ailleurs les côtés obscurs de l’humanité, les méandres tordus des relations sociales, les amitiés, les règlements de comptes, les caprices, les égos, les comportements erratiques.
1973 : Le parcours d’une vie est parfois plus que sinueux. Tomber du quatrième étage sous l’emprise de substances illicites censées rendre imperméables au trac les pratiquants de Jazz-Rock de Canterbury, à l’époque où la scène londonienne ressemble à s’y méprendre à une énorme boule à neige tourbillonnante de poussières argentées éructées d’un Glam Rock omniprésent, est par contre une expérience radicale, rapide, très rapide… La vitesse d’une chute, en fait. Les rencontres brutales avec le macadam se terminent rarement sans séquelles, mais ont ceci de constructif qu’elles permettent, à plus ou moins brève échéance, de faire le tri entre les amis, et les autres. Car, paradoxalement, les visions en contre plongée, triste apanage des usagers de chaises roulantes, ont au moins le privilège d’aiguiser le regard. Dès lors, on rumine, on intériorise, on se rend compte que la vie qu’on avait connue n’existe plus, mais qu’une autre repart, différente et immédiate. On s’attelle à décrire, à peaufiner, à explorer le monde imaginaire tout au long d’interminables trekking cérébraux, à défaut d’user à nouveau de vraies jambes, et on apprend la trompette.
» Se réapproprier sa propre existence artistique lorsque le destin fait preuve d’espièglerie et que le corps et l’esprit subissent un bouleversement tel que tout, du jour au lendemain, est remis en cause, n’est pas une sinécure. Alors que le corps lâche, mais que l’esprit reste en éveil, comment traduire les images et les sons imaginés aux tréfonds de votre âme tourmentée ? Car tout traverse, tout transperce. Les bruits, le langage, abstractions lunaires et courants abyssaux. Par la force des choses, il a fallu abandonner certains acquis. Ce qui réglait la métronomie, elle-même régulée par la coordination des membres, n’est plus qu’un lointain souvenir. La solution viendra de l’extérieur, mais en même temps si proche. La muse. La femme. Qui l’inspire, qui lui offre un petit clavier sur lequel sera composée la base du chef-d’oeuvre à venir, réussite où la voix se fait instrument, où se mêlent improvisations vocales et musicales, où les paroles n’ont pas de sens précis. La muse qui sera déterminante dans la retranscription réaliste de ce qui existe dans la tête de l’artiste. La femme, qui réalise les illustrations de l’œuvre, basées sur des représentations marines, des abysses, de l’enfance. Il faut aussi une atmosphère propice à la création. Venise sera l’endroit. Elle inspirera l’artiste pour la création des six morceaux qui jonchent l’album. Enfin, un carnet d’adresse allant de Richard Branson à Nick Mason en passant par Mike Oldfield fera le reste. Le public suivra. Le succès critique aussi. La France ne sera pas en reste, lui décernant le prix Charles Cros pour cet opus ambitieux. Le passé peut donc s’envoler, l’avenir démarrer sous de meilleurs auspices ”
Heureusement, il y a Alfie, compagne complice, copilote fidèle et dévouée du vaisseau musical poétique, peintre, illustratrice et parfois même chercheuse de mots… Bien plus qu’une muse, qu’un inestimable soutien, elle parachève à coups de pastels l’œuvre musicale. Magnifique exemple d’une connivence fusionnelle quasi symbiotique. Dès lors, on se terre, on crée, on se tisse un univers intello-enfantin au creux d’un petit nid douillet de Twickenham, dans la banlieue de Londres.
Mid-Seventies : les vagues de fond des récentes crises s’amoncellent. Les crises pétrolières, minières, cette satanée guerre froide et cet écœurement désabusé face aux complexités des œuvres musicales en inadéquation totale avec les nouvelles préoccupations existentielles, engendrent une vague de laissés pour compte, comme une ambiance de fin de règne. On persifle donc la béatitude des idoles hippies et on en adule de nouvelles, plus nihilistes.
« Deux prénoms pour une pièce. Elle-même parsemée de nombreuses petites pièces musicales formant un tout. Le voyage est introspectif, quoique rythmé, parfois. Le jazz est là. Mais pas nécessairement où on l’attend. Il est libre, mais libre comme celui de New Orleans, suivant ici un corbillard, là-bas une voie colorée, Africaine, presque funky. Phil Manzanera est de la partie. Brian Eno aussi. Est-ce pour cela que j’ai parfois l’impression d’entendre David Bowie ? Est-ce mineur ? Faut-il se poser la question dès lors que tout ceci est capable de balayer une certaine concurrence ? »
Les Eighties : tout bien pesé, les années 80 et leur capitalisme sauvage ont eu ceci de bon que les artistes ne pouvaient pas ne rien faire, la laideur incitant souvent à l’insoumission créative. Et donc, avec ou sans chaise roulante, lorsqu’on a des convictions, lorsqu’une politique de fer révulse la conscience et qu’un conflit mortel sur fond d’îlots argentins vous file la nausée, on ne peut que devenir communiste xénophile et antiraciste et, tant qu’à faire, on fuit Londres, ses loyers exorbitants et ses voisins teigneux pour une retraite paisible aux fins fonds du Lincolnshire, emportant avec soi souvenirs, objets africains, collection de cruches, trompettes, pianos, disques, livres, pour une destination franchement plus sylvestre… quasi elfique.
« 1985 : Michael Bettaney est en prison pour de longues années encore. Margaret Thatcher est résidente du 10 Downing Street depuis déjà 6 ans. Comment exprimer ses doutes, sa colère et son désarroi ? L’option choisie sera sans équivoque. Ce sera seul. Avec des claviers cheap et une boîte à rythme. L’habillage est doux, le propos véhément. Clair-obscur. Et puisque la voix est un instrument, elle sera plus présente que jamais dans l’onirisme, la douceur éthérée, planante. Avait-il un jour aussi bien chanté ? Et si l’emprise sonore des années 80 montre parfois le bout du nez, rien de tout ceci n’est inécoutable aujourd’hui. En 2014, c’est toujours aussi pertinent. »
Les temps s’écoulent, constants, comme coulerait un paisible ruisseau au débit rassurant, sans cesse renouvelé, sans cesse semblable, au gré d’une continuité créative musicale assise, profondément scellée à une autre, picturale et naïve, occasionnellement rehaussées du coup de patte inventif d’un ami fidèle de passage en ces territoires éloignés, de ceux qui jouxtent la frontière des terres d’une Alice et celles des fées et autres farfadets.
« Des poèmes en musique. Exercice périlleux s’il en est. D’autres s’y sont cassés les reins bien avant lui. Ne pas décevoir et croire en ce que l’on fait. Tel pourrait être le leitmotiv. Après tout, ce ne sont pas les poèmes de n’importe qui, non plus. Poèmes surréalistes, illustrant tantôt des musiques jazzy, tantôt des choses plus expérimentales. Les parties les plus atmosphériques sont du seul fait de l’artiste. Claviers et percussions. Et c’est beau, très beau. Seule la comptine figurant en bout de course sera l’œuvre de quelqu’un d’autre. Un ami. Hugh Hopper. Fidèle. Jusqu’au bout. Paradoxalement cette petite musique de clôture est la moins intéressante. Presqu’un jeu d’enfant, en somme. Et puis, ce questionnement. Où sont-ils ? Telle est l’interrogation. Tous ces gens sans patrie. Quel est le combat à mener, puisque tout ce-à quoi il se rattache part à vau l’eau ? »
1997 : exit les conservateurs, bonjour les travaillistes. Le duel Blur/Oasis fait les choux-gras des tabloïds britanniques. Lady Diana a fait le grand saut et c’est dans ce contexte significatif que l’auteur de Rock Bottom choisit de nous livrer ce qui reste à ce jour comme une référence discographique.
« Etre hors d’atteinte. Se situer dans un état où le temps s’écoule lentement. Fermer les yeux et écouter, comme dans un rêve, une suite, une succession de compositions qui ne se ressemblent pas. Le titre de l’ouvrage peut sans doute revêtir plusieurs significations pour l’auditeur. Mais si l’on ne doit retenir littéralement que la plus évidente, s’endormir en comptant les moutons s’apparenterait dans ce cas précis à un rêve enchanté. Nul bouleversement majeur de style ne nous est donné avec cette livraison. Mais la forme qu’elle soit orientée vers le jazz ou la musique plus contemporaine, offre une atmosphère de songes. L’illustration graphique représentant le contenant ne laisse d’ailleurs planer aucun doute. Il y a le ciel, bleu azur, faisant ressortir de manière éclatante le blanc de la colombe, qui elle-même vole de nuages en nuages, emmenant son cavalier vers des horizons lointains. Contrairement aux efforts précédents, l’heure n’est pourtant plus à la solitude. Les habitués sont là. Manzanera, Eno, Alfie bien sûr. Mais aussi Paul Weller, qui vient de retrouver quelques couleurs en solo, ou encore Philip Catherine et Evan Parker, figures bien connues du jazz d’hier et d’aujourd’hui. L’œuvre musicale traverse une grande diversité de tons, le fil conducteur n’étant clairement pas l’homogénéité. Mais, étrangement, tout se met en place naturellement, comme dans un film qui déclinerait 11 séquences différentes qui se rejoindraient en un seul feu d’artifice à la fin. L’effort mérite d’être salué car il s’agit ni plus ni moins d’une œuvre majeure dans la carrière de l’artiste. La presse de l’époque ne s’y est d’ailleurs pas trompée, saluant dans une quasi-unanimité ce disque splendide. »
Et puis il y a les cigarettes, beaucoup de cigarettes, et puis il y a l’alcool, beaucoup d’alcool… Trop d’alcool. Dès lors le débit du ruisselet s’emballe charriant des eaux moins cristallines, maculé de plus en plus de doutes, d’idées sombres… Il est temps de dépolluer.
« Back To Jazz, telle aurait pu être la devise de cette cuvée millésimée 2003. On décelait même de la joie mélancolique et de la gaité lyrique découlant directement de l’après-guerre dans cette vieille Europe un peu frivole, swing. Certes, point question d’exclusions expérimentales et atmosphériques, mais sans doute plus larvée. Le registre reste le même, bien entendu. La musique est douce, planante mais sans doute moins irradiante. La distribution, comme il en a pris l’habitude sur les deux sorties précédentes, est nickel. Outre les habitués, David Gilmour est présent, ainsi que Karen Mantler, fille de l’illustre Carla Bley. Et ça fonctionne toujours, même si l’effet de surprise n’est plus vraiment là. C’est comme revoir un vieil ami que l’on admire, quelques années ayant passé sans recevoir de nouvelles, et puis il est là, juste à côté de soi, comme si l’on s’était quitté la veille. »
A au départ, les AA ensuite, auront canalisé les choses. On dirait bien que certaines lettres portent chance. Les idées se font moins prolixes, moins dingues, le grain de folie éthylique s’estompe, cependant une certaine sérénité s’installe. Alors, tranquillement, le soir venu, dans le silence apaisant d’une nature tranquille, on contemple à deux le soleil couchant, l’une avec ses crayons, l’autre avec son papier à musique et on se laisse imprégner par les choses.
« 3 actes pour un opéra-comique. Un opéra pop. Populaire s’entend. Quoi de plus normal pour un marxiste – de son propre aveu, c’est tout ce qui lui reste – même si revenu de beaucoup de choses à 62 ans (en 2007) ? Il chante l’amour d’Alfie, il chante la guerre pernicieuse et la paix agressive, il chante l’espoir de l’alternative, il chante Anja Garbarek et Federico Garcia Lorca, en Italien, en Espagnol, en Anglais. A vrai dire il pourrait encore chanter en yaourt ou réciter le bottin téléphonique qu’on s’en ficherait. C’est ça, les génies. La musique navigue sur des eaux tellement calmes que ce doit être l’idée d’une certaine forme de volupté. A l’heure où bon nombre de ses contemporains sortent au mieux des disques insipides, au pire inaudibles, les œuvres de ce grand homme natif de Bristol nous enchanteront pour la vie. »
Des êtres comme ce poète musicien à la voix diaphane et sa compagne aux esquisses malicieuses incitant au bonheur vivent dans une bulle fragile, à l’abri des modes, à l’abri du temps. Laissons les poursuivre leur vie et partons délicatement voulez-vous ? Inutile de les effaroucher.
Mathusalem et Davcom
* Ce 17 novembre 2014 est sorti chez Domino Records un double album rétrospectif de l’oeuvre de Robert Wyatt intitulé Different Every Time. Cette compilation retrace d’une part sa carrière principalement post Soft Machine, d’autre part le fruit de ses innombrables collaborations. Il fait écho à la sortie de la biographie autorisée de Marcus O’Bair. Ce double album constitue une bonne introduction à l’oeuvre du génie multi-instrumentiste.