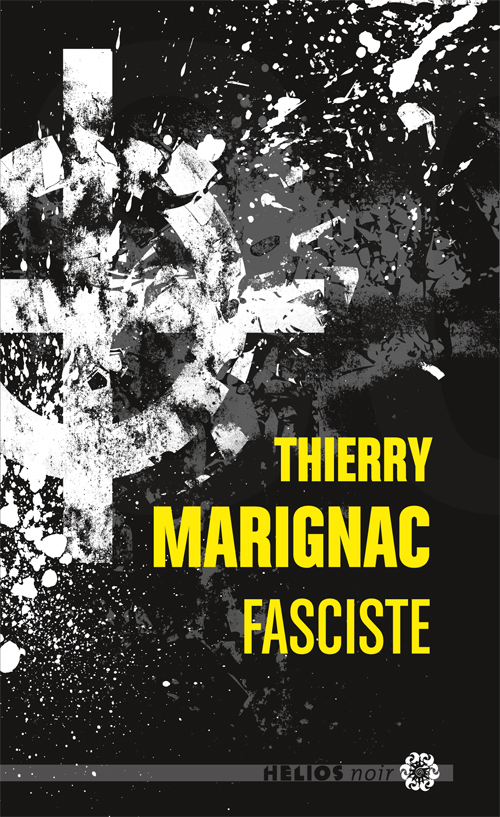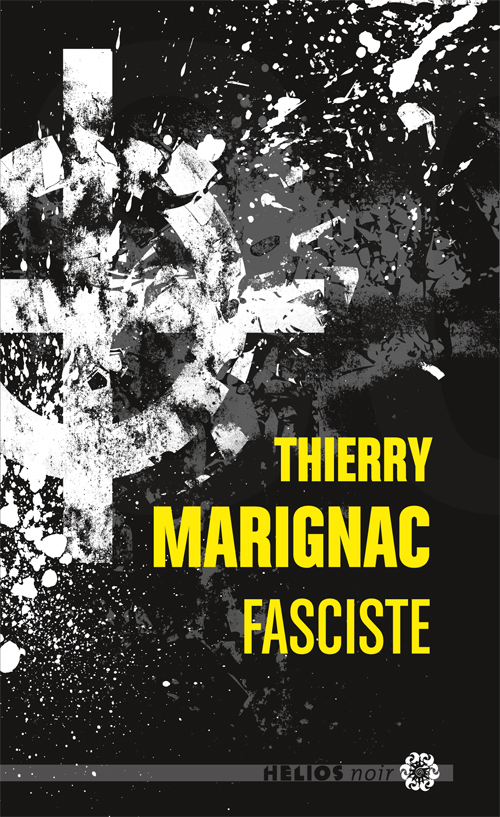La nouvelle édition de Fasciste étant une bonne nouvelle en soi, c’était aussi l’occasion de rencontrer un auteur que j’aime depuis longtemps, et qui depuis 2011 et Milieu hostile était un peu aux abonnés absents. Alors bien sûr, l’absence ayant au moins l’avantage d’engendrer le désir, les questions se bousculaient. Ajoutez à cela la certitude d’avoir affaire à un romancier qu’il faut absolument lire et relire, à un talent qui dépasse largement les frontières du noir et du polar, et vous obtiendrez une interview généreuse, avec un auteur qui y va fort, qui secoue un certain nombre de cocotiers, et qui finalement, avec une fraîcheur juvénile, parle avec passion souvent, colère parfois, de son écriture et de sa drôle de vie d’écrivain.
Fasciste, comment c’est arrivé ?
Je travaillais depuis longtemps dans la petite édition, avec les gens du Dernier terrain vague. Y compris en faisant des paquets, des envois, et ça ne me posait aucun problème. Ils m’avaient fait écrire des nouvelles : « Arrête de te défoncer, écris », qu’ils disaient ! J’ai eu une petite carrière de pigiste dans la presse (Libération, Actuel, Le Figaro, Cosmopolitan, qui payait très bien !). Mais le beau rêve, c’était d’écrire un roman. Tout le monde s’attendait à ce que j’écrive une histoire de rue, de drogue, c’était à la mode. Et j’ai dit « Non, je ne vais pas faire ça. » C’était une période plutôt étouffante, celle de la deuxième élection de Mitterrand. La gauche avait saturé les médias. En France, tout est partagé en clans. Si on ne fait pas partie du clan, on n’a pas le droit d’entrer. Et ça me déplaisait beaucoup parce que j’étais de la génération suivante, les punks quoi ! On n’avait pas de préférence, on n’y croyait pas. La génération de 68 était, elle, très concurrentielle. Fasciste, c’était le truc que personne n’attendait de moi. Dans ma construction romanesque, j’ai toujours pensé à l’inattendu. Et aussi j’aimais beaucoup le groupe dada, d’ailleurs les punks étaient très dada. J’ai eu une idée à la Marcel Duchamp : si je fais un roman du discours politique, ça me donne le style, l’histoire, toute une esthétique, je n’ai même pas besoin d’imagination. Une sorte de ready-made à la Marcel Duchamp. C’est comme ça que je l’ai fait.
Et le style, très remarquable ?
Il dérive de cette idée complètement compacte. Tout découlait de soi-même. Je l’ai écrit en un été, très facilement. J’y ai beaucoup pensé, j’ai traîné avec des militants d’extrême-droite. J’avais fait des piges pour une radio au moment où les étudiants de droite manifestaient contre le gouvernement socialo de l’époque, je m’étais un peu imbibé des écrits théoriques. On ne part pas de rien, quand même.
Il y a eu beaucoup de travail de fraternisation avec ces milieux-là ?
Oui, je m’entendais bien avec eux, en un certain sens. A un moment, j’allais dans une boîte où ils traînaient tous : il y avait aussi bien des étudiants en droit que des anciens soldats. Je m’entendais bien avec eux parce que ces personnages étaient très vivants, et ils n’avaient pas les œillères que la plupart des gens de gauche portaient à l’époque. Ils voyaient bien que je n’étais pas de leur monde, mais ça les faisait marrer, ils me chambraient. Pas de méfiance vis-à-vis de moi. J’ai traîné pendant six mois dans cette boîte, mais j’ai aussi fait des recherches à la Bibliothèque nationale, où c’était mal vu.
Vois-tu une proximité entre l’extrême-droite de cette époque et celle d’aujourd’hui ?
Ça n’a plus rien à voir. C’est à cause de la fin de la guerre froide. Quand j’ai publié le bouquin, l’URSS existait encore, on était en plein manichéisme. Après ça, la vision du monde a totalement changé. La nouvelle droite a découvert Marx. Ils ont complètement changé leur rhétorique. Si mes copains qui sont morts aujourd’hui se réveillaient maintenant, ils seraient très étonnés de voir que la gauche est atlantiste et la droite pro-russe. Ceci dit, il y a quand même des choses en commun. Mais en se banalisant, le Front national se délaye au niveau des valeurs, opère des alliances impensables à l’époque. S’il y a une filiation, tout a quand même énormément changé. Aujourd’hui, le FN fait des tas de références à de Gaulle : à l’époque, ç’aurait été impensable. Même les références à la littérature anar de droite, Chardonne, Drieu, de Roux, ne sont plus à l’ordre du jour maintenant. Les enjeux n’ont plus rien à voir. L’islamisme en 1985, à part l’Iran…
Et ensuite, qu’est-ce qui s’est passé pour toi ?
Pendant deux ans, je n’ai plus du tout travaillé.
Tu n’as pas pu ou tu n’as pas voulu t’expliquer ?
Mais j’ai refusé catégoriquement ! Il n’y avait rien à expliquer. Quand Thomas Harris publie Le silence des agneaux, on ne va pas fouiller chez lui pour vérifier qu’il ne torture pas des petites filles dans sa cave. Avec le stalinisme de l’époque, il fallait se justifier… Et il n’en était pas question.
Mais quand même, tu as publié 7 romans, tu n’étais pas complètement tricard…
Oui, c’était un peu à deux vitesses. Je suis un bon romancier. Tous, ils pariaient là-dessus. Mais tous, ils voulaient me formater. Aujourd’hui encore, d’ailleurs. Ça coince surtout avec les attachées de presse : elles s’occupent de ceux qui ont déjà du succès. Si mes bouquins ont été publiés, c’est qu’ils étaient bons. Mais il aurait fallu que je montre patte blanche, même chez Rivages où j’avais travaillé 15 ans. Je n’ai pas de vanité parce que mes bouquins ne se vendent pas bien. En revanche, je n’ai pas de modestie et j’ai de l’orgueil parce que je sais que mes romans sont bons. C’est juste qu’on ne m’a jamais donné les moyens de bâtir une carrière.
Après ça, j’ai eu le truc inverse. Je me suis retrouvé aux éditions du Rocher pour un roman (Cargaison) et un essai. Le roman est mauvais, je n’allais pas bien, je venais de prendre un gros coup suite à Fasciste. L’essai, en revanche, était réussi. Ça s’appelait Norman Mailer, économie du machisme. Et là je me suis retrouvé casé dans ce qu’on appelait à l’époque les néo-hussards, avec Leroy, Parisis, etc. Ils admiraient tous Fasciste, mais on n’était pas franchement du même monde. Eux, ils étaient plutôt costards Agnès B, propres sur eux. Moi, j’habitais à Barbès… Ça ne pouvait pas durer.
Puis je suis retourné chez Rivages, on venait de virer Cohen et sa clique de gauchistes qui avaient dépensé un fric fou, et d’embaucher Guérif qui commençait à en gagner. Il avait une approche assez ouverte. Et puis mon aventure américaine lui plaisait. C’est là qu’a commencé mon histoire avec Rivages, auprès de Guérif. En même temps, je continuais à travailler chez Presses Pocket. Pendant cette période-là, j’ai beaucoup traduit, mais écrit un seul roman de commande chez Fleuve noir, Milana. Un livre un peu mort-né, puisqu’ils ont liquidé la collection. Les romans de commande, avec des contraintes, sont une bonne façon d’apprendre son métier. D’ailleurs en tant que traducteur, j’ai traduit deux des romans « western » d’Elmore Leonard, des romans de commande où, au cours de mon travail, je sentais les contraintes, les règles, le protocole. C’était passionnant, il s’apprenait son métier à lui-même. Milana était plutôt un bon roman, mais je me suis fait mal voir, encore une fois. La guerre en ex-Yougoslavie, c’était un sujet vraiment diabolisé. Il fallait être d’un côté ou de l’autre, forcément. Et nécessairement, je n’avais pas cette approche-là, car Limonov*, qui y allait tous les 15 jours, m’en parlait de façon tout à fait différente. Je suis très fier de ce roman-là.
Ce sont mes voyages en Russie qui ont vraiment tout changé pour moi. Et puis les deux ans de Langues O aussi. Toute la journée, je traduisais des thrillers américains de merde, et le soir j’étudiais le russe aux Langues O. Je me suis fait une espèce de défi intellectuel comme ça, deux langues dans la même journée… J’étais épuisé tout le temps.
C’est intéressant, l’épuisement ?
C’est comme quand on fait du sport : à force de s’entraîner, on a des muscles, on devient endurant.
Et j’ai écrit Fuyards. Dans un silence de mort, car encore une fois la Russie n’était pas à la mode, dans le polar encore moins. J’aurais fait un truc à Chicago, on aurait dit « Mais oui, bien sûr… » Dans le polar en général à l’époque, Moscou c’était un prétexte à des personnages mafieux caricaturaux et bien loin de la vérité d’ailleurs. Ce que je faisais moi, c’était de la pénétration, en prenant les choses de travers, de biais, avec les prisons, etc. : un univers qui n’était familier ni aux lecteurs, ni aux critiques. Ça a fini par séduire, mais ça a mis beaucoup de temps. Encore une fois, c’était trop tôt.
A quai a mieux marché à cause du thème de l’immigration. Là, j’ai eu des chroniques aussi bien de la part des anarchistes de Lyon que de l’extrême-droite de Paris. C’est tout moi ça ! Et puis ça a surpris : quand on fait un roman sur l’immigration, en général, c’est « America, America ! » : l’immigrant qui arrive, l’odyssée de celui qui s’adapte, qui en prend plein la gueule. J’ai situé mon truc dans un lieu complètement différent, en montrant les deux côtés, pour une fois, et j’ai fixé sur le problème de la frontière. Et pour une fois, mon approche a séduit, et chacun s’est approprié le bouquin. Pour moi, c’est mon roman le plus équilibré. Dans l’ensemble d’un livre, ce qui m’intéresse le plus aujourd’hui, c’est l’équilibre. Un équilibre entre la qualité de l’écriture, l’intelligence de la structure, du propos, l’intrigue.
Et la Série noire ?
Aurélien Masson avait adoré A quai, et il sentait bien qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre moi et Guérif. J’avais fait tout ce qu’il ne fallait pas faire, notamment vis-à-vis de l’attachée de presse : pour moi, son boulot, c’était de remplir le frigo, je me foutais de ses états d’âme… Donc Masson a fait ce que font les éditeurs : il m’a attiré dans son orbite. Je lui ai fait un roman, Renegade Boxing Club, et son département marketing s’est plaint de ce que ça ne se vendait pas. Il m’a dit « il faut que tu formates ton truc à la Manchette ». J’ai HORREUR de Manchette, je pense que c’est un idéologue qui a « fait » l’église gauchiste du polar ! J’ai dit « non ».
Qu’est-ce qu’il reprochait à Renegade Boxing Club ?
Principalement que ça ne se vende pas plus. Je pense qu’il aurait voulu que je fasse plus populiste, plus délayé, plus facile d’accès, plus simple. Il voulait que je me plie à sa vision de ce que doit être un polar ou un roman noir. Je ne sais pas faire ça. En plus, Renegade est un roman très sec. D’ailleurs je peux bien le dire, je l’ai déjà dit : le polar, je m’en tamponne le coquillard. J’ai fait dans le polar parce que c’était plus facile à pénétrer que Saint-Germain, à une certaine époque. Ce que je veux, c’est écrire des romans. Moi, l’histoire du flic divorcé avec son chat, qui fait une enquête avec des indices, ça me fait tomber par terre d’ennui. Je n’en lis jamais. Je veux toujours aborder les choses sous un angle biaisé, inattendu, faire un truc fou. Donc Aurélien Masson m’a refusé les deux romans suivants. Un refus ça va, deux ça veut dire ciao.
C’est pour ça que Milieu hostile est sorti chez Baleine.
C’était se rattraper aux branches, ce n’était pas vraiment une bonne idée… C’était un peu un enterrement. Sur celui-là, j’avais encore plus travaillé le style.
Il y a une grande différence de style entre Renegade et Milieu hostile.
Oui, je veux toujours faire différent. Autant Renegade était sec, autant Milieu hostile est lyrique. Je veux toujours faire une chose différente de la fois précédente, ce qui est une erreur sur le plan commercial. Même si j’avais gardé le même personnage de Thomas Dessaigne. Bref, Baleine n’était pas très bien distribué, et en plus le patron intentait un procès à son distributeur. Suite à la publication du bouquin de Brigneau (ndlr : en 2010, Baleine rééditait un roman policier signé par François Brigneau, figure d’extrême-droite…), Baleine avait été mis à l’index par toute la bande Pouy, Daeninckx et compagnie. Et comme ils avaient pas mal d’influence auprès des libraires… En plus, le livre était d’un accès plus difficile, ça parlait de l’Ukraine à une époque où ça n’était pas du tout à la mode. Quand j’y allais, on me disait : « Alors, tu vas en Russie ? », j’étais obligé de répondre : « Non, je vais en Ukraine, ça n’est pas du tout pareil. » Ça n’intéressait rigoureusement personne. Jérome Leroy, mon frère ennemi, m’a dit un jour : « Tu écris tes bouquins trop tôt. » Et effectivement, lui a publié Le Bloc une année d’élection, il n’a donné des interviews qu’à des journaux de gauche. Moi, à l’époque de Fasciste, j’étais jeune et arrogant ! Je ne me rendais pas bien compte de ce que ça représentait, ce titre, en termes de provocation. Mon éditeur voulait appeler le livre « Un fasciste », ou « Le fasciste », et j’ai refusé, catégoriquement… C’était pratiquement du suicide.
Tu as une façon bien à toi de parler des corps, du désir, de la peau, du travail sur le corps.
Quand on fait un travail intellectuel – auteur ou traducteur par exemple … – si on ne s’entretient pas, on devient un cerveau dans un bocal. Je ne conçois pas une vie sans sport. La boxe, c’est une chose que j’ai commencée au sortir de ma période fugueur-toxico. Avant de commencer, il a d’abord fallu nettoyer mon corps de toutes ces saloperies. Le choix de la boxe ? C’était un truc de rue, un truc de mecs, un défi quoi ! Dans Renegade Boxing Club, il y a deux thèmes parallèles : la traduction, travail intellectuel, et la boxe, confrontation physique à soi-même et aux autres. Et le traitement du corps de mes personnages est important pour moi : pour qu’un personnage existe, qu’il habite l’espace, qu’il ait du volume, j’ai besoin de lui donner un corps, qu’il fasse des choses avec son corps, que ce soit un homme ou une femme. Quand je vivais à New York, j’ai effectivement fréquenté le genre de club que je décris dans Renegade. Et puis j’observais les corps, ceux des gens qui habitaient ces quartiers : soit totalement émaciés parce qu’ils prenaient de la coke, soit obèses parce qu’ils avalaient toute la journée du sucre et du gras. Le sort des pauvres, quoi, celui des esclaves…
Et la place des femmes dans tes romans, comment la décrirais-tu ?
J’ai toujours voulu leur donner une vraisemblance, une vraie présence. Ce ne sont jamais des objets, elles ont leur existence propre. Et elles ne réagissent pas comme les hommes. Je m’inspire toujours de mon entourage, de femmes que je connais ou que j’ai connues, pour faire en sorte que leur comportement ne ressemble pas à celui d’un mec. Parce que dans la vie, c’est comme ça. La logique des femmes n’est pas celle des hommes, et elle n’est ni moins ni plus estimable pour autant. Dans Fasciste par exemple, le personnage d’Irène est vraiment directement inspiré des femmes qui naviguaient dans ces milieux-là à l’époque. Ces femmes avaient leur propre façon de s’affirmer, de s’exprimer, et Irène est assez archétypale à cet égard. Dans mes autres romans, le personnage de l’infirmière, par exemple, occupe une place clé. C’est une femme forte, indépendante, déterminée. Il n’y a que dans Renegade Boxing Club que le personnage du mannequin est un peu moins travaillé, parce qu’elle est un peu « plaquée » sur l’histoire. Pour ce livre, j’avais dit à mon éditeur que je ne voulais pas de sexe du tout. Et bien sûr, il renâclait, me disant que je réussissais bien les scènes de sexe. Donc j’ai ajouté le personnage du mannequin tatar à la fin, et je lui ai donné un rôle à jouer dans l’intrigue. Mais ce personnage, effectivement, ne me satisfait pas vraiment.
Tu arrives encore à lire beaucoup de fiction ?
En tant que traducteur, j’ai énormément lu… J’ai beaucoup de mal à lire. J’y arrive quand c’est un auteur qui m’apprend quelque chose. Et finalement la plupart du temps je trouve que c’est de la bouillie, rien à mâcher. Donc je lis mes classiques à moi. Et aussi en langue étrangère, en russe beaucoup, parce que le fait de la langue étrangère oblige à une attention différente. Avec la fiction, la plupart du temps, je m’ennuie. Parce que je me dis « ça je peux faire mieux… » En revanche quand je tombe sur un mec qui sait faire un truc que je ne sais pas faire, je suis vachement content !
Quel est le dernier auteur qui t’ait fait cet effet-là ?
C’est Modiano. Il sait faire un truc que personne d’autre ne sait faire. Il bricole un monde qui est toujours à côté d’un truc historique très prégnant. Il dessine une ambiance à base de nostalgie, et pourtant ce n’est pas un auteur rétro. Et il bricole ça avec très peu de chose en apparence. Ça a l’air très désinvolte, il y a rarement de morceau de bravoure, de style étincelant. Alors maintenant qu’ il est Prix Nobel, ça fait bête de dire ça… Et puis bien sûr, parmi les auteurs que j’ai traduits, il y a Carl Watson. Lui, je me dis que si j’étais écrivain, j’aimerais écrire comme lui. Car je ne me vois pas comme écrivain, mais plutôt comme romancier.
Quelle différence fais-tu entre les deux ?
Romancier, c’est l’art du conteur. Raconter une histoire avec son style défini et sa particularité. Écrivain, c’est beaucoup plus vaste, je n’ai pas cette compétence. Je me vois plutôt comme romancier, c’est plus modeste et c’est mieux d’être modeste !
Et maintenant, là, qu’est-ce que tu veux faire ?
Ayant retrouvé un éditeur, je vais recommencer à écrire un roman. Sans éditeur pendant longtemps, c’était compliqué… J’ai commencé à travailler à partir de bribes de nouvelles que j’avais écrites il y a un moment déjà. Je voudrais retraduire Kozlov**, mais finalement je vais en faire moins dans la traduction car ça gêne l’activité d’auteur. Dans la mesure où j’ai une activité professionnelle séparée, si je retrouve un éditeur qui me suive, je vais vraiment m’y remettre. Après plusieurs années dans le désert…
Justement, comment on vit ça ?
Très mal. Quand tu écris un roman, si ça marche bien, le soir tu t’enfermes dans ton monde, c’est complètement enivrant. Là ça tombe bien, là ça sonne juste… Quand tu n’as plus ça, c’est très douloureux, il y a un vrai manque. On perd cette possibilité-là de se rendre heureux. Même si parfois la composition d’un roman est difficile, je ne fais pas partie de ces gens qui se plaignent de la souffrance dans l’écriture. Moi, j’adore ça, vraiment, et en être privé est très pénible.
Et la reconnaissance, c’est important pour toi ?
Je suis un peu comme ces vieux cabots qui n’arrivent pas à se passer de la scène…
Pour terminer, après la réédition de Fasciste, quels sont tes projets ?
Je suis très content, pour commencer, que cette nouvelle édition soit accompagnée d’une préface de Pierric Guittaut, qui est un jeune auteur de série noire. Il a une très belle écriture : son premier roman était foutraque, le deuxième était un exercice de rigueur, il explose avec le troisième. Une littérature de province, vraiment très intéressante. Avec lui, j’étais le vieux qui donnais des conseils… Mais le texte de Fasciste, je n’y ai pas retouché. Vingt-cinq ans plus tard, je ne sais plus qui j’étais à cette époque-là ! Le livre ressort donc dans une nouvelle collection de romans noirs lancée par les gens de ActuSF, chez Hélios noir.
Le prochain roman qui sortira aux éditions du Rocher, Morphine Monojet, très court, est pourtant un vrai roman, avec une vraie intrigue, des personnages développés. Et puis il y aura, chez Vagabonde, un récit de mon voyage Fos-sur-Mer / New York en porte-conteneur.
***
* Pour mémoire, Thierry Marignac a beaucoup fréquenté Edouard Limonov lorsque ce dernier vivait à Paris dans les années 80, puis en Russie après le retour au pays de Limonov. Ils sont toujours amis.
** Vladimir Kozlov est un auteur russe né en 1972 et auteur de plus d’une douzaine de livres, romans et essais. Il a publié en France Racailles (2010) et Retour à la case départ (2012), tous deux publiés par Moisson rouge et traduits par Thierry Marignac. Voir ici le compte rendu d’une rencontre avec l’auteur à la librairie du Globe en 2012.
***
BIBLIOGRAPHIE
Romans
Fasciste, éditions Payot, 1988 – Réédition ActuSF « Hélios noir », 2015
Milieu hostile, éditions Baleine, 2011
Renegade Boxing Club, Gallimard, Série noire, 2009
À Quai, éditions Rivages/Noir, 2006
Fuyards, éditions Rivages/Noir, 2003
Milana, éditions Fleuve Noir, 1996
Cargaison, éditions Le Rocher, 1992
Nouvelles
Le pays où la mort est moins chère, Moisson rouge, 2009
Document
Vint, le roman noir des drogues en Ukraine, éditions Payot Documents, 2006.
Essais
Des chansons pour les sirènes, Essenine, Tchoudakov, Medvedeva, Saltimbanques russes du XXe siècle (avec la collaboration de Kira Sapguir), L’Écarlate, 2012
De la traduction littéraire comme stupéfiant, fascicule-revue DTV-Exotic, 2002. Lire ici
Norman Mailer, économie du machisme, éditions Le Rocher, collection « Les Infréquentables », 1990.