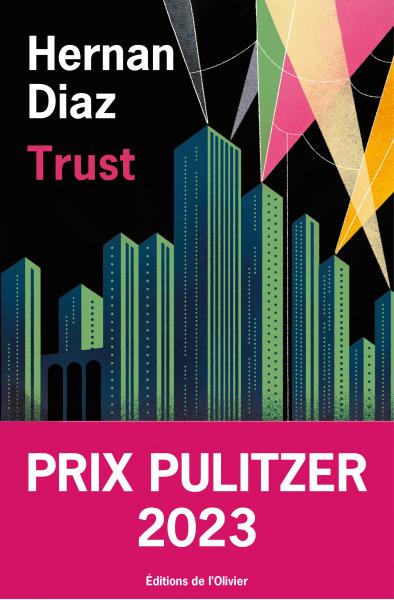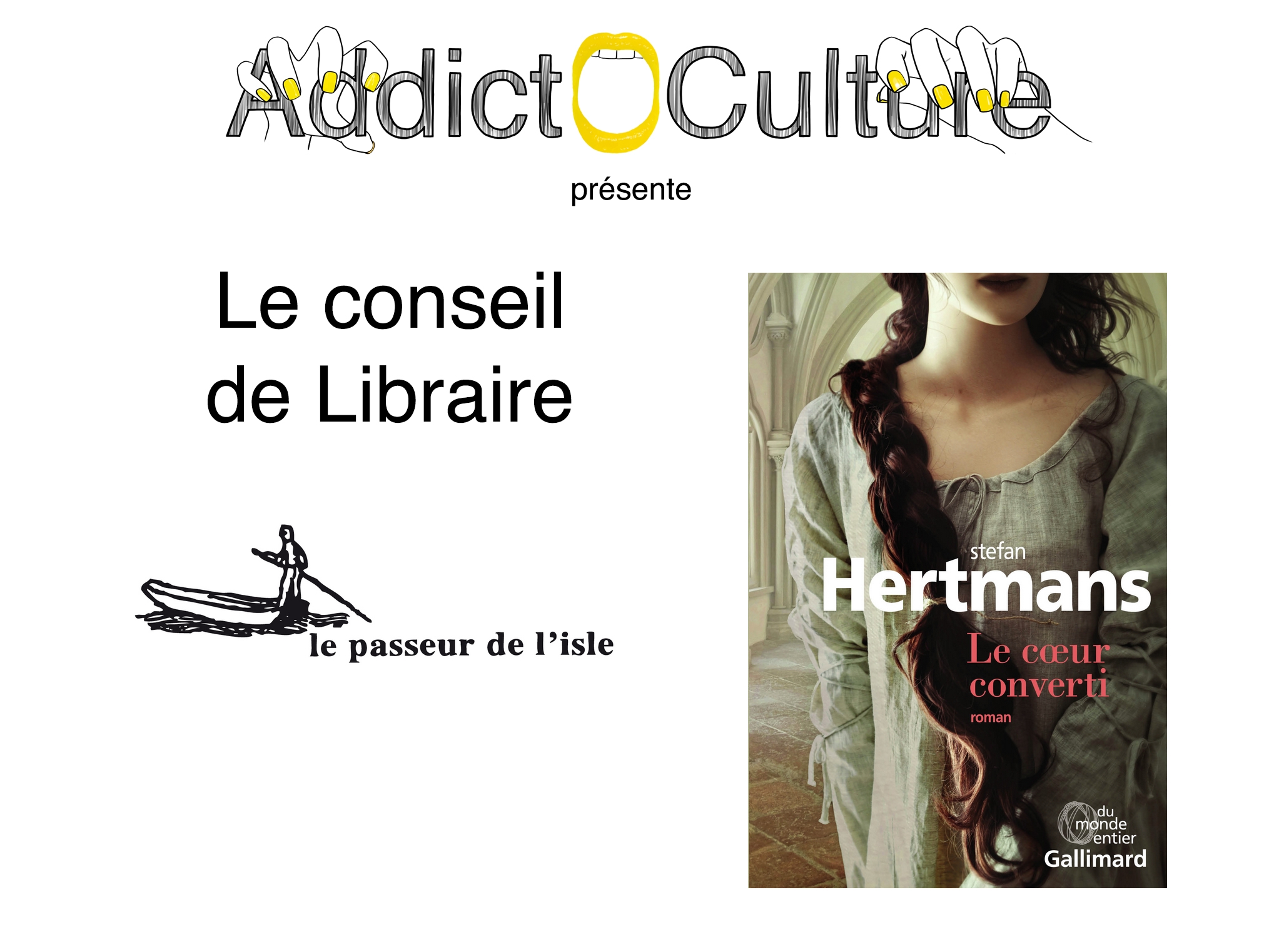Toi qui ouvre Trust, abandonne toute certitude. Ce livre ne fait qu’une bouchée de son lecteur. Il le balade allègrement dans un labyrinthe sans même que celui-ci ne le soupçonne. De là à penser qu’il pourrait souffler un grand vent de modernité sur la littérature contemporaine, il n’y a qu’un pas que l’on a très envie de franchir.
Plus qu’un roman, Trust est une poupée gigogne. Une telle habilité dans la construction semble d’ailleurs justifier à elle seule l’obtention du Prix Pulitzer de la fiction. Mais bien sûr il n’y a pas que ça. Ce texte parvient aussi à rendre clair un monde des plus opaques, celui du « grand capital », ces fortunes incommensurables qui sont à l’origine du monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Et plus encore, ce roman sonde l’esprit humain en plongeant à des profondeurs rarement atteintes.
Pour ne rien dévoyer de ce roman à clé, prenons garde à ne pas trop en dire. Sous peine de (divul)gâcher le plaisir des futurs lecteurs, il faudra se limiter à n’évoquer que la première des quatre parties qui composent le roman. Une partie qui pourrait presque se suffire à elle-même – le lecteur n’en sera que plus dérouté lorsqu’arrivera la première césure. L’entrée en matière est splendide : l’écriture est si fine qu’elle semble emprunter à l’orfèvrerie. Un style qui, plus tard, saura se renouveler… mais n’allons pas trop vite en besogne sous peine de trop en révéler.

Revenons-en à l’intrigue socle du roman. Voici l’histoire de Benjamin Rask, un homme à qui « l’un des rares privilèges (…) refusés [fût] celui de connaître une ascension héroïque », puisque c’était déjà fait par ses ancêtres avant lui. Des ancêtres que le sens des affaires avaient mis à l’abri du besoin pour plusieurs générations. Mais le jeune Benjamin ne se contentera pas de cet acquis. Il se découvre « un désir profond dont il avait ignoré l’existence jusqu’à ce qu’on lui présentât un appât assez gros pour qu’il prît vie » : il ne cessera dès lors de spéculer, faisant fructifier un héritage jusqu’à lui faire atteindre des sommets. Au tournant du siècle dernier, la bourse de Wall Street connaîtra en effet une croissance exponentielle, relancée par l’avènement de grandes sociétés industrielles. Le plus grand des marchés financiers modernes était né – et Benjamin Rask allait le pouponner.
« Son repli sur soi s’exacerba à mesure qu’il prenait de l’envergure. Plus ses investissements s’étendaient en profondeur dans la société, plus il se renfermait. On eût dit que les médiations quasiment infinies qui constituent une fortune – actions et obligations liées à des sociétés commerciales, liées à des terres et des équipements et des multitudes laborieuses logées, nourries et vêtues via le labeur d’autres multitudes de par le monde, payées dans diverses monnaies dotées d’une valeur, laquelle faisait elle aussi l’objet d’échanges et de spéculations, liée au destin de différentes économies nationales liées, en définitive, à des sociétés commerciales liées à des actions et des obligations – avaient rendu caduques, à ses yeux, les relations immédiates. Pourtant, lorsqu’il atteignit puis dépassa ce qu’il pensait être le mitan de sa vie, un vague sentiment de responsabilité généalogique, mêlé à une notion plus confuse encore de propriété, lui fit envisager le mariage ».
─ Hernan Diaz, Trust
L’auteur ne s’appesantit pas sur le succès de cet homme, mais bien sur ses ressorts cachés. Benjamin Rask est taciturne ; il trouvera donc en Helen Brevoort une compagne idéale tant cette femme fuit également la vie mondaine. Issue d’une vieille famille américaine, elle n’a pour elle que son nom, à défaut d’une fortune familiale évaporée. Evaporée aussi la conscience de son père, qui a progressivement perdu l’esprit. Sa rencontre avec l’homme d’affaires sera providentielle pour prendre ses distances avec une mère trop démonstrative et devenir ce qu’elle a foncièrement toujours été : une ombre se nourrissant de littérature et de musique. Une ombre à la santé mentale fragile.
La réussite considérable cache donc un secret. Un secret dont le lecteur croit se rapprocher, tandis qu’il est confortablement installé… c’est qu’il ne sait pas encore que cette histoire, pourtant facile d’accès, recèle bien des surprises. Ce roman lui fera l’effet de traverser des trous d’airs, donnant l’impression de revenir sans cesse au point de départ. Plus l’on pense se rapprocher de la vérité, plus l’on s’égare.
C’est tout l’art d’écrire,
de réécrire,
de raconter une histoire
qui est mise en cause
Ce qui n’était somme toute, jusqu’ici, qu’une belle et triste histoire, révèle des ressorts étourdissants. La bise devient tempête, renversant tout sur son passage, dévoilant tous ses artifices. L’intrigue détruit les croyances qu’elle avait elle-même tissées dans le cerveau du lecteur. Impossible d’en vouloir à l’auteur : bien au contraire, on en redemande, tant il rend captivantes ces entourloupes et que l’on veut connaître le fin mot de l’histoire.
Le fin mot de l’histoire justement est d’autant plus remarquable qu’il va bien au-delà de la seule intrigue. Car ce que semble dénoncer Hernan Diaz est plus retors encore : la vraie escroquerie dans tout ça est probablement le phénomène du storytelling, ce procédé qui consiste à faire la promotion d’une idée, d’un produit, d’un homme, à travers un récit construit dans le but de convaincre ou de séduire. C’est tout l’art d’écrire, de réécrire, de raconter une histoire qui est mis en cause ici.