Cinq disques, nouveaux ou récents, pour rentrer de plein pied dans l’automne qui s’ouvre à nous.
[mks_col]
[mks_one_third]

[/mks_one_third]
[mks_one_third]
Pierre Daven-Keller – Kino Music
Disponible en vinyle et digital depuis le 27 septembre 2019 via Kwaidan Records.
[/mks_one_third]
[mks_one_third]
[/mks_one_third]
[/mks_col]
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]près deux albums placés sous le signe de la chanson orchestrale raffinée, publiés sous son véritable patronyme au tournant du nouveau millénaire, puis trois longs formats parus sous l’alias Daven Keller et la confection de quelques bandes originales de films (notamment pour le compte de Thierry Jousse, Catherine Corsini et les frères Larrieu), le Français Pierre Bondu est de retour avec Kino Music, son premier disque en dix ans à bénéficier d’une véritable distribution via le label Kwaidan Records.
Le fait que ce projet paraisse sous une double identité, mêlant pour la première fois, pour une sortie en son nom propre, son prénom de naissance et son plus récent pseudonyme, n’est absolument pas fortuit : en quatorze plages minutieuses et cinématiques, le compositeur affûté (et arrangeur émérite) a choisi de conjuguer dans un même élan ses deux facettes les plus évidentes. En effet, derrière l’hommage délicat aux plus grands couturiers italiens de la musique de film, de l’incontournable Ennio Morricone au mythique Nino Rota, en passant par le plus contemporain Nicola Piovani, ce disque présente tous les traits les plus emblématiques du parfait objet pop, incrustant ses mélodies entêtantes dans des formats concis et accrocheurs.
Et malgré sa dimension essentiellement instrumentale, de la bossa nova lardée de cordes de Melancholia aux chatoyantes enluminures de Daiquiri ou Sirocco, en passant par les plus énergiques et délicieusement rétro Jerk et Farfisa, le facétieux Pierre Daven-Keller a convié à sa séance très spéciale quelques invitées triées sur le volet. Ainsi, on retrouve avec plaisir la toujours parfaite Helena Noguerra sur deux titres, dont l’éminemment sensuel et suggestif La Fiancée De L’Atome, tandis que l’ultra-solaire Salvaje Corazon voit l’excentrique Arielle Dombasle se poser avec une retenue toute charmeuse, avant de se voir décliné en version italienne en toute fin de parcours par la pétillante Mareva Galanter.
Servies tour à tour par un clavecin évocateur, des notes de piano fantomatiques, une basse ronde et rugueuse ou des rythmiques hypnotiques, ces quarante minutes hors du temps, perchées entre nostalgie rêveuse et sensualité trouble, n’ont nul besoin d’images pour leur servir d’écrin : celles qu’elles vous mettront en tête seront assurément les meilleures possible.
French Godgiven
[mks_separator style= »blank » height= »10″]
[mks_col]
[mks_one_third]

[/mks_one_third]
[mks_one_third]
Ruby Haunt – The Middle Of Nowhere
L’album est sorti depuis le 30 septembre en autoproduction.
[/mks_one_third]
[mks_one_third]
[/mks_one_third]
[/mks_col]
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]D[/mks_dropcap]éjà quatre albums et tout autant d’EPs au compteur des américains de Ruby Haunt, et pourtant il semblerait bien que ce duo de Los Angeles, composé de Wyatt Ininns et Victor Pakpour, reste encore un secret bien gardé, dans nos contrées comme ailleurs. Sans doute que le choix de l’autoproduction y est pour quelque chose, car lorsque l’on prend le temps d’écouter leur musique, il paraît aberrant qu’aucun label ne se soit précipité pour les signer !
Deux amis d’enfance qui officient depuis 2015, difficile d’en savoir plus sur leur travail, les données sont plutôt rares sur la toile, les chroniques aussi, alors dans ce cas-là il ne reste que la musique pour en parler, et c’est déjà pas mal. Après un album parfait en tous points, du moins pour ma part puisqu’il a fini dans mes vingt albums de l’année 2018.
Blue Hour était un condensé de dream pop à tendance cold wave, même s’ils aiment a priori qualifier leur musique de soft punk. Les dénominations étant souvent un véritable casse-tête, au final nous retiendrons des nappes de synthés éthérées, une boîte à rythme bien balancée, une basse ronde et omniprésente, et des touches de guitare en forme d’écho, des arrangements minimalistes rehaussés par une voix mélancolique à souhait.
Pour ce nouvel album, The Middle Of Nowhere, rien de neuf sous le soleil, et c’est justement ce que j’aime dans leur musique, le minimalisme, la nostalgie qui se dégage de chaque morceau, comme une bande son introspective, dans laquelle il est parfois nécessaire de se réfugier. Une douce froideur venue pourtant du soleil, le paradoxe est réjouissant, et le temps de ces neuf titres je vous invite à vivre l’expérience Ruby Haunt, et j’espère que l’on finira par les remarquer, enfin !
Pour les amateurs de Beach House, Cigarettes After Sex, Fog Lake, Cemeteries… et autres délices dream popesques !
Mag Chinaski
[mks_col]
[mks_one_third]
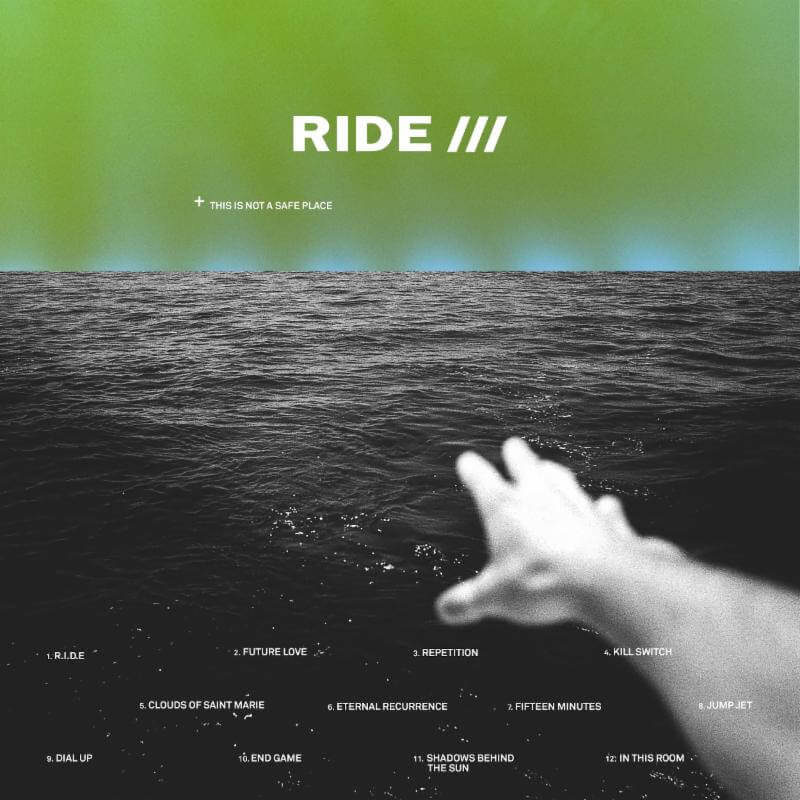
[/mks_one_third]
[mks_one_third]
Ride – This Is Not A Safe Place
Disponible en CD, vinyle et digital depuis le 16 août 2019 via Wichita Recordings.
[/mks_one_third]
[mks_one_third]
[/mks_one_third]
[/mks_col]
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]Q[/mks_dropcap]ue faire lorsque l’on est un groupe qui n’a plus rien à attendre, ni de ses fans ni de ses détracteurs ? Depuis son retour aux affaires en 2014, après une séparation acrimonieuse suivie de dix-huit ans d’absence, le quartet britannique Ride, fer de lance d’un shoegaze mélodique et accrocheur au début des années 90, semble avoir trouvé la réponse : tout ce qui nous passe par la tête. Deux ans à peine après la publication d’un très digne Weather Diaries, les gamins d’Oxford devenus adultes retrouvent le producteur Erol Alkan et délivrent un disque encore plus éclectique, fiévreux et habité que son prédécesseur.
Sans atteindre les cimes du massif Nowhere (1990) ou du kaléidoscopique Going Blank Again (1992), ce This Is Not A Safe Place démontre avec classe que Mark Gardener, Andy Bell, Loz Colbert et Steve Queralt ont encore bien des choses à exprimer, bien au-delà de tout hypothétique appât du gain : pour les amateurs sincères dépourvus de nostalgie futile, il y a ici suffisamment de merveilles inattendues pour pouvoir se permettre de faire fi de leur passif, aussi prestigieux soit-il. De la pop aérienne de Future Love à la rêverie pastorale de Clouds Of Saint Marie, en passant par le motif synthétique obsédant du roboratif Repetition ou le riff tranchant du brûlant Kill Switch, il faudrait faire preuve d’une mauvaise foi carabinée pour ne pas trouver son bonheur, même si ces salves réjouissantes s’éloignent radicalement de l’incandescence juvénile qui irradiait leurs deux classiques d’antan.
Mais la réussite de ce sixième album studio ne tient pas qu’à la volonté farouche de ses protagonistes de s’affranchir d’un passé pourtant pas toujours glorieux : on se souvient en effet que le Carnival Of Light de 1994 fut leur nadir critique, troquant dangereusement les oripeaux noise les plus caractéristiques du shoegaze pour embrasser une dimension plus ouvertement vintage et psychédélique, ou que le poussif Tarantula signait en 1996 la fin du groupe. Au travers de la charge bondissante du fédérateur Jump Jet, de la chaleur tamisée de la ballade Dial Up ou de la torpeur hypnotique du splendide final In This Room, les membres de Ride prouvent qu’ils ont enfin réussi à affiner avec maîtrise et sagesse la diversité de leur propos : en portant un regard salvateur sur leurs erreurs de jugement passées, il semblerait même qu’ils aient retrouvé dans le même mouvement la source de leur insouciance des tout débuts.
Et pour ceux qui trouveraient encore à rechigner sur cette belle et probante renaissance, il sera toujours utile de souligner la subtile référence à la pochette de Nowhere dans le visuel de ce nouvel album, en adaptant à leur cas une célèbre maxime : lorsque la main montre l’océan, l’idiot regarde les doigts.
French Godgiven
[mks_col]
[mks_one_third]
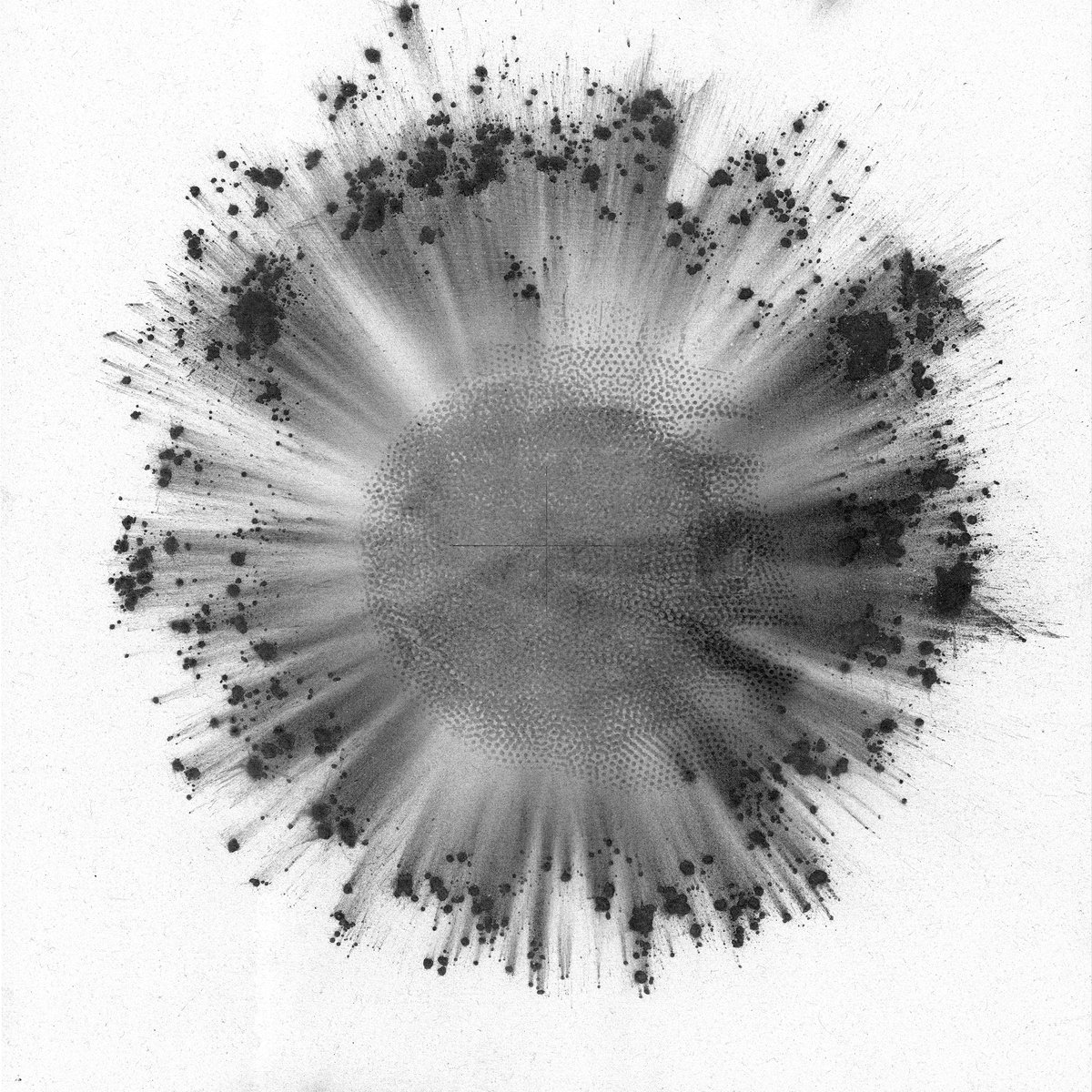
[/mks_one_third]
[mks_one_third]
Trentemøller – Obverse
Disponible en CD, vinyle et digital depuis le 27 septembre 2019 via In My Room.
[/mks_one_third]
[mks_one_third]
[/mks_one_third]
[/mks_col]
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]utant le dire d’entrée, le cinquième véritable album du producteur électro Anders Trentemøller est très certainement le moins accessible de tous les disques parus jusqu’ici sous son nom. Loin des enchevêtrements complexes et pourtant hypnotiques de The Last Resort (2006), comme de la langueur électrisante du cinématique Into The Great Wide Yonder (2010) ou des élans plus ouvertement pop des très réussis Lost (2013) et Fixion (2016), le plus difficile et néanmoins passionnant Obverse dessine un monolithe musical d’une noirceur souvent insondable, tout dédié à la gloire de l’expérimentation sonore et des techniques de studio les plus pointues.
Prévu à l’origine pour être entièrement instrumental, ce disque magnétique voit pour la première fois le Danois se dégager de la contrainte matérielle liée à la transcription scénique de sa musique, laissant libre court à son inventivité débridée, traitant notamment les voix de ses quelques invitées comme des instruments à part entière. Entre sons de guitares tantôt languides ou torturées à l’extrême, rythmiques lourdes voire increvables et nappes de synthés glaçantes, une ambiance sombre et inquiétante nimbe la progression sinueuse d’un Cold Comfort qu’irradie de sa présence voluptueuse Rachel Goswell (chanteuse des icônes shoegaze de Slowdive), tandis qu’une basse rugueuse et titanesque guide Lina Tullgren à travers la flippante promenade In The Garden ou qu’une pulsation subtilement tribale porte la Jennylee de Warpaint sur un Try A Little à la flamme charmeuse et chancelante.
Même les quelques moments lumineux du disques, posés comme des balises de survie dans un marécage inextricable, ne peuvent éluder à eux seuls la pulsation vénéneuse qui anime le redoutable Trnt, l’épais brouillard qui habite le sépulcral Foggy Figures, dont on ne s’extirpe que par une cavalcade singulièrement déchaînée, ou la myriade d’effets menaçants déployée sur l’oppressant Church Of Trees. Et pourtant, si la volonté de contraste se montre toujours aussi cruciale dans le travail d’orfèvre de Trentemøller, il paraît clair que le groove nacré de Blue September et l’aura éclatante de One Last Kiss To Remember, deux titres interprétés avec une ferveur habitée par Lisbet Fritze et constituant ce qui s’apparente le plus ici à des chansons structurées, semblent bel et bien forgés du même acier trempé que le climatique Sleeper ou l’évanescent final Giants.
Avec sa pochette trompeuse (le négatif d’un cliché de feu d’artifice) et son titre faussement dyslexique, suggérant le souhait de concevoir sous un angle alternatif sa propre musique et, par extension, le monde, ce nouvel album pourrait bien être, en creux, le plus sensible et passionnant jamais délivré par Anders Trentemøller. Pour peu que l’on parvienne, au fil des écoutes, à franchir les fascinantes strates de barbelés formels que son art total, toujours aussi unique et immédiatement identifiable, arbore ici comme jamais, il est bien possible que les émotions qu’elles renferment jalousement s’avèrent être, sur la longueur, les plus captivantes jamais exprimées par leur créateur.
French Godgiven
[mks_col]
[mks_one_third]

[/mks_one_third]
[mks_one_third]
M83 – DSVII
Disponible en CD, vinyle et digital depuis le 20 septembre 2019 via Naïve/Believe.
[/mks_one_third]
[mks_one_third]
[/mks_one_third]
[/mks_col]
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]T[/mks_dropcap]outes les apparences, de l’acronyme aisément déchiffrable de son titre à sa nature essentiellement apaisée et instrumentale, semblent indiquer que le huitième album du collectif électro-pop M83 serait la suite logique du Digital Shades Vol.1 paru il y a maintenant douze ans : sur ce disque épuré et élégiaque, l’Antibois Anthony Gonzalez rendait, avec une ferveur palpable, un hommage appuyé au courant spécifique de la musique dite ambient, régulièrement associée à des figures iconiques telles que le pionnier Brian Eno ou l’insaisissable Aphex Twin.
Bien que partageant de nombreuses caractéristiques avec son aîné conceptuel, DSVII s’inscrit pourtant davantage dans la lignée de son prédécesseur direct, le très discuté Junk, qui voyait Anthony Gonzalez se réapproprier avec force les sonorités les plus controversées des années 80, pour mieux les transcender dans un grand geste pop d’une modernité indéniable. Poursuivant le travail de fond ainsi amorcé en puisant plus profondément encore dans un passé idéalisé, pour y trouver le carburant de son présent suspendu, le producteur exalté parvient à tisser son propre univers, personnel et immersif, à partir d’évocations toutes plus référencées les unes que les autres .
Du clin d’oeil au mythique Electric Counterpoint de Steve Reich qui anime l’ouverture majestueuse de Hell Riders au sensuel Mirage qui rappelle la partition concoctée par Vangelis pour le Blade Runner de Ridley Scott, de l’enivrant Goodbye Captain Lee, cousin éloigné du sublime Merry Christmas Mr Lawrence de Ryuichi Sakamoto, à ces émouvants Jeux D’Enfants qui dessinent une suite fantasmée à l’introduction pianistique du célèbre Moments In Love d’Art Of Noise, c’est surtout, en définitive, la passion de Gonzalez, sincère et dénuée de la moindre ironie, qui emporte tout sur son passage. Qu’il nous invite à une chaleureuse réunion entre amis sur le boisé Meet The Friends, nous assène une renversante ritournelle avec le poignant Feelings ou nous entraîne vers des hauteurs vertigineuses sur un Temple Of Sorrow sublimé par un choeur d’anges, sa science aiguisée d’un maximalisme pertinent laisse respirer comme jamais une introspection aussi sobrement diffuse que profondément bouleversante.
Les compositeurs parvenant à nous balader harmonieusement d’un sentiment à l’autre en un seul changement d’accord, ou à nous ouvrir à de nouvelles perspectives émotionnelles en quelques mesures à peine, sont rares et précieux. Ce magnifique DSVII, tel une île sensorielle perdue dans l’espace-temps, entre courants synthétiques, explosions de couleurs et voix diaphanes, confirme avec une classe stupéfiante qu’Anthony Gonzalez est bel et bien l’un d’entre eux.





















