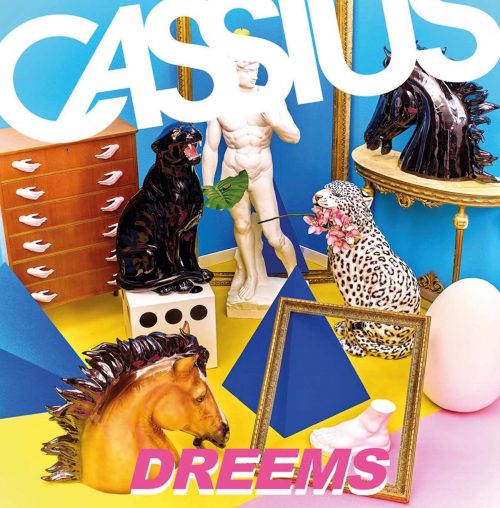« If it’s life that you’re running from / There’s no better place. »
(« Si c’est la vie courante que tu veux fuir / Il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici. »)
Cassius feat. Vula Malinga, W18
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]u sein de la scène musicale française contemporaine, le duo Cassius tient une place vraiment très particulière : Philippe Cerboneschi (dit Zdar) et Hubert Blanc-Francard (dit Boombass) sont arrivés avant tout le monde, ont ouvert (et tenu) quantité de portes à un nombre incalculable de leurs pairs, et n’en ont pas toujours tiré les meilleurs bénéfices possibles, tant sur les plans artistiques que commerciaux. Dire que la renommée de leur travail auprès du grand public, au-delà de leurs personnalités lumineuses, est inversement proportionnelle à leur influence réelle serait, pour le moins, un doux euphémisme.

[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]T[/mks_dropcap]out remonte à la rencontre impromptue entre les deux futurs compères, il y a une trentaine d’années déjà, lorsque le premier était l’assistant d’un ingénieur du son de renom, qui n’était autre que le père du second. Par l’un de ces concours de circonstances qui font tout le sel des plus belles pages de l’Histoire de la musique, nos deux amis se retrouvent très vite à travailler avec un jeune rappeur français montant, la future superstar MC Solaar : Hubert lui troussera ainsi une série d’instrumentaux hip hop enlevés et puissants, tandis que Philippe taillera les strates sonores résultantes derrière sa table de mixage.
[mks_pullquote align= »left » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#1A67B0″]Alors que les futurs Daft Punk ou Air biberonnaient encore à la pop indépendante britannique, Boombass et Zdar firent donc leurs premières armes dans l’univers du hip hop.[/mks_pullquote]
C’est déjà à cette époque que s’affirme ce qui différenciera, profondément et durablement, les deux hommes de leurs concurrents à venir au sein de la mouvance de la French Touch : alors que les futurs Daft Punk ou Air biberonnaient encore à la pop indépendante britannique, Boombass et Zdar firent donc leurs premières armes dans l’univers du hip hop, avant même de plonger dans celui de la house ou de la techno, ce qui les rapproche très clairement des modèles américains du genre que sont l’emblématique Kenny « Dope » Gonzalez des mythiques Masters At Work ou le trop rare Sandy Rivera de l’entité Kings Of Tomorrow, dont l’évolution stylistique est tout à fait similaire sur la longueur.
Ainsi, des années avant l’explosion des musiques électroniques, le savoir-faire de Boombass et Zdar traversera la Manche, le DJ britannique Gilles Peterson, chantre de l’acid-jazz alors en vogue et personnalité influente du circuit de l’époque, y assurant avec enthousiasme la promotion des premiers singles, pourtant intégralement francophones, de MC Solaar. Dans la foulée, un certain James Lavelle, à la tête du label Mo’Wax qui contribuera largement à lancer la mouvance du trip hop, les incite à rallonger leurs digressions instrumentales pour confectionner de longues jams hypnotiques, à base de samples évocateurs et de rythmiques insistantes. Conçue sous l’alias de La Funk Mob, la poignée de titres ainsi publiés suffira à conférer aux deux Français une aura conséquente et prometteuse.
[mks_pullquote align= »right » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#1a67b0″]Après des lunes de moqueries adressées à l’encontre du rock made in France, l’Hexagone allait enfin pouvoir exporter à l’international autre chose que son vin.[/mks_pullquote]
À l’été 1996, la publication de l’album Pansoul, vigoureuse variation psychotrope des canons de la house music fomentée par Philippe Zdar en compagnie d’un Etienne De Crécy alors débutant, sous la bannière de l’éphémère projet Motorbass (qui donnera tout de même son nom au studio monté par le premier quelques années plus tard), posera les bases d’une révolution culturelle d’envergure : après des lunes de moqueries adressées à l’encontre du rock made in France, l’Hexagone allait enfin pouvoir exporter à l’international autre chose que son vin.

La même année, Philippe et Hubert délaisseront les transes chaloupées de La Funk Mob pour embrasser, plus profondément encore, les charmes des musiques les plus ostensiblement remuantes : sous l’alias percutant de Cassius, référence appuyée au véritable prénom de l’illustre boxeur Mohamed Ali, le tandem produira une house music funky et débridée, transcendant son art du sampling par une sève groovy implacable, apte à dévaster n’importe quel dancefloor. Trois ans plus tard, la parution d’un premier album sous cette nouvelle identité, le bien-nommé 1999, porté par les accrocheurs singles Cassius 1999 et Feeling For You, confirmera la place de choix occupée par Zdar et Boombass aux premières loges de l’avènement de la French Touch.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]M[/mks_dropcap]ais comme toute mode, celle-ci n’allait pas échapper à la règle cruelle des descentes annoncées : contrairement à ses illustres pairs qui allaient pérenniser et consolider leur succès, tout en élargissant avec brio leurs fondations esthétiques, Cassius allait faire montre d’une totale absence de calcul lors de la conception du vertigineux Au Rêve, qui délaissera avec panache (ou inconscience) tous les codes de bonne conduite alors en vigueur, plongeant à corps perdu dans toutes les obsessions de ses auteurs, plurielles et ô combien diverses, tout en conviant à la noce un nombre conséquent de contributeurs extérieurs.
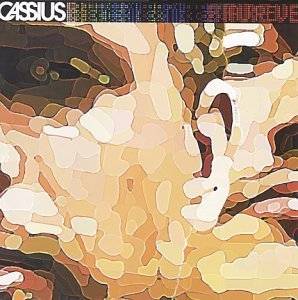
Du riff de guitare sauvage servi par l’ami Matthieu Chedid (alias -M-), qui ouvre puis traverse l’irrésistible The Sound Of Violence, sublimé par le chant solaire de Steve Edwards, à la rythmique hip house névrotique du puissant Thrilla, scandé par le rappeur Ghostface Killah, transfuge de l’illustre Wu-Tang Clan, en passant par la bombe I’m A Woman, propulsée par la voix phénoménale de la diva garage Jocelyn Brown, le disque fait véritablement feu de tout bois, au point de voir Zdar lui-même donner du micro sur quelques titres, dans une performance vocale trafiquée qui évoque irrésistiblement celles accomplies par un certain Prince, lorsqu’il s’était inventé sur disque un double féminin fantasmagorique répondant au mystérieux nom de Camille.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]M[/mks_dropcap]algré toute la bonne foi du duo et de nombreuses réussites formelles indéniables, ce (trop ?) long et épique deuxième album sera un cuisant échec critique et public, le revers commercial ainsi infligé allant jusqu’à faire chuter leur enviable statut d’indiscutables fers de lance vers le purgatoire des héros démodés.

Aussi injuste soit-elle, cette situation ne freinera nullement les deux membres de Cassius, qui creuseront encore leur sillon outrageusement personnel, assumant jusqu’à l’incohérence frondeuse toute la palette de leurs envies et de leurs influences, quitte à prêter le flanc à l’incompréhension la plus totale : le nadir conceptuel sera malheureusement atteint en 2006 avec le pourtant réussi 15 Again qui, à la manière du Brotherhood des mancuniens de New Order, se scindera en deux moitiés quasi-distinctes, séparant bien trop arbitrairement les pistes les plus électriques des titres plus ouvertement dansants. Assis entre deux chaises trop écartées, on peut facilement se retrouver à terre.
Lassé par ces électrons décidément trop libres, dont la perspective de consécration définitive semble s’éloigner toujours davantage, au fil de sorties toujours plus iconoclastes les unes que les autres, le label Virgin finira par remercier abruptement le duo, quelques mois après la sortie de l’unique single extrait de ce nouvel album : le bondissant Toop Toop, bien qu’obtenant les faveurs d’une partie de la bande FM nationale, ne parviendra pas à inverser la tendance.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]V[/mks_dropcap]ous aimez les belles histoires ? Celles qui finissent bien, envers et contre tout ? Personnellement j’en raffole, bien que par les temps qui galopent, elles se fassent très rares.
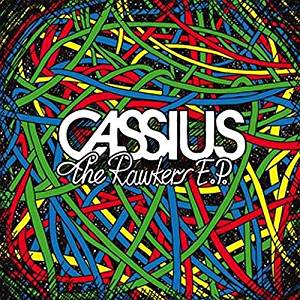
Alors que tout semblait perdu pour ce qui concernait la postérité artistique de Cassius, et que Philippe Zdar se consacrait de plus en plus à son accaparant travail de producteur, très apprécié par toute une frange de l’électro-pop internationale, le duo trouvera refuge sur Ed Banger Records, label pourvoyeur de turbines électroniques massives fondé par l’ami Pedro Winter, y publiant coup sur coup en 2010 l’excellent EP The Rawkers et, surtout, le single I ♥ U So qui, à lui seul, suffira à redorer leur aura critique et, mieux encore, à les révéler à une toute nouvelle frange du public.
Astucieusement bâti sur un déchirant sample vocal tiré d’un standard oublié, le I Feel A Song (In My Heart) de Sandra Richardson, ce tube soul futuriste connaîtra un tel retentissement que les stars absolues du rap US, Jay-Z et Kanye West, le reprendront quasiment in extenso pour façonner leur propre Why I Love You, conclusion épique de leur blockbuster musical commun, le Watch The Throne de 2011.
[mks_pullquote align= »left » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#1a67b0″]Si [avec Random Access Memories] les Daft Punk avaient réalisé là l’équivalent d’un Sgt. Pepper pour la génération French Touch, Ibifornia de Cassius aurait bien pu en constituer le Pet Sounds.[/mks_pullquote]
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]S[/mks_dropcap]avourant avec humilité cet inespéré retour en grâce, Philippe Zdar et Hubert Boombass prendront tout leur temps pour donner une suite à leurs sinueuses aventures musicales. Après plus de deux ans d’un travail acharné étalé entre février 2013 et mai 2015, Cassius publiera à la fin de l’été 2016 le foisonnant et fascinant Ibifornia, dont le contenu confirme avec une ferveur impressionnante toute l’ambition de son titre : caressant l’idéal d’un croisement rêvé entre house baléarique et pop californienne, ce quatrième long format convoque à la fête des artistes aussi divers que la divine Cat Power, le fougueux Mike D des Beastie Boys ou le fidèle ami Pharrell Williams, déjà présent sur 15 Again dix ans plus tôt, bien avant le carton planétaire du Get Lucky de Daft Punk auquel, comme ici, il prêta sa voix pailletée et sa nonchalance funky.

À ce propos, dans un monde idéal, il ne fait nul doute que cet Ibifornia aurait largement mérité le même éclatant succès que le Random Access Memories ourdi par Thomas Bangalter et Guy-Manuel De Homem-Christo en 2013 : en forçant le trait tout en inversant l’ordre de parution des objets de ma tentative de comparaison hasardeuse, on pourrait dire que si les Daft Punk avaient peut-être réalisé là l’équivalent d’un Sgt. Pepper pour la génération French Touch, en forme d’ovni pop choral et protéiforme, l’album de Cassius aurait bien pu en constituer le Pet Sounds. Avec ses enivrantes constructions en savants empilements de couches sonores, sa ferveur habitée confinant au mystique et son impérieuse maîtrise du moindre détail sonore, ce disque ne sera pourtant qu’une réussite en demi-teinte pour le duo : le très bon accueil critique ne se transformera pas en adhésion du grand public, malgré la beauté renversante d’une ballade ciselée comme Feel Like Me ou le fort potentiel d’ogives dancefloor brillamment balancées, telle cette Action aux habiles circonvolutions tribales.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]C[/mks_dropcap]ependant, loin de décourager Philippe Zdar et Hubert Boombass une nouvelle fois, la possible déception, compréhensible et concomitante à ce tiède accueil, se transformera en vigoureuse montée de sève dès l’année suivante. Si le duo assumera avec panache ses marottes de production léchée et exigeante, quitte à avoir perdu trop de temps dans des digressions absurdement chronophages, la volonté de retrouver la spontanéité et l’urgence de leurs débuts portera leur rythme de sorties vers un emballement relativement inédit : au printemps 2017, Cassius offrira la primeur du merveilleux Fame, tout en tension feutrée, à une compilation du label Ed Banger qui célébrait là sa centième sortie, puis publiera l’année suivante le lumineux et insistant W18, mise à jour futée de leur I’m A Woman d’antan, avant de nous offrir, en mai dernier, le manifeste fédérateur et énergique du redoutable Rock Non Stop.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]vec une impatience gourmande qu’on leur pensait étrangère, Philippe et Hubert ont mis un point d’honneur à mettre de côté leur perfectionnisme caractéristique, pour s’imposer la mise en boîte la plus rapide possible d’un nouvel album. Prévu pour être finalisé en quelques semaines qui se transformeront malgré tout en mois, le séduisant et accrocheur Dreems publié en juin dernier réussit haut la main un double pari risqué : simultanément, constituer un beau retour aux sources et une rafraîchissante remise en question de leurs fondamentaux.
[mks_pullquote align= »right » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#1a67b0″]Dreems réussit haut la main un double pari risqué : simultanément, constituer un beau retour aux sources et une rafraîchissante remise en question de leurs fondamentaux.[/mks_pullquote]
Construit à la manière d’un DJ set haletant, aux faux airs de soundsystem à l’ancienne, croisant les sources sonores de plusieurs plages entre elles pour conférer à l’ensemble une troublante homogénéité qui ne nuit cependant en rien à la diversité des pistes ici explorées, Dreems démarre sur un son de piano martelé jusqu’à l’envi, au cours d’un Summer qui fait office de prélude aguicheur et prometteur. Dès le titre suivant, la machine s’emballe : porté par un gimmick irrésistible, qu’on jurerait sorti de la cuisse d’un Prince (oui, encore lui) au meilleur de sa forme, le remuant Nothing About You donne au sémillant John Gourley, chanteur du groupe américain Portugal. The Man, l’occasion de briller de mille feux loin du cadre de son collectif d’origine.
À sa suite, c’est une basse synthétique bien ronde qui se charge de porter l’enivrant Vedra vers des cimes de mélancolie abyssale, transcendant son final d’un voile de chœurs d’une beauté stupéfiante. Ces quelques mesures d’apesanteur extatique nous emmènent imperceptiblement vers le Fame précité, dont la syncope rythmique se pare d’un motif lascif de voix masculine, avant que Cassius ne dégaine une arme redoutable, nous présentant là une nouvelle venue, invitée récurrente de l’album : la jeune chanteuse Owlle illumine d’un refrain terrassant de sensualité le splendide Don’t Let Me Be, qui semble vouloir fusionner la grandeur éloquente de la meilleure house garage avec la malice inhérente au r’n’b le plus moderne.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]P[/mks_dropcap]assé le cap de l’un des rares moments de silence total de l’album, Cassius enchaîne trois titres bagarreurs, qu’il est inutile de vouloir véritablement distinguer les uns des autres, tant leurs structures alignées semblent former un tout indissociable : la charge tribale de l’efficace Chuffed constituerait alors l’introduction idéale au galvanisant Rock Non Stop, avant que le bondissant Mike D ne vienne conclure les débats en enflammant tout le monde d’un goguenard et farceur Cause Oui ! à l’urgence contagieuse.
Si le mélodique Dreams n’est pas tout à fait le morceau-titre de cet album décidément revigorant, il en constitue probablement le sommet pop, rassemblant les voix de la Française Owlle et de l’Américain Luke Jenner (chanteur de The Rapture) dans un tourbillon de couleurs chatoyantes, tandis que les six minutes obsédantes de Calliope nous rappellent, avec force et pertinence, de toute la puissance évocatrice portée par la véritable deep house des origines, celle qui pouvait aussi bien servir d’ouverture majestueuse à une soirée excitante que de réveil salvateur lors de petits matins blêmes.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]u terme des cinquante minutes essentielles, au sens viscéral du terme, de ce Dreems dont la luminescence quasi-utopique paraît aussi douloureusement anachronique que puissamment charnelle, il est clair que Philippe Zdar et Hubert Boombass, en s’adonnant à une subtile soustraction tout en conservant leur son massif et charnu, n’ont fait qu’accentuer avec bonheur les aspérités intrinsèques à leur art historique et incontestable du groove malicieux et total : au final, moins d’éléments sonores pour plus de relief global. L’accessibilité déconcertante qui se dégage de l’ensemble nous ferait presque croire que toute la musique du monde a déjà été écrite, pour ne former qu’une source infinie dans laquelle il suffirait, avec un discernement aiguisé, de piocher comme bon nous semble.
[mks_pullquote align= »left » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#1a67b0″]Les ficelles du travail en lui-même, qu’on imagine fastidieux, disparaissent au seul profit de la magie de l’instant.[/mks_pullquote]
Se montre alors, derrière l’épure formelle, toute l’évidence d’une connaissance expérimentée, et qui semble pourtant si naturellement instinctive, de l’importance réelle de chacun de ces éléments, à tel point que les ficelles du travail en lui-même, qu’on imagine fastidieux, disparaissent au seul profit de la magie de l’instant, qui file entre nos doigts sans laisser d’autre trace qu’une vive émotion, dégageant un sentiment de pureté absolue tout en ressuscitant, dans la foulée, la classe mélancolique des plus grands pionniers de la house, du lyrisme flamboyant de Frankie Knuckles à la sensualité nacrée de Larry Heard.
De leur toute première maquette de jeunesse jusqu’à la pétrifiante ballade Walking In The Sunshine qui clôt leur dernier album, les deux partenaires n’auront fait que vouloir saisir, ne serait-ce que par bribes, pour en faire des disques, le libre cours de leur imagination débridée, loin de toute contrainte circonstancielle et pragmatique, apprenant patiemment à affiner leurs envies au fil inexorable du temps. Il n’y a jamais eu ni calcul ni cynisme chez Cassius, et c’est peut-être, au final, ce qui leur aura causé le plus de tort au niveau artistique, tout en les rendant si génialement uniques et indispensables.
On pourrait alors prendre au pied de la lettre (celle qui ne manque pas) la dimension ouvertement radieuse mais tristement définitive de ce Dreems, et voir l’apparente coquille de son titre comme une note d’intention : vouloir remettre de l’extase dans le rêve, encore et encore, jusqu’à la fin des temps. Et pour cela, nous pourrons toujours revisiter le fleuve tumultueux et intarissable des trente ans de musique commune de Philippe Cerboneschi et Hubert Blanc-Francard, en espérant qu’à l’avenir, quelques autres se sentiront suffisamment motivés pour venir s’y abreuver, s’en inspirer et, pourquoi pas, perpétuer cet état d’esprit dans toute sa démesure généreuse et son irrépressible enthousiasme.
Vous aimez les belles histoires ?
Dreems – Cassius
Disponible en CD, vinyle et digital depuis le vendredi 21 juin 2019, en distribution exclusive via Caroline International/Universal.
Facebook Officiel – Instagram – Twitter
Un immense merci à Emilien Evariste de Because Music.