Il doit y avoir une grosse dizaine de traducteurs de l’islandais en France. La langue est difficile, son apprentissage ardu, ses locuteurs rares dans nos régions. Comment choisit-on cette langue-là, cette culture-là, ce métier-là ? Eric Boury a à son actif plus de trente traductions littéraires, et notamment tous les romans policiers de la série Erlendur signés Arnaldur Indridason, qui rencontrent en France un succès considérable. Traducteur passionné et passionnant, il a bien voulu nous raconter sa vie – sa vie de traducteur, bien sûr !
Comment s’intéresse-t-on aux cultures nordiques quand on est un étudiant français ?
C’est un peu l’attrait de l’exotisme, de l’ailleurs. Autre chose que nous, autre chose que chez nous, aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte ou la mousse plus grise. Et surtout une passion pour les langues, dès le collège. A 17 ans, à l’université, j’ai commencé des études de langues nordiques – islandais, norvégien, suédois principalement. Puis je me suis rapproché de l’islandais, je suis allé vivre en Islande, voyant que la langue était vraiment très compliquée grammaticalement par rapport au norvégien et au suédois. J’ai eu la certitude que je n’apprendrais vraiment qu’en vivant sur place.
On a l’impression que le norvégien et le suédois sont plus faciles d’approche si on a déjà étudié l’allemand?
Oui, bien sûr. L’islandais aussi d’ailleurs, si ce n’est qu’il est resté très proche des origines, de la vieille langue nordique, alors que les langues scandinaves se sont beaucoup simplifiées. On peut dire, par exemple, qu’il n’y a pratiquement plus de conjugaisons, pas au sens où on l’entend en français en tout cas. En islandais, il y a encore des déclinaisons et des conjugaisons à la morphologie très complexe. Les mots peuvent se transformer complètement ! Les enfants islandais eux-mêmes mettent un certain temps à acquérir toutes les subtilités de la grammaire.
Quelles sont les principales difficultés pour un étudiant français ?
Ingurgiter, digérer toutes ces difficultés, puis être capable d’utiliser spontanément toute cette grammaire truffée d’exceptions au quotidien. Beaucoup de personnes lisent l’islandais, mais ne le parlent pas.
Un peu comme le latin, en quelque sorte ?
D’une certaine manière, l’islandais est le latin des langues scandinaves puisque beaucoup de grands textes du Moyen-Age ont été écrits en Islande, en islandais ancien dont l’islandais moderne est resté très proche. Certains historiens apprennent cette langue uniquement pour avoir accès à ces textes qui sont des références. C’est le cas des chercheurs qui se consacrent aux sagas islandaises.
Avant l’avènement d’Arnaldur Indridason, les sagas étaient l’élément le plus connu de la culture islandaise.
En effet, mais il y a aussi eu le Prix Nobel de Halldor Laxness en 1955. Et il est vrai qu’Arnaldur Indridason a joué un rôle déterminant pour faire connaître la littérature islandaise moderne à l’étranger.
Comment avez-vous commencé à traduire ?
A cause d’une rencontre. A trente ans, j’ai repris des études à la Sorbonne avec Régis Boyer, qui a beaucoup traduit de l’islandais, sagas et œuvres modernes. A l’époque, il y avait très peu de traducteurs de l’islandais vers le français. Régis Boyer a dirigé mon mémoire de DEA, et il a tenu à ce que je traduise. Il m’a plus qu’encouragé, car ce n’était pas très volontaire de ma part. Un éditeur lui avait demandé une traduction qu’il ne voulait pas faire, et il a réussi à me convaincre de m’y atteler. J’étais persuadé d’en être incapable, mais j’ai fini par le faire.
Vous avez donc tout de suite plongé dans le grand bain des difficultés du métier de traducteur, de traducteur de l’islandais de surcroît. 101 Reykjavik, votre première traduction, n’était pas simple. Vous avez appris d’un seul coup d’un seul, toutes les ficelles.
En réalité, on apprend à chaque livre. Chaque œuvre nous introduit dans un nouvel univers, une nouvelle langue. On ne parle pas tous de la même manière. Le style d’Arnaldur Indridason n’a rien à voir avec celui de ses contemporains, chaque auteur a son écriture et c’est justement ce que j’aime, la diversité, varier les styles et les œuvres. Traduire aussi bien des œuvres extrêmement littéraires que d’autres classées comme moins « littéraires » mais qui sont, quoi qu’on en dise, de la littérature.
Vous parlez beaucoup de la fonction poétique de la langue. Dans ce registre, qu’est-ce qui pour vous est le plus difficile: les sons, le rythme?
Les sonorités sont de toute façon impossibles à reproduire. Je m’efforce de donner ma version d’une œuvre en l’écrivant dans une langue qui essaie de ressembler à celle dans laquelle elle a été écrite. Il ne s’agit pas seulement de sons, mais de rythme surtout. De fluidité aussi. Certains traducteurs, sous prétexte de fidélité extrême, s’emploient à traduire en collant au maximum à l’original. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. On n’est pas dans le même univers mental et culturel, et il faut être capable de traduire tout en adaptant, sans bien sûr changer les prénoms et les noms des lieux comme on le faisait dans les années 60 ! Un texte qui est fluide dans sa langue d’origine doit le rester en français, même si on peut se permettre quelques exotismes.
D’où la nécessité de s’éloigner du texte original ?
Oui, parfois il est nécessaire de s’éloigner pour mieux se rapprocher. C’est compliqué, on tâtonne constamment : « oui, ça marche ». Ou « non ça ne marche pas alors que je pensais que ça allait marcher. » C’est un travail artisanal, tout en polissages et en ajustements.
Est-ce que vous « laissez reposer » beaucoup, pour revenir au texte quelques heures ou quelques jours plus tard ?
Je traduis la « dose » de traduction que je me suis fixée pour la journée. Puis je relis le paragraphe, la page au fur et à mesure, plusieurs fois, jusqu’à ce que le texte me semble suffisamment fluide. Quelquefois, j’avance de trois pages pour revenir en arrière ensuite et modifier quelques détails, j’arrange ici et là tout en gardant le texte islandais à l’esprit. Puis le soir, le lis une histoire à ma femme ! C’est-à-dire que je lui lis le texte tout haut : elle a la primeur de tous les livres. Une fois le livre fini, je le laisse reposer quelques jours, mais pas trop longtemps puis je m’enferme plusieurs jours dans ma cuisine et je relis le texte à haute voix tout seul. Il y a donc à peu près cinq relectures. Ensuite interviennent les lectures de l’éditeur et des relecteurs-correcteurs, mais généralement, il n’y a pas beaucoup d’interventions une fois que j’ai remis le manuscrit. Il reste toujours des petites choses, bien sûr. Quand j’ai fait des choix, je suis capable de les justifier. Sinon, quand on reçoit un manuscrit truffé d’annotations et de questions, c’est terrible (pour l’éditeur, pour le traducteur et pour les correcteurs) ! Pour mon dernier manuscrit de 600 pages, il n’y avait qu’une vingtaine de questions des relectrices.
Comment cela se passe-t-il pour les relectures justement ? Quand il s’agit d’anglais, il est possible de trouver un relecteur qui lise l’anglais. Pour l’islandais, ce n’est pas la même chose !
En fait, les relecteurs ne relisent que le français. L’important, c’est que le livre fonctionne dans la langue-cible. Si un autre traducteur relit la traduction, il pourra, éventuellement, faire des suggestions. Mais si c’est un bon traducteur, il comprendra pourquoi j’ai fait tel ou tel choix. Généralement, la relecture se fait sur le français uniquement.
Vous bénéficiez donc d’un gros atout : la confiance totale des éditeurs pour lesquels vous travaillez.
C’est vrai. Qu’il s’agisse d’Anne-Marie Métailié, de Jean Mattern, éditeur chez Gallimard ou de Laure Leroy, directrice des Editions Zulma, nous avons développé des relations de confiance et je dirais même d’amitié car nous travaillons ensemble depuis longtemps. Cela dit, peut-on travailler avec quelqu’un en l’absence de confiance mutuelle ? Je ne le crois pas. J’ai également la confiance des auteurs que je traduis. Par exemple, Arnaldur Indridason tient autant que possible à ce que je sois là lorsqu’il participe à des débats en France. Ça le rassure de savoir que c’est son traducteur qui va traduire depuis l’islandais pour le public français, qu’il connaît l’œuvre… Sachant que ses livres se vendent à 300 000 exemplaires en France, il est très reconnaissant envers son éditrice, son traducteur, et a peine à croire à un tel succès !
Est-ce que vous travaillez avec vos auteurs ?
Très rarement. D’autant qu’aucun ne parle vraiment français. Mais j’ai d’excellentes relations avec eux. Il m’arrive parfois de soulever des questions, notamment quand certaines choses ne peuvent absolument pas passer en français. Dans ces cas-là, il m’arrive de les consulter pour leur dire que je ne peux pas vraiment traduire sans transposer. La réponse est en général : « on te fait complètement confiance.«
C’est la relation idéale…
Avec la plupart des auteurs que je traduis, nous sommes au moins copains, voire très amis. S’agissant de Árni Þórarinsson, avec qui je parle au téléphone au moins une fois par mois, il arrive qu’on discute de la traduction, il arrive même, sur certains détails, qu’il m’aide à trouver une solution, au cours de la conversation. En fait, je pense que si un écrivain souhaite évaluer la qualité d’une traduction française, il faut au moins qu’il ait vécu en pays francophone et qu’il maîtrise très bien notre langue. Si j’écrivais un livre en français et si quelqu’un le traduisait en islandais, je regarderais la traduction, bien sûr, mais je n’irais pas mettre mon grain de sel là-dedans ! Il est vrai que j’ai de la chance, aucun de mes auteurs n’est un maniaque du « contrôle ». Pour moi, un auteur, comme un traducteur, qui a rendu son manuscrit, doit justement le considérer comme « sorti hors de son contrôle » et ne pas se comporter comme une mère possessive. Je ne pourrais pas travailler avec des auteurs qui agiraient ainsi. En outre, plusieurs de ces auteurs sont aussi traducteurs, donc ils comprennent très bien.
Cette confiance, vous l’avez eue tout de suite ou c’est venu avec l’expérience ?
Avec le temps bien sûr. C’est la même chose avec les éditeurs. Je dois dire qu’avec Anne-Marie Métailié, j’ai l’impression de faire partie de la famille, j’ai beaucoup appris en traduction en travaillant avec elle. A la rentrée, elle va publier un livre dont je viens de rendre le manuscrit final. Bien sûr, il est important dans la vie de rencontrer les bonnes personnes, avec lesquelles la confiance s’établit et se maintient.
Etes-vous force de proposition en matière de littérature islandaise ?
Cela peut arriver : je lis pour certains éditeurs, c’est vrai.
Vous êtes à peu près 10 traducteurs de l’islandais en France. Vous avez donc une obligation de compétence ?
C’est vrai qu’un traducteur qui pose problème est assez vite repéré. En fait, 11 ans après avoir fait ma première traduction, que je ne voulais pas faire, j’ai démissionné de l’Education nationale. J’ai arrêté d’enseigner en 2013. Aujourd’hui, j’exerce ma passion à plein temps. Ce qui me permet, par exemple, d’aller aux festivals « au pied levé ».
Vous parlez de passion. Pouvez-vous essayer d’analyser ce qui fait que la traduction est une passion pour vous?
Eh bien, on lit un texte et on se dit « Nom de Dieu, il faut absolument que les gens puissent le lire, il faut que ça soit traduit. » Et puis c’est surtout la passion des mots et de la littérature. La traduction, ça n’est pas tout : si vous me demandez de traduire des notices techniques, même à 150 € la page, ce sera « non merci ! » Par contre, traduire un bouquin en lequel je crois, que je l’aie découvert moi-même ou pas, c’est un pur bonheur. En outre, j’ai maintenant « mes auteurs », et je les suis.
Quand vous vous levez le matin et que vous vous asseyez devant votre ordinateur, c’est donc toujours avec une forme de bonheur et d’envie ?
Pas forcément : parfois, je préférerais aller à la plage ! Mais une fois que je suis entré dans le livre, que le texte me plaît et que je vois que ça fonctionne, tout va beaucoup mieux. Je suis quelqu’un qui travaille beaucoup, c’est en tout cas ce que me disent mes amis. La traduction, c’est quelque chose de très solitaire. Comme la lecture, comme l’écriture. Certains amis me demandent pourquoi je n’écris pas un roman. Je leur réponds que j’écris. J’écris les livres des autres… C’est vrai qu’il y a des moments plus pénibles. Toute cette neige partout, il y a vingt-cinq mots en islandais pour la désigner, et quatre seulement en français… Mais une fois qu’on est sorti de la tempête, qu’on a survécu et qu’on l’a transformée en français, c’est formidable.
La traduction, c’est aussi une suite de défis à relever, petits ou grands. Est-ce que c’est stimulant ?
En période de traduction intensive, on se retrouve seul devant son ordinateur pendant des heures et des heures. Puis finalement, on s’aperçoit qu’on n’est pas vraiment seul. Il y a le texte, les mots, l’auteur, les personnages. Cela relève presque de la magie.
Vous avez donc complètement trouvé votre façon de vivre et de travailler. Pour vous, cette carrière est une vraie réussite, puisque vous avez même pu arrêter d’enseigner.
Oui, ça me passionne, et je gagne ma vie correctement. Quand j’ai quitté l’Education Nationale, je savais que c’était définitif. J’ai adoré enseigner le temps que je l’ai fait. De toute façon, je ne peux pas faire quelque chose que je n’aime pas. En Islande, j’ai ramassé des pommes de terre, distribué le courrier, fait les foins, fait la plonge. Et j’aimais ce que je faisais, vraiment. Pour certains, ç’aurait été dégradant. Pour moi, aucun travail n’est dégradant, à condition qu’on sache que c’est limité dans le temps. Pour moi, le travail qu’on fait et la profession qu’on exerce ne préjugent pas de la valeur d’un individu.
Exercer ces métiers dans le pays qui vous fascine doit participer à votre compréhension de ce pays.
Je suis parti en Islande très jeune, à 19 ans, et j’y suis resté trois ans. De retour en France, j’avais en quelque sorte le mal du pays. Puis, quand j’ai commencé à traduire de la littérature, environ dix ans après mon retour en France, j’ai soigné ce mal d’une certaine manière. La littérature est parfois plus intéressante que la réalité… C’est souvent un bon condensé de la vie, avec en prime la variété des textes que je traduis. Je pense par exemple au manuscrit de 600 pages que je viens de rendre, et qui s’appelle Illska, de Eirikur Örn Norddahl. Ce roman qui sort aux Editions Métailié en septembre 2015, est un véritable brûlot anti-politiquement correct, contre tous les fascismes, avec une histoire passionnante sur la genèse des personnages, et de multiples fils narratifs. Traduire 600 pages sans un temps mort, sans un moment de lassitude, c’est tout simplement exceptionnel. Je pense aussi au magnifique livre de Jón Kalman Stefánsson qui sera publié chez Gallimard, également en septembre sous le titre D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds, ce livre-là, comme tous ceux de cet auteur, aide à mieux comprendre l’âme islandaise et l’âme humaine. Ecrire, c’est sonder l’âme humaine et vouloir conjurer l’oubli. En lisant Jón Kalman, j’ai l’impression que justement, il a tout compris !
Eric Boury, tient un blog ici.


















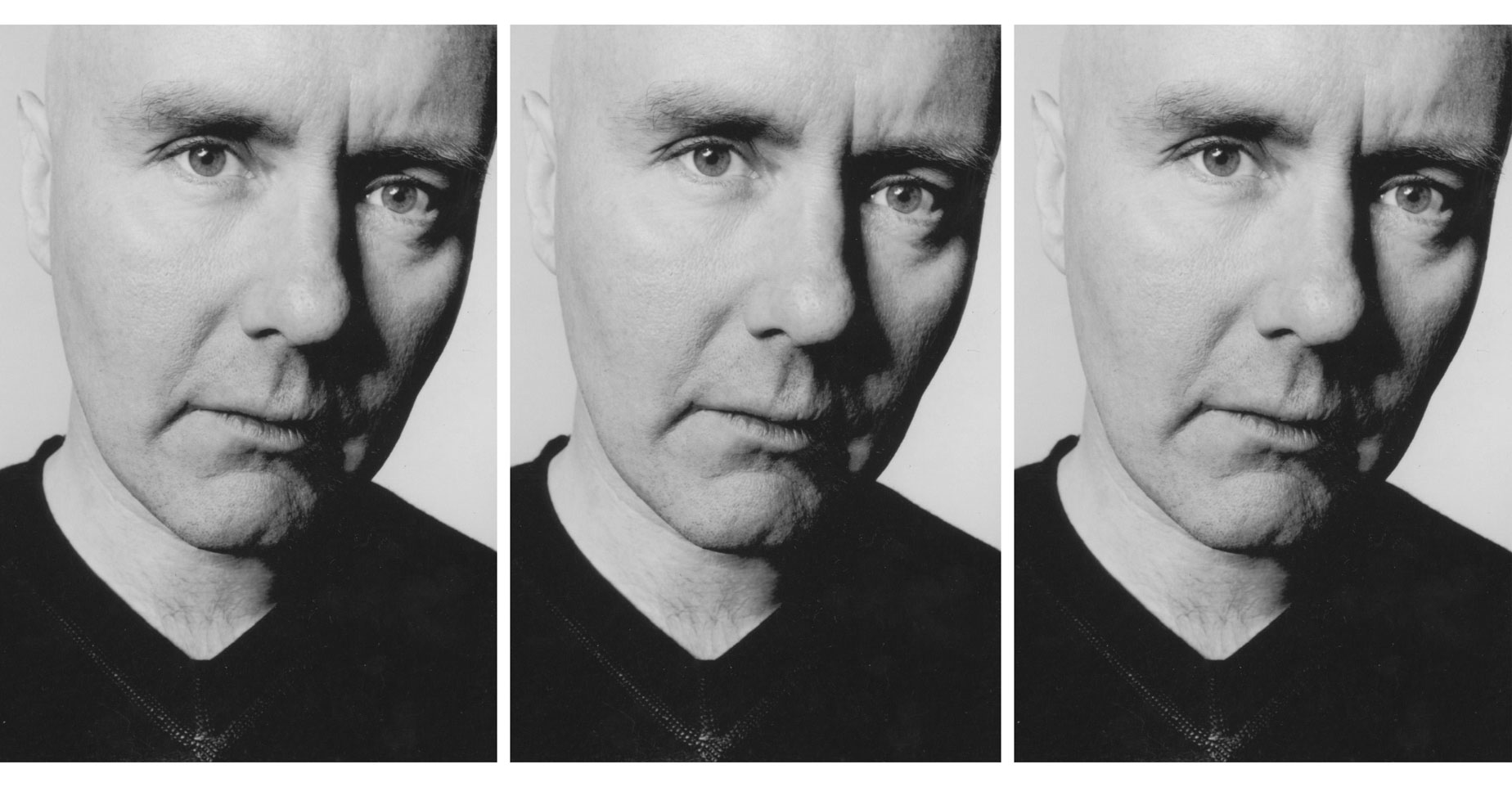




Les 3 livres de JK STEFANSSON sont magnifiques et Sana doute la traduction y est pour qq chose.bravo et merci.