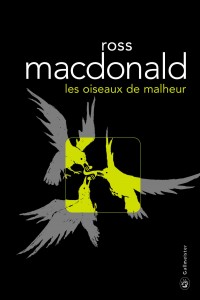Après ses années d’hypokhâgne et de khâgne, Jacques Mailhos entre à l’Ecole Normale Supérieure et termine une maîtrise, puis un DEA, sur James Joyce. Il suit parallèlement un séminaire de sociologie au cours duquel il commence à traduire des œuvres de sociologues américains.
Aujourd’hui, il est traducteur littéraire et travaille essentiellement sur des œuvres de romanciers américains pour les éditions Gallmeister. Il a entrepris, notamment, la retraduction de l’ensemble des enquêtes de Lew Archer, signées Ross Macdonald.

Comment avez-vous décidé de passer de la recherche en littérature à la traduction littéraire ?
Petit à petit, je me suis dit que peut-être j’avais fait le tour de la recherche, ou du moins de l’intérêt que j’avais pour elle. Je commençais à pressentir que la traduction était ma voie : c’était plus concret, plus matériel, plus utile. Et puis il y avait ce plaisir très concret de taper au clavier ! J’avais appris à taper avec mes 10 doigts et j’ai toujours aimé ça : avancer, avancer vite comme en suivant une partition plutôt que d’écrire soi-même la partition. Se confronter à une certaine matérialité de la langue. A cette même époque, je suis devenu très amateur de mots croisés en les abordant par Georges Perec. J’avais fait de la recherche sur Perec, j’avais aimé la façon dont il parlait des mots croisés : on y retrouvait ce jeu avec la langue que je trouve finalement assez proche de la traduction.
Et l’enseignement ?
J’ai toujours un peu enseigné. J’avais une bourse de thèse qui comprenait quelques heures d’enseignement. J’ai fait ça pendant 3 ans, je me suis mis en disponibilité, puis je me suis lancé comme traducteur indépendant. Ça me permettait de prendre des vacations à la fac. Puis nous sommes venus nous installer à La Rochelle et j’ai obtenu un poste de titulaire à l’Université de La Rochelle, que j’occupe encore actuellement. L’enseignement, c’est un vrai plaisir aussi, et c’est également une façon d’entretenir le contact avec les autres, celui qu’on n’a pas forcément en étant traducteur.
Vous avez commencé avec la sociologie, vous vous êtes donc confronté à un certain jargon ?
 Sauf que les sociologues de l’école de Chicago que je traduisais n’étaient pas jargonnants à la française. J’ai travaillé notamment sur Howard Becker, l’auteur de Outsiders. J’ai traduit Les ficelles du métier. C’est presque un écrivain « beat » de la sociologie, il est musicien également : une rencontre fabuleuse, une découverte, un grand plaisir dans cette capacité que j’ai trouvé chez ces sociologues, Becker et son professeur Everett Hughes : des gens qui racontent les choses de manière très claire, très prenante. Pas de jargon.
Sauf que les sociologues de l’école de Chicago que je traduisais n’étaient pas jargonnants à la française. J’ai travaillé notamment sur Howard Becker, l’auteur de Outsiders. J’ai traduit Les ficelles du métier. C’est presque un écrivain « beat » de la sociologie, il est musicien également : une rencontre fabuleuse, une découverte, un grand plaisir dans cette capacité que j’ai trouvé chez ces sociologues, Becker et son professeur Everett Hughes : des gens qui racontent les choses de manière très claire, très prenante. Pas de jargon.
Vous intéressez-vous aux outils de traduction informatiques ?
Oui, effectivement, je les ai même utilisés dans le cadre de mon enseignement pour « pondre » de mauvaises traductions qui nous permettaient, aux étudiants et à moi-même, de nous gausser de bon cœur, sans risquer de nous moquer du travail d’êtres humains. Avec les robots, on peut vraiment s’en donner à cœur joie, et cela nous permet de nous interroger sur pourquoi la traduction est mauvaise, qu’est-ce qui manque aux robots, etc.
On a quand même assisté à une explosion du niveau de traduction d’outils comme Google traductions. Je vois ça avec un double regard : d’un côté, j’aurais aimé faire partie de ces équipes qui ont mis au point un outil qui, malgré bien des défauts, permet quand même de se faire une idée assez précise du sens du texte. D’un côté, donc, une certaine admiration, et de l’autre un sentiment qui n’est pas vraiment de la crainte, puisque je travaille sur des textes littéraires qui nécessitent un niveau de langage et d’exigence dans la qualité d’écriture que la machine est bien loin d’atteindre.
Depuis que j’ai eu la chance de rencontrer Oliver Gallmeister et que je traduis régulièrement des textes de qualité, je ne vois pas comment la machine pourrait se substituer à l’homme dans un futur proche. Au début de ma carrière, j’ai traduit quelques Harlequin, et contrairement à ce qu’on croit, ils sont très exigeants sur la qualité d’écriture. Il faut aller droit au cliché, à l’image qui touche de façon très directe. Avoir une écriture parfaitement fluide, qui ne surprend jamais, qui n’accroche jamais. Donc même pour ce type de texte, la traduction doit être très travaillée ! En revanche, pour les « petites » traductions un peu éphémères ou ponctuelles, comme les traductions de sites web touristiques par exemple, les machines fournissent un résultat acceptable, et gratuit, en une fraction de seconde. En gros, mon discours auprès de mes étudiants, c’est de dire « Si vous ne pouvez pas produire quelque chose de meilleur que ça, alors ça ne sert à rien… ». C’est une sorte de niveau zéro à partir duquel l’humain peut intervenir.
Je voudrais aussi rappeler comment Google traduction a réussi ce bond en qualité. Ce n’est pas majoritairement à cause de l’amélioration de l’algorithme de traduction et en faisant travailler des linguistes. C’est surtout quand les ordinateurs ont fait des progrès considérables en capacité de calcul, et quand l’internet est devenu une gigantesque base de données de textes traduits par des humains. Google traduction ne fonctionne plus que de manière marginale par analyse de la phrase de départ et production d’une phrase dans la langue cible, mais par recherche dans internet. Si cette phrase a déjà été traduite, il la renvoie, avec la rapidité de traitement fabuleuse du Big Data. Il pioche énormément dans les bases de données de l’Union Européenne, qui sont un immense réservoir de textes identiques existant dans de multiples langues, traduits par des traducteurs et traductrices humains. Donc Google traduction exploite de plus en plus le travail de tous les humains. La qualité parfois étonnante qu’on peut trouver dans la traduction automatique n’est ni plus ni moins que le résultat de la qualité du travail des traductrices et traducteurs humains.
Vous avez commencé la traduction littéraire au début des années 2000. Avec quel auteur et quel éditeur avez-vous démarré ?
Au tout début, ça a été Harlequin. Avant, j’étais plutôt dans le domaine des sciences humaines et de l’histoire de l’art. J’avais beaucoup travaillé pour les Guides Gallimard, qui exigeaient de travailler dans des domaines très divers, histoire, architecture, et aussi informations pratiques. Bizarrement, cet aspect rébarbatif me satisfaisait plutôt, ce qui m’a conforté dans mon choix de la traduction.
Votre premier roman traduit, en-dehors des Harlequin ?
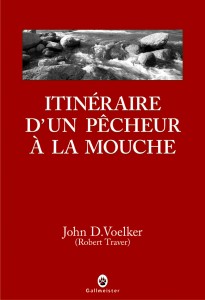 C’était pour Oliver Gallmeister, une de ses toutes premières publications. C’était Itinéraire d’un pêcheur à la mouche, de John D. Voelker, un livre culte aux Etats-Unis. Oliver m’a fait faire quelques bouts d’essai, m’a confié des projets, nous sommes devenus amis, puis j’ai pris la fusée Gallmeister ! Nous avons à peu près le même âge, des goûts et des références proches. Depuis, il m’alimente régulièrement en beaux textes. C’est un luxe, un bonheur…
C’était pour Oliver Gallmeister, une de ses toutes premières publications. C’était Itinéraire d’un pêcheur à la mouche, de John D. Voelker, un livre culte aux Etats-Unis. Oliver m’a fait faire quelques bouts d’essai, m’a confié des projets, nous sommes devenus amis, puis j’ai pris la fusée Gallmeister ! Nous avons à peu près le même âge, des goûts et des références proches. Depuis, il m’alimente régulièrement en beaux textes. C’est un luxe, un bonheur…
J’ai vu que vous aviez traduit Edward Abbey, un personnage très singulier dans l’univers de la littérature américaine. Comment ces projets vous sont-ils échus ?
C’est Oliver Gallmeister qui m’a confié Le retour du gang de la clef à molette : c’est là que j’ai découvert l’auteur. Un choc et un bonheur absolu, jamais démenti. Ma traduction de Désert solitaire m’a même valu le prix Maurice-Edgar Coindreau en 2011, ainsi que le prix Amédée Pichot de la ville d’Arles.
Est-ce que ces prix ont changé quelque chose pour vous ?
Non, pas directement, puisque j’ai continué sur ma lancée avec Gallmeister. Mais effectivement, en termes de notoriété cela a dû faire progresser les choses, pour moi comme pour la maison d’édition.
Considérez-vous cela comme un luxe de ne pas avoir à chercher des contrats ?
Oui, absolument, d’autant que je n’ai pas nécessairement les qualités nécessaires pour me vendre. J’ai eu de la chance, des chances que j’ai sans doute su saisir. Et puis il y a aussi ce sentiment de faire partie d’une équipe. Par ailleurs, Gallmeister développe de plus en plus le côté roman noir de son catalogue, parallèlement aux collections de « nature writing », et le roman noir est un genre que j’ai toujours beaucoup aimé en tant que lecteur. Je me souviens avoir travaillé des textes de Chandler avec des étudiants… Alors ce projet de retraduction de toutes les enquêtes de Lew Archer par Ross Macdonald est extrêmement stimulant.
À ce propos, où en êtes-vous de la série des Lew Archer ?
Le septième, Les oiseaux de malheur, vient de sortir au début du mois d’octobre (voir la chronique ici). Depuis qu’on les retraduit, ils sortent au rythme de deux par an.
Quand on s’attelle à la retraduction de la quasi-intégralité d’un maître du roman noir américain, quel est le sentiment qui prédomine ? Le vertige devant l’ampleur de la tâche, le sentiment de redonner une visibilité méritée à un auteur méconnu ?
Je crois que le sentiment qui prédomine, c’est tout de même le plaisir. Le vertige devant l’ampleur de la tâche est sans doute là, mais il ne s’accroche jamais bien longtemps. Je crois que c’est parce que « l’ampleur de la tâche » est une chose finalement assez abstraite, un chiffre, un nombre de romans… Le travail, le vrai, c’est toujours sur un seul roman, un roman bien particulier ; sur un chapitre de ce roman ; sur cette phrase, là, dans ce chapitre. Cette tournure, ce mot, ce choix de temps, ce « ne » que je garde ou que j’élide dans la tournure négative de cette réplique particulière de ce bout de dialogue. Les x autres romans qui attendent d’être traduits ne trouvent sans doute pas leur place dans ce genre de soucis. Donc, oui, par rapport à l’ensemble du projet, c’est sans doute le plaisir qui domine. Comme ce plaisir se vérifie dans le détail quotidien du travail, c’est vraiment très agréable.
Le sentiment de redonner une visibilité méritée à un auteur méconnu est lui aussi présent, bien-sûr, mais lui aussi assez abstrait, comme une conséquence heureuse, mais indépendante de ma volonté, d’un travail qui me plaît. C’est sans doute mieux ainsi, d’ailleurs, parce qu’à vouloir redonner une visibilité à un auteur méconnu, on risque de finir par trop faire le malin. De finir par se croire plus intelligent que le texte. De forcer les effets… « surtraduire« … chercher à en jeter… je ne sais pas.
Quelle a été votre plus grande difficulté de traducteur quand vous vous êtes attelé aux premiers volumes de la série ?
Je ne sais pas trop. Sans doute les petits réglages fins des niveaux de langue (parlée, soutenue… usage précautionneux de l’argot, en évitant tout ce qui risque de sonner trop franco-français), et aussi de l’époque de la langue (éviter les anachronismes d’expressions trop modernes, ce genre de choses). Mais là encore, il s’agit plus de questions qui se règlent à l’échelle de la phrase, éventuellement du paragraphe, au grand maximum à l’échelle du chapitre. Dans le détail du travail quotidien plus que dans des vastes théorisations. En tablant sur le fait que si je prends soin du détail, alors le tout prendra soin de lui-même. Quelque chose comme ça. Si l’on s’imagine le traducteur comme un faussaire travaillant à copier un tableau, alors l’idée, c’est de le voir plutôt en train de reprendre les traits et les points et les coups de pinceau un à un plutôt qu’en train de se dire, « Ah, ouais, c’est un Picasso de la période bleue, donc il est globalement dominé par tel ou tel procédé, telle ou telle teinte, etc ».
C’est aussi (un peu) la raison pour laquelle je suis toujours embarrassé quand on me demande de caractériser le style d’un auteur. Je m’efforce à chaque fois de rendre au mieux justice au texte, d’en faire une fausse copie qui puisse passer pour vraie, mais je ne sais jamais trop quoi dire pour caractériser le style. Et il m’arrive d’envier les gens qui savent.
Et puis je viens de voir que vous alliez retraduire James Crumley ? Peut-être est-ce trop tôt pour en parler ?
Oui, je suis effectivement en train de travailler à la traduction de The Wrong Case (dont le titre français sera, je crois, Fausse Piste). Vous pouvez le mentionner – c’est un autre projet vraiment enthousiasmant. Mais je n’ai pas grand chose d’autre à en dire pour le moment.
En tant que traducteur expérimenté, vous ne rencontrez pas le souci des débutants, à savoir la relecture et les suggestions.
C’est toujours Oliver Gallmeister qui relit mes textes. C’est un excellent lecteur, il a un œil sans pareil pour repérer les petites choses qui, éventuellement, sonnent un peu faux. Il me renvoie mon texte surligné aux endroits qui posent question : soit je revois parce qu’effectivement, il y a quelque chose à reprendre, soit je discute et j’explique. Et ça se passe très bien. Nous sommes comme un vieux couple.
Que pensez-vous de l’enseignement de la traduction ?
Je ne peux pas vraiment porter de jugement. J’ai enseigné la version à l’Université d’Orléans, à des 1e années d’anglais, au début des années 2000, et j’enseigne dans le cadre d’une UV libre à l’Université de la Rochelle, qui s’appelle « Pratique de la traduction ». Mais cela ne vise pas à former des traducteurs, c’est plutôt de l’ordre du plaisir, de la culture générale puisque mes étudiants viennent de beaucoup d’horizons différents. Je ne connais pas du tout les cursus de traduction.
Que pensez-vous de la différence du recrutement des traducteurs entre, disons, les années 50 et aujourd’hui ? A cette époque, à peu près n’importe qui pouvait être traducteur. Parfois, le résultat était même bon !
Oui, traducteur, c’était – et c’est toujours – un peu comme psychanalyste ou prostituée, n’importe qui pouvait s’auto-proclamer traducteur. Il m’est arrivé d’aller enseigner dans une école de traduction à Bruxelles. Je pense qu’il y a beaucoup de choses utiles qu’on peut enseigner en traduction, c’est sûr. Ce qui me fait penser à un autre aspect qui peut présenter un risque pour les traducteurs de demain : le travail collaboratif. Vu les résultats obtenus, cela pourrait être à la fois intéressant et potentiellement dangereux pour les professionnels.
Mais tout de même, un traducteur est un peu auteur. Comme lui, il a une « voix » qui lui est propre…
C’est très ambigu : à la fois je ne voudrais pas qu’on reconnaisse ma « voix » derrière tous les textes que je traduis, et il n’est pas impossible qu’on le puisse… L’idéal, c’est de produire un texte qui semble avoir toujours été écrit en français.
Que conseilleriez-vous à quelqu’un qui voudrait devenir traducteur ?
A un futur traducteur, je conseillerais, fondamentalement, de lire énormément dans les deux langues, et particulièrement dans la langue cible. Donc beaucoup de littérature française, une culture aussi vaste que possible. Étant bien entendu que le niveau de maîtrise de la langue étrangère doit être acquis, naturellement. Et aussi ouvrir grand ses oreilles pour saisir la façon dont les gens parlent.
Une dernière question : avez-vous jamais eu envie de traduire d’une autre langue que l’anglais ?
Si, d’ailleurs il m’est arrivé de traduire du danois, que je parle puisque j’ai vécu un an au Danemark après mon bac. À l’époque où je travaillais pour les guides Gallimard, ils avaient demandé à des auteurs locaux d’écrire en anglais des textes sur l’archéologie, l’histoire… Assez rapidement, je me suis retrouvé à traduire des textes écrits dans un anglais assez mal foutu. Je trouve que la difficulté la plus pénible, ça n’est pas forcément les styles impressionnants, mais les textes mal foutus ! J’avais donc proposé à l’éditrice des guides de demander qu’ils écrivent leurs textes en danois, que j’ai traduits en français. Et les résultats étaient bien meilleurs. Mais je n’ai pas approfondi la question après cette expérience.
Jacques Mailhos aux Editions Gallmeister