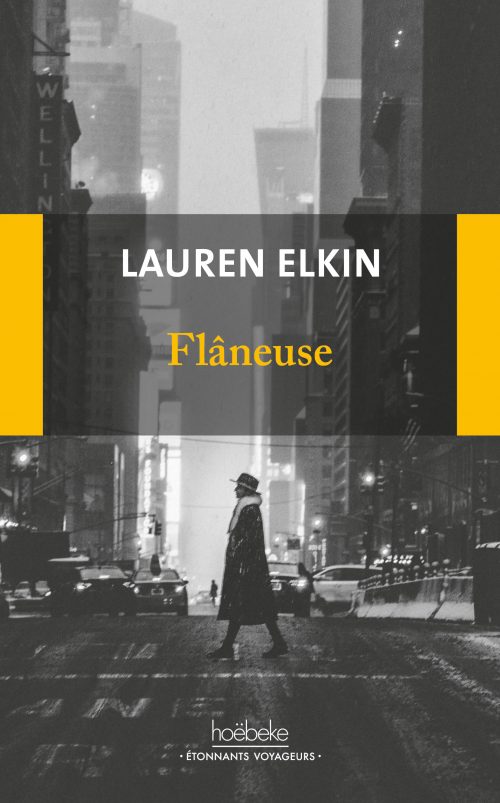Si le mot « flâneur » évoque immédiatement Baudelaire, les Grands Boulevards et la vie de bohème, qu’en est-il de la flâneuse ?
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]E[/mks_dropcap]n lisant la quatrième de couverture du livre de Lauren Elkin, Flâneuse, Reconquérir la ville pas à pas, paru le 21 mars dernier chez Hoëbeke, collection Etonnants Voyageurs, la problématique semble évidente, celle de la place des femmes dans la ville, et la façon dont elles se sont approprié l’espace urbain au fil des siècles.
[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]U[/mks_dropcap]ne réflexion née de l’expérience personnelle de l’auteure, lauren Elkin, d’origine new-yorkaise, qui découvre dans les années 90 le bonheur de flâner, pendant ses études universitaires à Paris. Un terme qui apparaît au dix-neuvième siècle, sous l’influence de Baudelaire, dans Le Peintre de la vie moderne, qu’il définit comme tel : « Pour le parfait flâneur, pour l’observateur passionné, c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l’infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi ; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. »
Une révélation qui questionne l’auteure sur la place des femmes dans l’espace public, et par extension sa place dans la ville.
Ainsi à travers sa propre histoire, Lauren Elkin nous entraîne dans une vaste flânerie, qui débute à New-York, plus précisément à Long Island, sa ville d’origine, loin des lumières de la ville, la banlieue, dont elle nous dresse le portrait, sinistre et impersonnel, où la voiture reste le seul moyen de se déplacer, un comble pour tout flâneur qui se respecte, et le désir profond de retrouver la ville : « La ville réveille, excite, fait bouger, avancer, penser, vouloir, s’impliquer. La ville est la vie. » (p.52).
Une errance libératrice où s’entremêle récit et essai littéraire, marcher seule dans la rue, sans but précis, sans destination, en laissant place au vagabondage de l’esprit, à travers les lieux, leur histoire, son propre vécu en forme de miroir avec celui de femmes artistes, qui ont marqué leur époque.
Nous croisons alors à Paris, une américaine, Jean Rhys, George Sand, Agnès Varda, à qui elle dédie un chapitre entier autour du film Cléo de 5 à 7. A Londres, l’auteure calque ses pas sur ceux de Virginia Woolf, « Je voulais voir Londres comme Woolf l’avait vue, de sorte que je me suis mise à remonter la piste de toutes ses adresses. », mettant en lumière une œuvre passionnante qui posait déjà les questions qui hantent Lauren Elkin, la relation entre les femmes et la ville, à l’instar de Street Haunting (Par les rues, aventure londonienne) paru en 1927.
Puis Lauren Elkin part à Venise pour poursuivre sa thèse, mais surtout prendre un nouveau départ après une rupture douloureuse à Paris, elle décide d’écrire un roman, Floating Cities (Une année à Venise). C’est là qu’elle découvre le travail de Sophie Calle lors d’une exposition, Prenez soin de vous. Dans ce chapitre elle nous parle surtout de l’œuvre Suite Vénitienne de Calle, où elle suit un homme dans la rue à Venise, Henri B., une démarche étonnante qui questionne Elkin, « Si la flâneuse est une femme libérée, déterminée à aller où elle n’est pas censée se risquer, que signifie pour elle le fait de suivre quelqu’un ? »
C’est à Tokyo que Lauren Elkin vivra une forme d’expérience en résonance avec celle de Sophie Calle, suivant alors son compagnon de l’époque, « Un jour j’ai suivi un homme – que nous appellerons X, à la manière de Sophie Calle – jusqu’à Tokyo, juste pour ne pas avoir à choisir de ne pas y aller. », dans une ville hostile à la flânerie, une période vécue comme un véritable calvaire par l’auteure. Le parallèle avec le film de Sofia Coppola, Lost in Translation, est particulièrement troublant, « Je restais dans notre appartement à jouer les flâneuses sur Internet, en me languissant de Paris. »
Dans le chapitre « Partout », il sera surtout question de Martha Gellhorn, qui fut journaliste, correspondante de guerre et écrivaine, une femme libre qui n’avait pas froid aux yeux, elle fut entre autres la femme d’Hemingway, mais c’est sans compter sur ses nombreux mariages et foyers, « une ambivalence indécise profondément américaine entre la route et la maison. » Et un autre regard sur la flânerie, « Flâner, disait-elle à Victoria Glendinning, m’est aussi nécessaire que la solitude : c’est comme ça que l’esprit reste un terreau fertile. C’est un besoin de s’occuper que l’on peut satisfaire assis ou en bougeant. », le flâneur est alors défini comme « une personne orientée vers un but, une révélation, une manière d’enregistrer et de partager ce qu’elle a vu. »
Un récit fourmillant de références et de réflexions sur la notion de flânerie au féminin, une définition de l’acte de flâner comme moyen de s’approprier l’espace urbain, mais aussi sa vie, sa liberté, être soi au milieu de tous, à la fois ici et ailleurs. L’essai de Lauren Elkin peut paraître un peu exigeant, mais lui emboîter le pas c’est prendre le temps de se perdre dans la ville, et de découvrir des artistes incroyables tant par leurs œuvres que par leurs personnalités, des femmes fortes pour l’essentiel, je nommerais également, Susan Sontag, Joan Didion, Gertrude Stein, Elizabeth Bowen… mais le mieux c’est encore de vous inviter à plonger dans ce livre passionnant, érudit tout en étant remplie d’émotions et de sensations, une merveille !