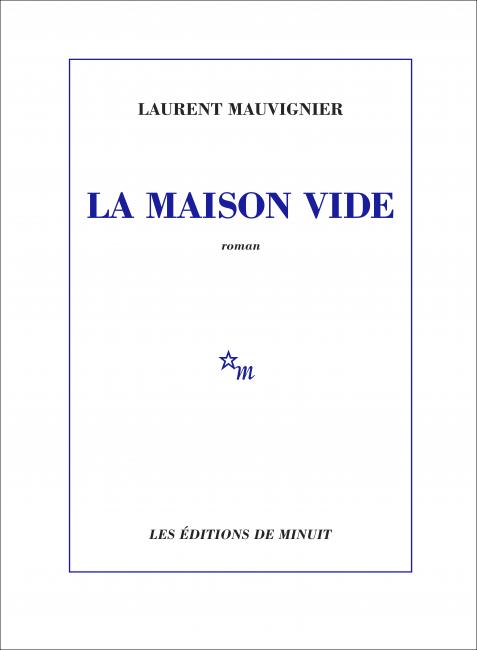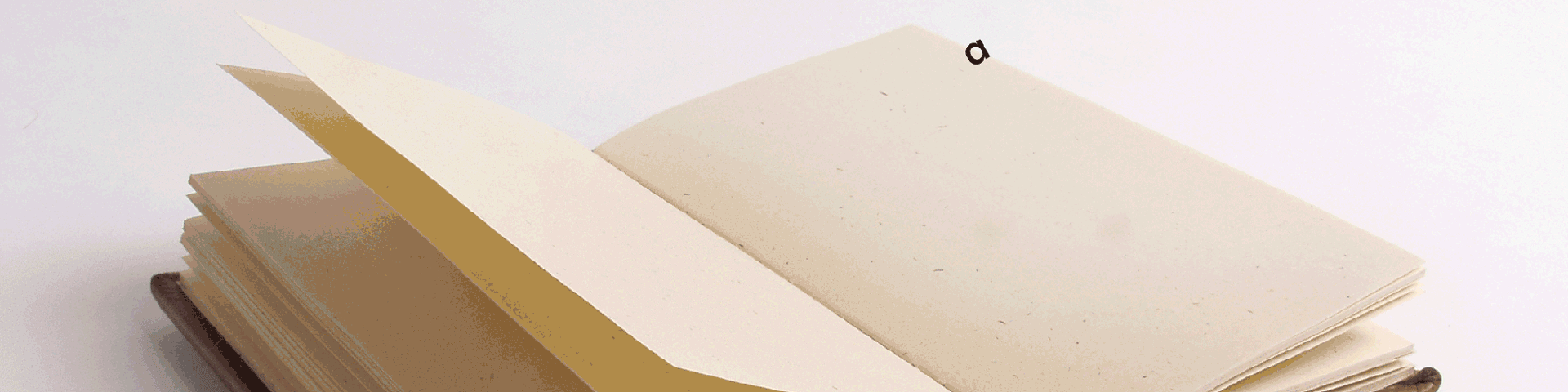Si l’on s’essayait à un court résumé de l’histoire familiale que retrace, Laurent Mauvignier dans La Maison Vide, son dernier roman, le scénario pourrait tenir en quelques phrases simples et, peut-être, certains d’entre nous pourraient en trouver quelques échos dans leur propre généalogie. Firmin, patriarche rural et machiste marie contre son gré sa fille Marie-Ernestine, jeune musicienne en herbe, à un paysan pas trop dégrossi, Jules, avec qui il partage le sens de l’argent bien investi et ce, afin d’exclure de sa succession deux fils pas assez mâles à son goût et évidemment sans rencontrer l’opposition d’une épouse, simple « préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser ». La guerre de 14-18 transformera le gendre Jules en poilu héroïque, lui prendra la vie et la possibilité d’élever la seule fille du couple, Marguerite, devenue pour sa mère le symbole d’une vie ratée et l’objet de tous les ressentiments.
Mais voilà, à partir de cette trame autobiographique, de quelques rebondissements inventifs et des souvenirs qui dorment dans les tiroirs des vieux meubles de famille, Laurent Mauvignier au meilleur de son art, déploie sur plus de 700 pages virtuoses et envoûtantes, un roman dont il faut bien dire qu’il porte haut, très haut le sens de ce que peut être la Littérature. Car c’est dans cette maison vide de La Bassée (double littéraire du Descartes en Touraine qui l’a vu grandir) que se rend en effet depuis l’enfance, et les premiers séjours qu’il y passera avec son père, sa mère et ses frères, un des écrivains les plus talentueux de sa génération ; un des rares sans doute qui puisse se prévaloir d’avoir des Proust parmi ses ancêtres, de pouvoir affirmer qu’ils n’ont absolument rien à voir avec le « vrai » et de nous faire pourtant douter du caractère héréditaire d’un talent qui synthétise dans ce nouveau texte toute la puissance qu’il avait déjà démontrée dans ses œuvres précédentes.
La Bassée donc et encore, sans doute vers L’Écart-des-Trois-Filles-Seules, théâtre du précédent opus Histoires de la nuit, toponyme dont le sens nous apparaît, après la lecture de La Maison Vide, tellement évident. Ce petit hameau traversé par la ligne de démarcation après la débâcle de 1940, la maison inoccupée ombrée par un cerisier aux branches tentaculaires et les protagonistes d’un théâtre familial quasi balzacien – dont des scènes déshonorantes, attribuables à la grand-mère de l’auteur, Marguerite, demeurent encore secrètes grâce une mémoire collective fragile et taiseuse – pourraient bien ne pas être, selon l’auteur, sans lien avec le suicide de son père à 41 ans et avec toutes les questions qui sont restées sans réponses à son départ. Fort de cette conviction, Laurent Mauvignier se livre à une incroyable enquête/fiction généalogique à partir des petits souvenirs, des objets anodins, des photographies parfois mutilées, qui tous, fragments de temps suspendu, petites brumes de passé abandonné, lui permettent de tisser à nouveau ce que la distance et l’oubli ont altéré ou enseveli.
Les acteurs de cette tragédie (oui disons-le) sont nombreux, mais le cœur de la ligne narrative est celle des femmes et de leur condition dans un XXème siècle obscur et au demeurant pas si lointain. D’abord Marie-Ernestine, l’arrière-grand-mère et Marguerite, la grand-mère de l’auteur, deux femmes que la vie va séparer. Une mère, humiliée et vendue à un bon parti, et une fille issue de cette union forcée qui tentera jusqu’aux extrêmes limites d’affirmer une inconditionnelle liberté, refusée à sa mère. La première, prisonnière toute sa vie de La Maison vide, était pourtant promise à un bel avenir de pianiste, mais son talent, découvert par un professeur sans doute trop ému par son élève sera brisé par un père qui offrira à sa fille en même temps qu’un piano, un tombeau pour la vie. La seconde affirmant une sensualité que sa mère aura toujours niée, refusant à son second mari jusqu’à l’accès de sa chambre, incarnera la vie, la vie à tout prix. Au prix que proposeront les hommes bien sûr, comme son amie/amante Paulette le lui apprendra, mais avec la certitude que savoir qu’on est à vendre garantit qu’on reste maîtresse de la transaction. Troisième femme, enfin, la « préposée aux confitures et chaussettes à repriser » que la guerre et le départ des hommes au front vont révéler maîtresse femme, gestionnaire et entrepreneuse, mais dont il faudra pourtant attendre plusieurs centaines de pages et des passages absolument bouleversants pour apprendre qu’elle avait des yeux, des yeux verts, et même un prénom, oui, Jeanne-Marie, comme il sera gravé sur sa tombe.
« Quand il le constate, au début, Jules en est impressionné et rassuré. Il sourit de l’entendre lui faire le tour du propriétaire, car jamais, il le sait, du temps de Firmin ni même quand il avait pris la relève, il ne l’aurait vu s’imposer avec une telle évidence et un tel naturel; maintenant c’est elle cette belle-mère qu’il avait connu effacée derrière son mari et soumise et presque muette mais qu’il aimait pour cette abnégation même, elle dont, il n’aurait jamais soupçonné qu’elle puisse se tenir aussi droit et marcher devant lui, pour lui expliquer tous les aménagements qu’il avait bien fallu faire et les décisions qu’il avait fallu prendre en son absence, c’est elle qui mène la barque sans trembler. Il n’en revient pas de la voir s’adressant aux hommes en tenant la voix si haut et si ferme, les yeux ouverts, droits comme autre fois, elle n’aurait jamais pu les montrer tiens, il se dit, ses yeux sont verts. »
─ Laurent Mauvignier, La maison vide
L’impression de caresser de ses doigts
l’étoffe shakespearienne
dont nous sommes faits,
d’avoir accès à la vérité
ultime de nos existences,
force l’admiration
Si la maison est vide, le texte, lui, est plein. Plein d’un talent qui éclabousse les pages, chacune des pages de façon stupéfiante et qui envoûte littéralement le lecteur dans un vertige de mots, mais surtout de sensations et de moments reconstitués. Notre lecture est immédiatement sous l’emprise de l’écriture de Mauvignier, de son style. Le style d’un auteur peut être à son apogée qui parvient de façon quasi miraculeuse à nous restituer ce qui fait la substance, la matière, la densité de nos vies. Alors même que souvent nous les traversons, sans même nous en apercevoir, sans en avoir conscience, Laurent Mauvignier capture le réel, immobilise le temps et ce qui s’y joue. Le roman contient des pages inoubliables où l’impression de caresser de ses doigts l’étoffe shakespearienne dont nous sommes faits, d’avoir accès à la vérité ultime de nos existences, force l’admiration. C’est par exemple cet instant monstrueux où Marie-Ernestine comprend sans comprendre que le piano offert par son père n’est qu’un leurre destiné à lui faire avaler la pilule d’une union absurde ; c’est encore cette nuit terrible qui nous enferme avec les jeunes mariés dans la chambre nuptiale et dont on voudrait fuir, fuir pour ne pas voir, ne pas entendre, pour ne pas être témoin de ce qu’ont vécu des milliers de jeunes femmes pliant sous la loi des hommes ; tiens, c’est encore cette folie qui embrase la fille de Firmin et la conduit à s’ouvrir les veines, ce qui ne sera plus jamais autrement connue que par le terme d’accident, un euphémisme tellement pratique…. Mais ce réel dont nous sentons ici tant le poids, la matérialité, d’autres voudraient l’atteindre et n’y parviennent pas et c’est encore un autre réel auquel l’auteur nous donne accès, un auteur qui lui même parfois confesse qu’il peine à le faire surgir. C’est ainsi Jules, en permission pour 6 jours ; 6 jours dont il voudrait sentir la durée, sentir et profiter de chacune des 24 heures qu’ils contiennent et qui lui restent encore avant le retour au front mais qui échoue, incapable de retenir l’instant, pitoyable victime d’agueusie, inapte à toute sensation exceptée la peur viscérale de la mort qui l’attend.
« Imaginez : plutôt, non, laissons-les à leur émotion et à la timidité, ou peut-être à l’effusion des retrouvailles. Laissons ce que nous pouvons à peine concevoir, cette scène banale rejouée des milliers de fois par des milliers d’hommes et de femmes à chaque guerre mais qui d’aujourd’hui me semble tellement lointain et auréolée d’un tel mystère qu’elle me paraît impossible à esquisser ; Ici, pour moi la main tremble, l’esprit se ferme, les images disparaissent, les voix s’éteignent, rien n’apparaît.
On peut bien sûr, se raconter les embrassades, les larmes des uns ou la retenue excessive des autres, et les questions, les regards, les silences et peut-être les sanglots changés en rire ou dissimulés derrière de gros éclats de voix ; on peut se convaincre qu’on approche cette réalité tant qu’on voudra mais, en écrivant, je ne vois que la béance d’un intouchable moment de vie, car ces retrouvailles, ni la fiction ni le recours à des témoignages ne pourraient m’en ouvrir les portes, ce moment où Jules, dans la nuit de l’hiver, rentre enfin et retrouve sa femme et sa fille, sa belle-mère, mais aussi sa mère et ses frères. Ça, ce moment d’une réunion familiale, remise à plus tard depuis plus d’un an d’angoisses et d’espoirs déçus, ce moment-là où tous ses proches sont venus l’attendre sous le toit de sa femme, où toutes et tous se tiennent les uns contre les autres dans la cuisine ou devant le feu de la cheminée dans la salle à manger, ce moment me résiste, plus qu’un autre il se refuse, comme une main se referme et devient un point pour protéger le secret qu’il veut préserver dans l’intimité de sa paume. »
─ Laurent Mauvignier, La maison vide
La Maison Vide de Laurent Mauvignier nous emporte avec brio dans le tourbillon de la vie, dans la foule des générations qui se succèdent. Nous buttons avec ce roman sur les bassesses et les petites victoires de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous tiennent reliés par des fils inaccessibles et empoisonnés à un passé qui ne passe pas, qui nous constitue autant qu’il nous exclue, et que seul un immense écrivain pouvait nous faire réellement revivre. Un très grand livre.