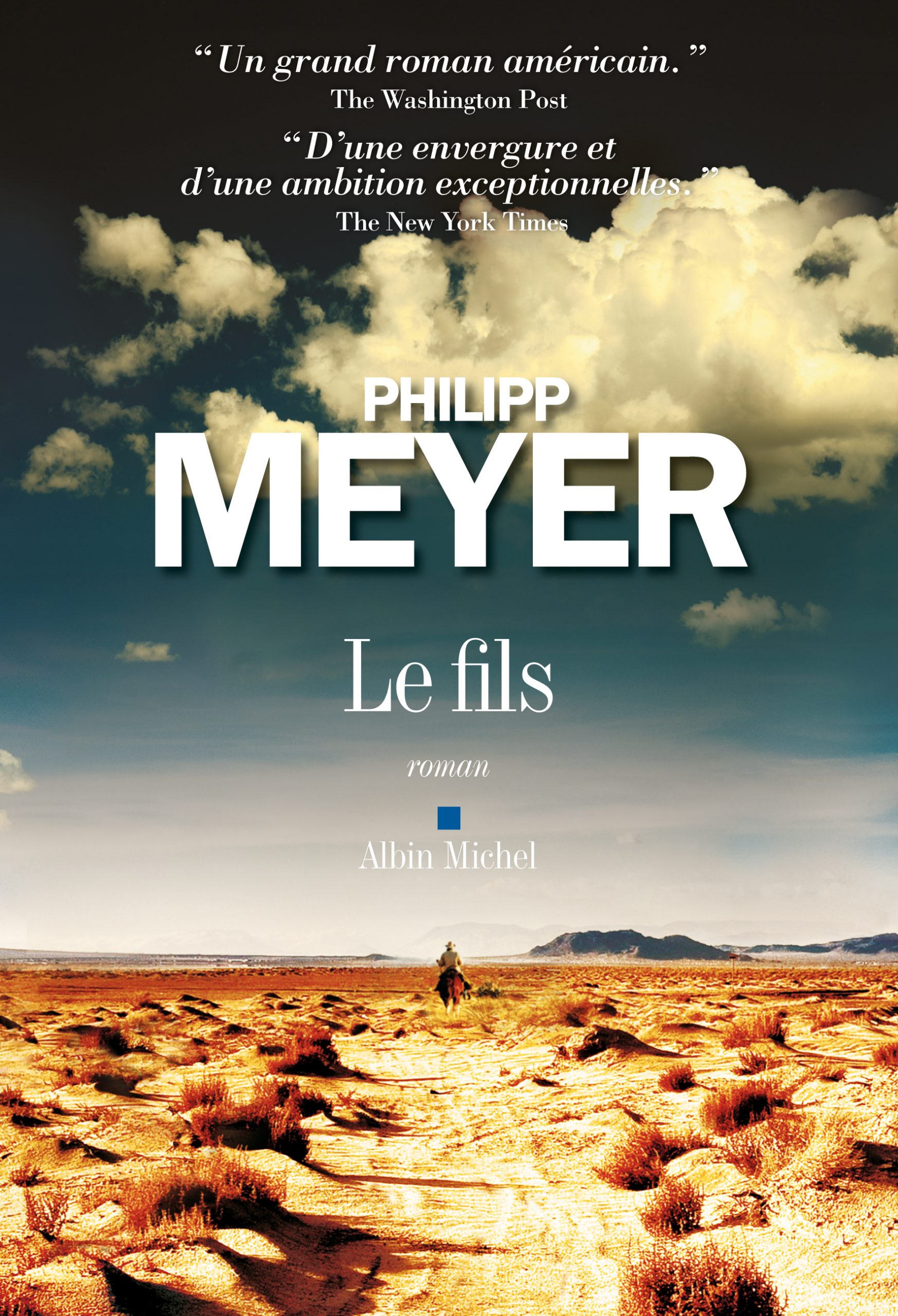Traduite avec succès en espagnol, italien, allemand, français, Tatiana Țîbuleac est née à Chișinău et vit aujourd’hui à Paris. Elle fait partie, sans aucun doute, des plus intéressantes voix actuelles dans la littérature européenne – Le jardin de verre, son deuxième roman après L’été où maman a eu les yeux verts, a d’ailleurs été récompensé avec Le prix européen de littérature en 2019.
Le jardin de verre, texte ô combien actuel aujourd’hui, au moment où l’Ukraine défend armes à la main ses frontières, sa langue et sa culture, et que la Moldavie appréhende aussi une déstabilisation provoquée par la Russie, a été traduit en France en 2020 aux éditions des Syrtes dans la traduction de Philippe Loubière.
« Je nais la nuit, j’ai sept ans« . Ce que la narratrice – aujourd’hui adulte – appelle naissance, est le moment de son adoption par Tamara Pavlovna. Nous sommes à Chișinău, en Moldavie soviétique, au milieu des années 80. Dans la nuit de décembre, une nouvelle chaleur s’empare de la jeune fille, la chaleur d’une poche amie, une poche garnie de fourrure qui abrite sa petite main transie de froid. La poche sert à réchauffer mais aussi à guider. Loin derrière, l’orphelinat et ses cauchemars, à présent la ville est là, ses immeubles, ses habitants, un appartement, la première journée chez Tamara :
« Je conserve toujours en moi le souvenir de cette journée, en tout pays, en toute circonstance. Je n’ai jamais rien trouvé d’équivalent, ni en argent, ni en amour. Personne ne m’a voulue davantage. Même pas vous, même pas vous. »
– Tatiana Țîbuleac, Le jardin de verre
Dès la fin du troisième chapitre, une cassure annonce la construction du récit : “même pas vous”. En effet, éclaté en brefs chapitres reflétant passé et présent, le texte alterne souvenirs et discours direct, adressé aux parents absents, sans cesse rappelés à leur défaillance et à la béance que leur disparition a ouverte dans l’existence de la narratrice.
Lastotchka (hirondelle en langue russe), tel sera le nom de la jeune fille, appelée ainsi par Tamara, et nous ne lui en connaîtrons pas d’autre. Commence dès lors une toute nouvelle vie, habillée de nouvelles habitudes et d’une nouvelle langue. Tamara Pavlovna est “bouteilleuse” – elle gagne sa vie en ramassant et en nettoyant les bouteilles en verre, Lastotchka fera de même.
Tamara est russe et ne parle que le russe. Lastotchka va donc déposer au fur et à mesure les mots de sa langue moldave pour se glisser dans ce nouveau vocabulaire. Du reste, elle n’aurait pas vraiment eu le choix : “Apprends le russe, sans lui, tu n’es rien !” – lui intime Tamara et au besoin, elle appuie ces consignes de son index “en triangle” sur le front de la gamine. Et Lastotchka apprend le russe. Elle va devenir quelqu’un et pour devenir quelqu’un il faut parler le russe. Le moldave est la “langue des ploucs”. Et pourtant, lors d’une nouvelle irruption de la voix du présent, la narratrice fait cette remarque :
« Peut-être aurais-je dû écrire en russe. En russe, les mots sont disposés différemment. En roumain, mes souvenirs sont plus clairs. Je veux vous dire tout. »
– Tatiana Țîbuleac, Le jardin de verre
Langue de tête et langue de cœur, langue apprise et langue maternelle, la langue est la maison de l’âme, du “Je”.
Aux côtés de Tamara, Lastotchka s’endurcit, la vie est ainsi faite : la collecte de bouteilles est une tâche ardue qu’elle effectue malgré les douleurs et la fatigue. Elle est dure aussi, la petite, patiente et obstinée. Elle apprend, elle s’adapte, elle se questionne. Une enfant ? Pas sûr qu’elle l’ait jamais été, qu’elle en ait eu le temps. On comprend, au fur et à mesure que le récit se déploie, qu’en espace de sept ans, les premiers de sa vie, Lastotchka avait connu non seulement l’abandon mais aussi le deuil et puis d’autres traumas qui vous font basculer irrémédiablement sur la rive du monde adulte.
Et à nouveau, la langue :
« Cette langue ! C’était une lutte perpétuelle entre les oreilles et la bouche, et c’est rarement la bouche qui gagnait. Les mots russes me donnaient l’impression d’être plus longs et d’avoir plusieurs sens à la fois. Une lettre de travers vous faisait tomber d’un monde dans un autre. Même les silences avaient quelque chose à dire. »
– Tatiana Țîbuleac, Le jardin de verre
La langue est un personnage à part entière dans le roman de Tatiana Țîbuleac, la langue en tant qu’élément constitutif de l’identité. La langue arrachée, la langue imposée, la valse des langues, bascule permanente entre deux mondes. La langue de Chișinău était le russe. Aussi multiculturelle qu’elle fut, la cité, (où cohabitent Moldaves, Ukrainiens, Juifs, Russes), une seule langue permettait de s’élever, de sortir du rang (tout en y rentrant, paradoxe !) le russe.
Et pourtant, lorsque le moment d’aller à l’école arrive, Lastotchka choisit l’école moldave. Elle ne saurait dire pourquoi, d’autant plus que la colère de Tamara est immense, violente. Mais Lastotchka s’y tient. Ce sera l’école moldave. Mais une langue moldave en caractères cyrilliques. Le retour à l’alphabet latin ne se fera qu’en 1989. Ce qui imposera un nouvel apprentissage. Kafkaïen, dites-vous ?
Un autre élément central du roman : la femme.
Femme kaléïdoscope, construite de plusieurs personnages, principalement les voisines de l’immeuble – Chourotchka, Bella Issaakovna, Roza, Marina, Maricica, Katia. Femmes vent debout faisant fi de leur faiblesse, la surmontant, toujours prêtes à se bagarrer.
« Les femmes de notre cour parlaient rarement d’amour physique et l’appelaient “cette affaire”. Ces deux mots contenaient tout à la fois un baiser, un accouchement et l’ablation de l’utérus. S’il n’en avait tenu qu’à elles, elles se seraient toutes recousu leur fente, comme elles le faisaient d’une chaussette filée. Ainsi, elles seraient devenues plus propres. Ainsi, elles seraient devenues plus puissantes. »
– Tatiana Țîbuleac, Le jardin de verre
Chacune des femmes présentes dans le récit, les “femmes de la cour de l’immeuble” pourrait avoir à son tour, son roman. Pourtant elles ne font rien d’autre que vivre. Ce sont réellement de magnifiques portraits de femmes, tristes ou heureuses, pauvres ou aisées, abîmées ou en début de chemin, pudiques ou putes, ensemble elles sont le monde.
Le Jardin de verre est un roman-kaléidoscope, comme l’objet préféré de Lastotchka. Ses différentes facettes reflètent l’histoire d’un pays, celle d’une langue, la double quête d’identité – celle familiale et celle culturelle; la vie au sein d’une communauté multiculturelle pendant une période où l’histoire préparait son basculement. Mais il évoque aussi le présent et son propre tribut au verre, fil conducteur de la narration.
On dit souvent d’un roman qu’il serait “nécessaire” : si vous souhaitez comprendre mieux ce qui se passe aujourd’hui à l’Est de l’Europe, Le jardin de verre est absolument nécessaire. Car il ne fait pas que traduire le présent, il le ramène également au niveau universel qui permet à chacun de s’en emparer et de le transmettre à son tour.
Je me dévêts de ma peau et je ne vois que des tessons de verre.
Mélangés comme des grains,
Ils crissent.
De trois vies, m’en faire une seule – combien de vies me faudrait-il ?
Je la revêts de nouveau avec soin,
et je me tais !
Que personne ne sache, ne voie, ne comprenne
Qu’on s’étonne encore de tant de beauté.
– Tatiana Țîbuleac, Le jardin de verre
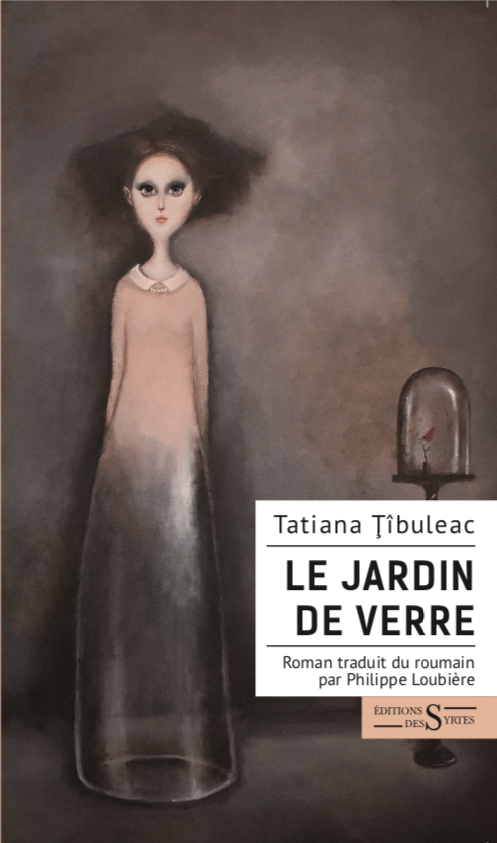
Le Jardin de verre de Tatiana Țîbuleac
Traduite par Philippe Loubière
Editions des Syrtes, avril 2020