Philippe Blanchet, directeur de la collection Rivages/Rouge, a eu la gentillesse de nous accorder un entretien dans ses bureaux à Ivry. D’une curiosité insatiable, cet infatigable défricheur sera présent le jeudi 23 octobre prochain au Thé des écrivains, à Paris (au 16, rue des Minimes, dans le troisième arrondissement), pour la première rencontre en librairie depuis la création de la collection.
Portrait d’un homme qui a consacré sa vie à la musique.
Fan de free jazz et de rock, prêt à subir pendant sept heures l’inconfort d’une position rendue compliquée par la présence d’un carton de 33 tours sous ses pieds pendant un voyage en avion depuis les États-Unis, Philippe Blanchet a été un temps pigiste à Jazzmag, Sono ou Stéréoplay à la fin des années 70, avant d’intégrer la rédaction de Rock & Folk et d’y passer le plus clair des années 80. Après avoir créé l’éphémère magazine Backstage début 1990, en s’inspirant du magazine Q, dont il appréciait le caractère exhaustif, il a travaillé à L’Événement du jeudi durant de nombreuses années, puis il a commencé à s’intéresser à l’édition en 1999.
Chez Flammarion, il a participé à la collection Librio Musique, « des biographies qui ressemblaient à des Que sais-je ?, avec une écriture si possible de qualité et une bibliographie en fin de volume » avant de publier, au Castor Astral, des ouvrages plus longs, plus développés, et ses premières traductions de textes étrangers, avec les livres de Peter Guralnick sur Elvis Presley et Robert Johnson.
*
Lorsque vous êtes passé chez Rivages, qu’est-ce qui a motivé votre choix ?
Pour des tas de raisons, j’avais envie d’aller chez un éditeur plus gros pour passer à la vitesse supérieure. Je suis allé voir plusieurs éditeurs, et comme j’avais des affinités avec Benoîte Mourot, qu’elle me faisait confiance et que la collection l’intéressait, je suis arrivé chez Rivages, où j’ai vraiment eu le sentiment de me retrouver presque « en famille ». Pour faire une comparaison avec la musique, Payot & Rivages, c’est un peu le plus petit des gros labels, ou le plus gros des petits labels : la structure idéale ! J’ai appelé la collection Rivages/Rouge, en clin d’œil à ce qu’avait fait François Guérif en polar, avec Rivages/Noir. Le choix du nom me paraissait absolument logique. Si je pouvais faire un tant soit peu – au niveau de la pertinence et de la qualité des textes – ce que François Guérif avait fait pour la littérature « noire », le pari serait amplement gagné. Et depuis je m’attelle à la tâche !
Comment avez-vous choisi les premières publications ? Et quelle identité vouliez-vous donner à la collection ?
J’ai d’abord pioché dans ma bibliothèque personnelle pour faire traduire les textes que j’avais aimés. Des bouquins ramenés des États-Unis ou de Londres, et qui n’avaient jamais été traduits. Des « classiques ». L’idée était de mettre à la disposition des lecteurs français de grands textes sur la musique, sur le blues, le jazz ou le rock. De montrer que ces sujets souvent considérés comme « mineurs », surtout dans le milieu de l’édition, étaient de la vraie littérature. Qu’il y avait de vrais écrivains, comme Peter Guralnick, Robert Gordon ou Barry Miles. L’autre objectif de Rivages/Rouge, c’était de mettre la musique dans son jus, en la plaçant dans un contexte historique, culturel, politique et social, d’apporter une vue différente sur les courants et les artistes, et de montrer à quel point musique et contre-culture sont intimement liées, notamment durant toute la seconde moitié du siècle dernier. Certains textes sont presque des livres d’histoire. Par exemple, 33 révolutions par minute, de Dorian Lynskey, brosse l’histoire de la seconde moitié du XXème siècle à travers celle du rock. Et c’est à la fois très pertinent et passionnant – lumineux, même ! Les livres sont des partis pris, et je crois qu’il n’y a pas de mauvais sujet.
On a l’impression que vous avez toujours eu une idée assez précise de ce que vous souhaitiez faire, que ce soit en tant que journaliste ou éditeur. Y a-t-il une volonté 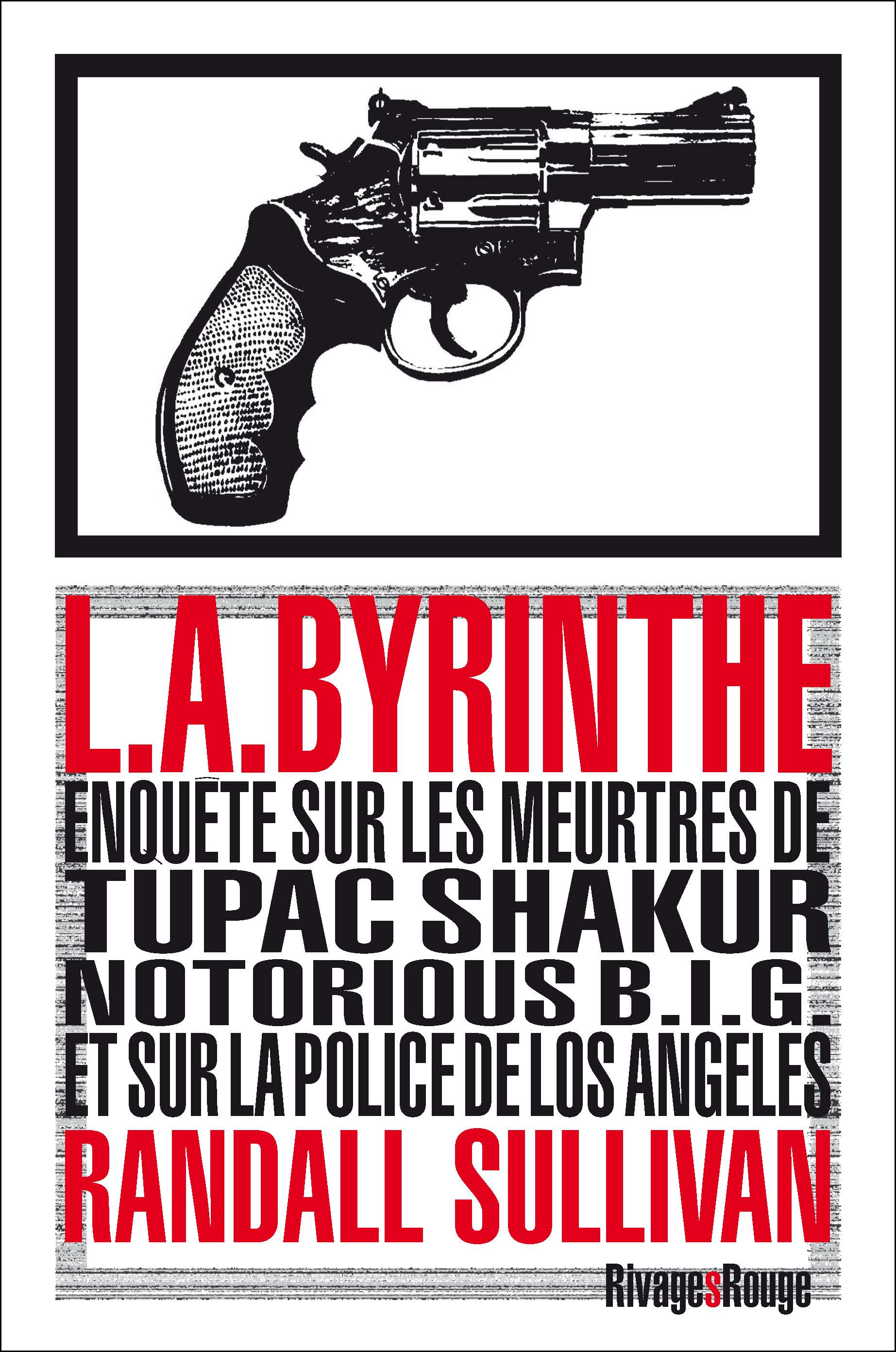 encyclopédique derrière le projet Rivages/Rouge ?
encyclopédique derrière le projet Rivages/Rouge ?
Oui, en partie. À raison de quatre par an, je publie des bouquins en espérant qu’ils s’inscriront dans la durée et constitueront un outil pour ceux qui les consultent. C’est pour ça, par exemple, que je suis assez maniaque sur la présence quasi-systématique d’un index en fin de volume. Je travaille pour les fans de rock et… les médiathèques ! (Rires)
Pouvez-vous nous parler d’un ou deux titres qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Le livre de Barry Miles sur l’underground londonien, Ici Londres, est un gros morceau. Il éclaire le lecteur sur l’importance capitale et du rock et de l’underground dans toute l’explosion culturelle de l’Angleterre d’après-guerre. Sinon j’aime particulièrement les deux livres de Guralnick, sur le blues et la country, Feel Like Going Home et Lost Highway. Tous les ingrédients que je recherche sont sans doute concentrés dans ces deux textes : une belle écriture, souvent très poétique, un art de raconter les histoires et de brosser des portraits absolument incroyables, une recherche sur le terrain unique en son genre, une érudition implacable et un amour de la musique qui illumine chaque ligne.
Comment faites-vous pour dénicher ce que vous publiez ?
Je farfouille à partir des bibliographies qui se trouvent dans les bouquins que j’ai aimés, ou que j’ai publiés. Sinon j’interroge mes amis à l’étranger, un petit réseau de libraires américains, ou j’explore les sites des maisons d’édition anglo-saxonnes qui sortent des ouvrages pointus sur certains sujets. De fil en aiguille, je tombe parfois sur une pépite. Tout cela est très empirique. Et très intuitif. Je reçois peu de propositions d’agents, et ce sont souvent des propositions hors-sujet.
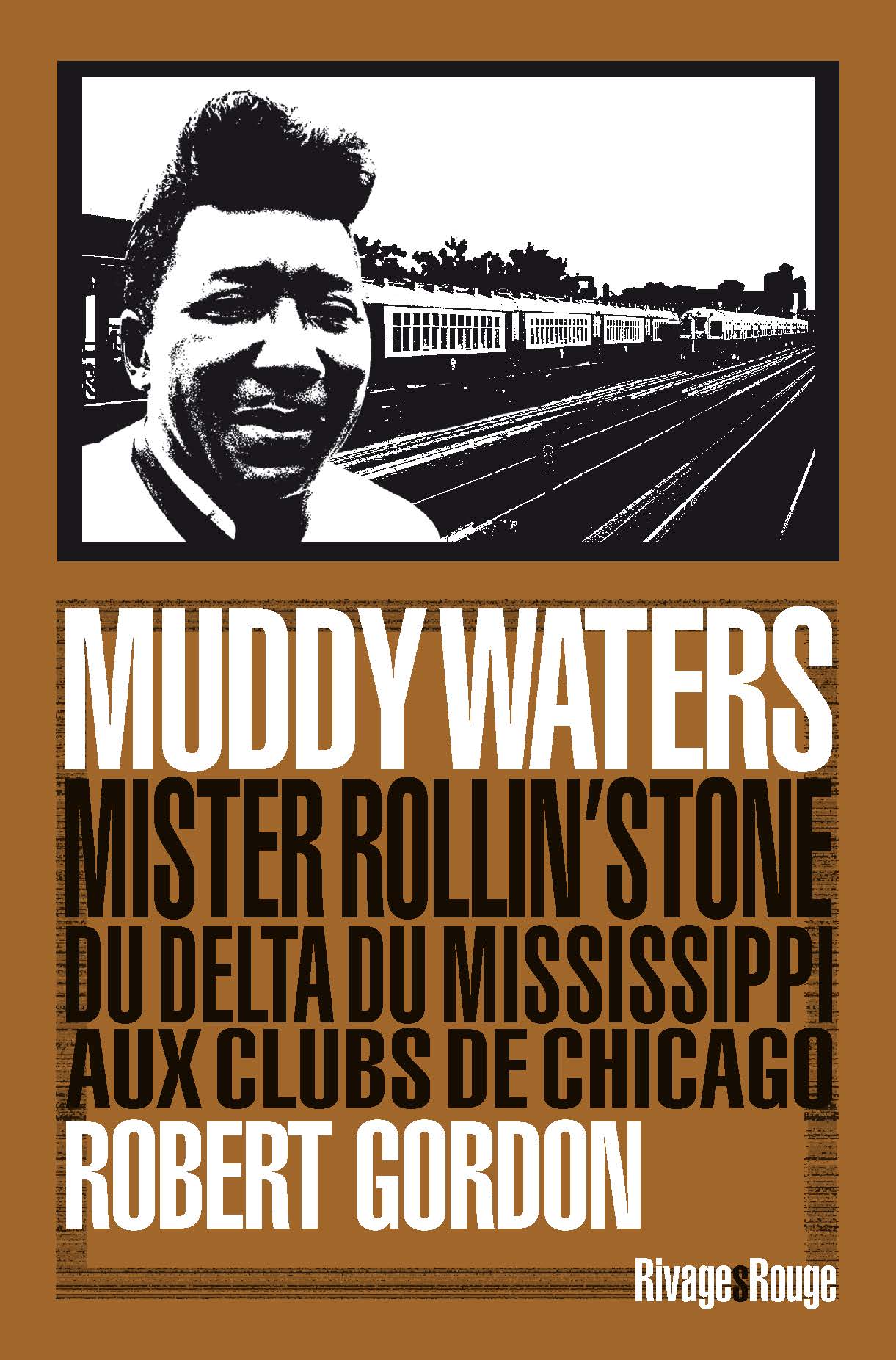 A votre avis, où se trouve la contre-culture, aujourd’hui ?
A votre avis, où se trouve la contre-culture, aujourd’hui ?
Sûrement pas dans le rock. Ni plus généralement dans la musique. Je vois mal Beyoncé en symbole de la lutte des femmes et Coldplay en porte-parole d’une quelconque rébellion. Encore une fois, pour moi le blues et le rock constituent l’expression culturelle majeure d’un autre siècle. Elle est devenue aujourd’hui une musique de répertoire. On aime tel groupe parce que ça ressemble aux Ramones. Et on va (ou pas) écouter les Stones exécuter leurs vieux tubes. D’où l’intérêt de redonner un sens et une perpective à toute cette époque, de replacer les choses, et pourquoi pas de réfléchir à la suite…
*
Merci à Philippe Blanchet, pour sa très grande disponibilité, et à Sébastien Wespiser, à l’initiative de cet entretien qui n’aurait jamais eu lieu sans lui.





















