[dropcap]L[/dropcap]e deuxième roman de Tiphaine Le Gall a de quoi intriguer et séduire : sous ce titre un brin énigmatique se cache un roman épistolaire à une seule voix. Autant dire que Le Principe de réalité ouzbek est en fait une longue lettre. Celle que nous appellerons la narratrice, pour plus de facilité, puisqu’elle n’a pas de prénom est l’auteure d’une missive qu’elle adresse à la principale du lycée de Tachkent, en Ouzbekistan. Elle a posé sa candidature au poste de professeur de français et de philosophie dans cet établissement, et vient de recevoir une réponse courtoise, mais négative. Cette réponse ne convient pas, elle ne convient pas du tout. Car la narratrice, tout simplement, doit partir en Ouzbekistan, et ce n’est certes pas le refus de cette femme, avec laquelle elle a échangé une fois en visioconférence, qui va l’arrêter. Pourquoi cette impérieuse nécessité ? La narratrice a-t-elle un lien avec l’Ouzbekistan, une raison imparable de partir à Tachkent ? Voilà une des nombreuses questions auxquelles cette longue lettre va s’efforcer de répondre.
« Tout cela pour vous dire que l’idée que je me fais de Tachkent, ma projection de l’Ouzbekistan, n’est probablement pas conforme à la réalité, à une certaine forme de réalité, mais qu’en même temps cela n’a strictement aucune importance. »
Tiphaine Le Gall
Les raisons d’étonnement ne manquent pas : pourquoi livrer cette lettre – un message personnel – à la curiosité des lecteurs ? Pourquoi écrire à cette femme, que la narratrice connaît à peine, et lui exposer ce qu’elle considère comme la motivation indiscutable de sa volonté de départ, lui confiant du même coup les aspects les plus intimes de sa vie personnelle ? Tiphaine Le Gall s’embarque dans un tumultueux voyage, et dévoile, page après page, ce qu’est la vie de la narratrice, prof à Brest, compagne de Mathias, père de ses enfants. Une vie plutôt agréable, dont le quotidien a été bouleversé par l’irruption de Mathias dans sa vie secrète, celle que la narratrice confie à ses carnets intimes, révélant ainsi l’existence d’une histoire d’amour avec Ismaël. Rassurez-vous, Tiphaine Le Gall ne nous livre pas avec ce roman un de ces innombrables récits de vie, d’adultère, de cas de conscience, de devoir maternel et conjugal. Le Principe de réalité ouzbek va beaucoup plus loin que cela, et surtout le roman fouaille les blessures les plus profondes, sonde les lieux les plus sensibles, explore avec un mélange de distance et de douleur les questions du désir, du couple, de la possibilité même de la notion de couple. Il questionne aussi la nature de la littérature, de sa fonction de miroir et de possible réparation, avec insistance et talent, éveillant chez le lecteur, avec cette histoire intime, des sentiments très personnels et des questionnements qui lui sont propres.
Le roman, sa forme et son fond, tout en racontant l’histoire de la narratrice, suscite ainsi exactement les questions qui taraudent son auteur, et « travaille » au corps, au cœur et à l’esprit celles qui obsèdent tous les amoureux de littérature. Une des raisons pour lesquelles Le Principe de réalité ouzbek est un roman d’exception, de ceux qui ne trichent pas…
[divider style= »dashed » top= »10″ bottom= »10″]
L’entretien
C’est à Brest, dans sa jolie maison bleue, que Tiphaine Le Gall a bien voulu répondre à quelques questions et surtout, généreusement, explorer les ressorts de la littérature, de l’intimité, du désir. Merci à elle pour ce moment.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, à savoir votre dernier roman, Le principe de réalité ouzbek (La Manufacture de livres), j’aimerais que vous nous parliez un peu de votre premier roman, Une ombre qui marche (L’Arbre vengeur, 2020), qu’on aurait pu prendre pour une forme de provocation. Il s’agissait d’un texte qui prenait la forme d’un essai consacré à un auteur « culte », dont l’ouvrage-phare était constitué de pages blanches.
C’est vrai que cela pourrait passer pour une provocation ou une boutade, mais pour moi c’était au contraire quelque chose de très sérieux et de très profond. A tel point qu’il fallait que je trouve une forme de légèreté pour en parler. Pour moi, la définition même d’une œuvre littéraire est qu’elle compose avec le silence, consciemment ou pas. Certains auteurs l’ont théorisé, d’autres pas du tout, mais j’ai l’impression qu’on retrouve ça partout. Par exemple, c’est le principe même de la poésie, un texte plutôt court, concentré de sens : dans les quelques mots que donne le poème, il va ouvrir à l’inexploré toutes les significations, tous les sens que peuvent revêtir quelques mots. Le prisme va être d’autant plus large que ce qu’on nous donne au départ est peu. C’est tout ce qui se loge dans l’implicite, la suggestion. Certains théoriciens l’ont formulé : l’œuvre, c’est la lecture que l’on en fait, il y a le texte et le lecteur.
Pensez-vous que cette vision des choses peut aussi s’appliquer à l’art ?
Oui, bien sûr. J’ai par exemple pensé à John Cage et à ses 4 minutes 33 secondes de silence. Complètement par hasard, j’ai découvert qu’il existait un livre, Wit-White, constitué uniquement de pages blanches. L’artiste s’appelle Hermann de Vries, et comme par hasard, le livre a été réédité par une petite maison brestoise, Zédélé, qui me l’a offert. C’est un peu mon point de départ : cet auteur serait devenu une figure du renouveau littéraire car il aurait redonné l’espace vierge à toutes les projections. Bien sûr, je m’amuse un peu avec cette histoire, j’imagine que certains lecteurs ont eu des réactions violentes face à ce livre, qui constituait une confrontation à soi, radicale.
Comment situeriez-vous votre deuxième roman par rapport au premier ?
Il y a bien sûr un lien entre ces deux textes : celui de la projection. Ce que l’on projette dans l’espace vacant pour le premier roman, l’espace vacant du réel pour le deuxième. Tout ce qui dans notre vie est de l’ordre de l’impression, de ce qui n’est ni palpable, ni dit, ni perceptible… Nous sommes tout le temps dans une interprétation de nos propres vies : on s’interroge sur le sens d’un geste, d’un mot, de quelque chose qu’on voit et qui nous interpelle. Nous sommes traversés par des pensées sans lien entre elles, qui paraissent complètement anecdoctiques et qui finalement vont prendre une importance démesurée. J’ai voulu plonger dans l’esprit d’une femme, la narratrice, pour voir comment fonctionnaient ces multiples strates de pensées qui sont à la fois tissées dans le réel et des projections du réel et qui se nourrissent de tout le mystère que constituent nos vies.
Poursuivons par les questions qui viennent immédiatement à l’esprit une fois qu’on a terminé votre livre. Pourquoi la forme épistolaire à une voix ? Pourquoi avoir choisi une destinataire que la narratrice ne connaît pas, pourquoi l’avoir investie de tant de responsabilités ? Pourquoi la narratrice n’a-t-elle pas de prénom ?
C’est vrai : les hommes ont des prénoms, les femmes n’ont pas d’identité distincte dans le livre. Pour revenir à la forme épistolaire : la lettre, c’est vraiment le lieu de l’intime. Quand on écrit une lettre, c’est une tentative pour atteindre son interlocuteur, dans un cadre clos, dans une enveloppe, avec un destinataire. Pour parler de l’intime, j’ai trouvé intéressant d’explorer ce mode d’écriture. Et puis je cherchais à comprendre comment on pouvait atteindre l’autre par le langage. Je me suis beaucoup intéressée à la pensée de Bergson qui a écrit sur l’incommunicabilité, sur le fait que le langage était un perpétuel malentendu. Se tourner vers la possibilité d’un échange, d’une rencontre toujours biaisée, qui passe toujours par des filtres de représentation. En même temps la tentative d’échange est belle, et il y a toujours un hiatus, un espace insoluble et irréductible entre soi et l’autre. Paradoxalement, parfois on se rend compte de ce hiatus, et on éprouve une grande solitude alors même qu’on essaie de rejoindre l’autre. J’ai voulu exploiter tout ce qui est de l’ordre de l’adresse à quelqu’un. La narratrice est dans une grande solitude, et elle s’efforce de toucher son interlocutrice. Cette interlocutrice, elle la connaît à peine. C’est dans un cadre professionnel, et c’est une façon de faire voler en éclats une certaine forme de superficialité qui régit les rapports entre humains. D’où la phrase de Jankélévitch que j’ai mise en exergue du roman ¹. Il y parle de l’aventure, et notamment de l’aventure amoureuse, et il explique que c’est la chose la plus importante qui arrive dans une vie. Il évoque la vie désolante du fonctionnaire qui ne se remplit que de ses différentes fonctions, ce qui est d’un ennui accablant. Et il conclut en disant que lorsqu’il s’agit de recruter un fonctionnaire, on ne lui demande jamais le nom des femmes qu’il a aimées, ce qui est pourtant le plus important.
On est souvent pris dans un cadre, dans les différents rôles qu’on occupe, et ces cadres sont très bornés et ne montrent qu’une certaine façade de nous-même. J’ai donc eu envie de ce basculement. La narratrice veut confier ses motivations, et elle ne peut le faire qu’en basculant dans l’intime. Dernière chose : c’est une mise en abyme de l’écrivain avec son texte, avec ce jeu de la lettre qui est aussi un roman qui s’adresse à tout le monde. Comme chez Montaigne, ce qu’on ne dit pas à ses proches, on l’écrit pour que ce soit lu par tout le monde.
Qu’est-ce qui fait la différence entre l’écriture de carnets intimes – ceux qui déclenchent le drame dans le roman – et l’écriture de cette lettre ?
Dans les carnets il y a une forme de liberté absolue : c’est un espace de liberté, ces carnets n’ont pas vocation à être lus, et lorsque le compagnon de la narratrice s’octroie le droit de les lire, elle ressent une forme de violation. Alors que la lettre est tendue vers son interlocutrice. Le point commun, c’est qu’à aucun moment on ne sort de la tête de la narratrice. Ce qu’on croit percevoir du réel, c’est ce qu’elle veut bien en dire. C’est pour cela que la lettre n’a pas de réponse… Ces carnets, avoue-t-elle, sont des fausses preuves de son amour coupable, car ils ne disent que ce qu’elle a dans la tête et pas nécessairement la réalité.
L’idée de partir à Tachkent, en Ouzbekistan… Rien que les mots me sont apparus comme des sortes de fétiches, de talismans, de formules magiques. Avant même de penser à ce que désignent ces deux mots, la ville et le pays.
Oui, ils correspondent à une forme d’inconnu. Le pays dont on n’a pas de représentation : on va regarder sur une carte où il se situe. Il se trouve que depuis la publication, j’ai eu un certain nombre de réactions de lecteurs ou de lectrices qui me disent « Justement, je suis allé en Ouzbekistan. » Donc finalement, on se rend compte que c’est une réalité pour un certain nombre de personnes! Mais pour moi, c’est un pays pour lequel on n’a peu de représentation, et qui en même temps offre une terre vierge à la projection. Quand on cherche un nouveau départ, un ailleurs qui n’a pas été défloré par les récits de voyage des amis : l’Ouzbekistan semble être quelque chose d’absolument nouveau, comme s’il naissait au moment où on en parle.
Et puis il y a un grand questionnement sur la nécessité du destin. Comment peut-on justifier la nécessité de partir justement là ? Effectivement, elle se trouve des raisons pour lesquelles elle doit partir en Ouzbekistan. On peut avoir la sensation que notre vie est déterminée par des forces extérieures. Il est assez contemporain de considérer que nous sommes maîtres de nos propres vies : or c’est encore une fois une façon de nier un principe de réalité qui nous dépasse. Jusqu’où acceptons-nous de passer outre ? Franchir des limites permet d’aller vers soi-même – ce qui présente un parallèle avec la rencontre amoureuse. La narratrice s’oppose à la fatalité du refus qui lui est opposé, et c’est un peu la même chose avec l’histoire amoureuse qu’elle a vécue. Elle porte un autre regard sur elle-même, elle se découvre autrement.
Est-ce qu’elle n’investit pas son amant d’une forme de vénération un peu irréaliste ? Est-ce qu’il n’y a pas là aussi une façon de s’échapper ?
Je ne sais pas si elle manque de lucidité, car elle laisse tout de même entrevoir dès le départ l’existence d’un certain nombre de failles dans cette histoire d’amour. Il y a, toujours, les deux faces du miroir : l’exaltation de la passion amoureuse avec ce qu’elle apporte de lumière, de légèreté, ce qui la ravit et la dépasse, peut lui faire manquer de lucidité, et de l’autre côté le regard désenchanté sur ce qu’elle a vécu – une histoire passagère qui aboutit à un échec et à un drame conjugal. Avoir aimé un homme qui ne la reconnaît pas quand il la croise dans un café… Là encore, tout cela est une question de regard sur cette histoire amoureuse et sur le principe même de l’amour – l’exaltation, la beauté fascinante mais aussi la trivialité qui ramène à des choses assez naïves… Remettant ainsi en question les idéaux de la prédestination de la rencontre amoureuse.
Il y a l’histoire d’amour, mais aussi le désamour envers son compagnon de vie, le père de ses enfants. On a l’impression qu’elle dépouille son ancien compagnon de tout ce qu’il pouvait avoir de brillant pour en parer son nouvel amour.
C’est un regard cruel sur le couple, c’est vrai. Le regard qu’on a sur la personne avec laquelle on vit, et qui se noie dans le quotidien, le fil des jours, la contingence, la répétition. L’autre, en devenant une part de nous-même, devient aussi un étranger. Â force d’être intégré à notre propre vie, l’autre finit par ne plus exister. C’est ce dont elle fait l’expérience elle, c’est aussi ce qu’elle renvoie à son compagnon. Cela est d’ailleurs suggéré par les deux noms masculins : Mathias et Ismael, deux prénoms avec les mêmes consonances, dans un ordre différent. Au fil du temps, son amour pour Mathias s’est délité jusqu’à ce qu’elle rencontre Ismael qui représente un renouveau, mais aussi un avatar du premier. Je pense que c’est une des grandes complexités du couple, une des questions au cœur même de l’amour. Au cœur de l’amour, il y a un mystère et à partir du moment où ce mystère commence à être résolu, le contenu de tout ce que l’on projetait sur l’autre perd de son éclat et pourtant, le sentiment amoureux nous rend avide de l’autre. Ce sentiment d’être comblé est toujours temporaire, et à mesure qu’on se remplit de l’autre, on le vide de tout ce qu’on pouvait y mettre de mystère et de fantasme.
Vous êtes passée d’un roman qui était une démarche hautement littéraire à un roman qui va au cœur de l’intime. Est-ce que vous avez voulu passer à quelque chose de plus émotionnel, toucher le cœur des lecteurs en même temps que leur intelligence ? Pour aller vers les gens, faut-il les émouvoir ?
On a envie de pénétrer la boîte noire ! Quand j’écris, je raisonne avec ma propre expérience de lectrice. J’aime beaucoup être stimulée intellectuellement, c’est vrai. C’est ce qu’on me dit souvent d’ailleurs, donc il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Peut-être le premier roman constituait-il une forme de protection par rapport à ma timidité d’auteur ? Pour moi, la question du vide – les pages blanches – est un élément fondateur de ma vie. J’ai sans doute mis en place des protections. Dans le deuxième roman, j’ai voulu être dans une forme de sincérité de l’écriture, ce qui ne veut pas dire que tout ce que j’ai écrit a été vécu personnellement, mais je n’ai pas voulu m’embarrasser de filtres. Je voulais parler de ces questions de l’intimité, de ce qu’elles comportent de dimension imaginaire, rêvée, idéale. Et puis j’avais envie d’écrire sur Brest, cette ville où je vis depuis un certain nombre d’années et que je trouve très romanesque. Pour ce deuxième livre, je n’ai pas cherché à décentrer le propos de ma propre existence. En tant que lectrice, j’aime les livres qui sont des miroirs, qui me parlent de ma vie, en fait. Et il y a beaucoup de facettes dans une vie, donc beaucoup de miroirs possibles. Pour moi, la lecture de romans n’est pas une façon de se distraire et de s’évader, au contraire, c’est quelque chose qui nous ramène à nous.
Et le fait qu’il n’y ait pas de prénoms pour les personnages féminins ?
Le lieu de l’intime, c’est aussi le lieu de l’universel, donc je trouvais bien qu’il n’y ait pas de prénoms. Et puis il y a cette ambigüité avec son interlocutrice : par moments, on ne sait plus très bien qui est qui, on peut douter. La question du nom d’un personnage est une grande question, car un nom a deux facettes : d’un côté il enferme en donnant une orientation au personnage, d’un autre il ouvre des possibilités. Peut-être est-ce une question que je n’ai pas résolu pour la narratrice, y compris à la fin de cette lettre où s’est posée la question de la signature. Il n’y a donc pas de signature. Pendant que j’écrivais, c’est une question qui me taraudait : je n’ai pas trouvé de nom pour cette femme car tous les noms que j’aurais pu trouver me semblaient la réduire.
Que se serait-il passé si la destinataire avait reçu cette lettre ?
En fait j’ai même pensé à l’envoyer, cette lettre. Car cette situation par rapport à l’Ouzbekistan, je l’ai vécue. Alors, on peut imaginer la réaction de la directrice : j’ai l’impression que chaque retour de lecteur que je reçois constitue comme une réponse de cette personne. Souvent, on me dit : « Non, non, il ne faut pas qu’elle parte. » On peut d’ailleurs se demander si le personnage principal va vraiment partir, si elle va aller au bout de son geste.
D’ailleurs, à un moment précis, page 157 précisément, vous formulez clairement la question qui se pose et la narratrice répond : « Je ne suis pas folle. »
Oui, c’est comme quand elle écrit à la directrice que tout cela va rester entre elles. Mais son geste reste très argumenté, rationalisé. Elle est très lucide sur ses motivations, mais elle comprend aussi qu’une part de la réalité lui échappe. Elle cherche à de multiples reprises à persuader la directrice de la justification de son acte. C’est nécessaire pour elle. On se trouve dans cette petite zone où, lorsqu’on a affaire à quelqu’un qui s’écarte de la norme, on a tendance à s’en éloigner. Quand on est dans la sincérité pleine et entière d’un acte, on est éduqué à ne pas faire état des mouvements intérieurs qui nous habitent. Elle va aller jusqu’au bout de son raisonnement, pour montrer que la vérité est là.
Pensez-vous que l’investissement dans la littérature qu’on évoquait tout à l’heure peut, à la limite, encourager ce type de comportement.
Oui, sûrement. Ce n’est pas anodin que la narratrice soit prof de lettres : il y a ce phénomène de miroir et d’écho bien sûr, mais il y a aussi cette sorte de satisfaction qu’on éprouve à voir se dérouler devant soi la vie des personnages, avec la nécessité d’un destin, un enchaînement de faits qui se succèdent. Par exemple dans le roman policier ou le roman noir traditionnel, c’est extrêmement satisfaisant car chaque élément trouve sa cause à un moment ou à un autre. Tout serait un enchaînement de faits dans un lien de causalité, alors que dans la vie réelle, on a souvent l’impression que c’est le chaos, qu’on a plein d’identités différentes et que quand elles se réunissent, la cohésion n’est pas au rendez-vous… La narratrice va donc vouloir faire coïncider l’idée de son destin personnel qu’elle s’est forgé, avec ses actes. Encore une fois, le fait qu’elle soit prof de lettres n’est pas innocent : elle a tendance à questionner ce qu’elle vit et à tout voir par le filtre de la littérature. Finalement, on apprend à vivre à travers les livres qu’on lit ou les films qu’on voit, particulièrement quand on est très jeune. On apprend à aimer, à se comporter dans le monde à travers nos lectures, avant d’avoir vraiment l’expérience de la vie.
Est-ce qu’écrire un roman, finalement, ce n’est pas aussi tenter de mettre un peu d’ordre dans tout ce chaos ?
Grande question ! Oui, sûrement. Un autre point commun entre les deux livres est l’existence d’un dispositif. Le premier prenait la forme d’un essai, dans le deuxième, il n’y pas de linéarité et c’est l’enchaînement des pensées de la narratrice qui fait la structure du récit. Je voulais quelque chose qui soit à l’image du déroulement de la pensée. Certaines choses nous semblent avoir du sens et se révèlent anecdotiques, d’autres nous semblent anecdotiques et finissement pas prendre du sens. Dans l’écriture, je cherche à rendre compte de cette expérience diffractée et parfois morcelée de l’existence. Sûrement, il y a une forme de réparation dans l’écriture, de transformation d’une nébuleuse informe en quelque chose qui serait éclairé par la confrontation des images entre elles, par ce phénomène d’écho. En tant que professeur de lettres, quand on fait de l’analyse de textes, on finit par trouver que chaque mot est signifiant, a sa place et remplit son rôle. Le texte étant le tout, absolu et fini. Le rôle de l’exégète, c’est de justifier que chaque chose soit à sa place et de mettre au jour des réseaux de significations qu’on ne perçoit pas à la première lecture. Ce qui forge un certain regard sur le monde… Le monde serait alors un réseau de signes qu’il faut interpréter. Tisser le sens à partir de ces signes.
Est-ce que vous pensez que la tendance du roman « à plusieurs voix » répond aussi à cette question ?
Cela me fait penser aux Ames fortes de Giono, où deux narratrices racontent la même histoire suivant leur propre perspective. Â aucun moment on n’a la vérité. Ce que je trouve intéressant dans ce type de dispositif, c’est la faille. Personne ne détient la vérité, seuls existent les prismes des regards. C’est d’ailleurs une grande question philosophique qui remonte à l’Antiquité : qu’est-ce qui existe en soi en dehors des représentations qu’on a des choses ? Dans un monde aussi rationnel et cartésien, d’où on a largement évacué la poésie, je ne suis pas étonnée que ces formes-là intéressent les auteurs et les artistes. Ce qui interpelle, c’est le silence, ce qui n’est pas dit.
Pour terminer, pouvez-vous nous parler de vos projets ?
Je suis en train de finaliser un travail sur le poète arabe Mahmoud Darwich. Cet homme, mort en 2008, était capable de déplacer des foules lors qu’il venait lire sa poésie dans des salles de spectacle. Ce poète palestinien a vécu en exil une grande partie de sa vie, et a beaucoup écrit sur l’exil et sur l’étrangeté. D’ailleurs je cite à la fin du livre un extrait d’un de ses poèmes ², où il interroge l’exil intérieur et comment on cherche à se trouver en l’autre. C’est un auteur que j’ai beaucoup lu et le texte que je finalise en ce moment donne la parole à un professeur qui donne un cours sur le poète. Il y a donc une articulation entre mes trois livres. Dans celui-là, j’ai voulu m’interroger sur la posture de l’enseignant – puisque je suis enseignante. Enseigner la littérature sans parler de soi personnellement, c’est une vraie question. Quand j’évoque une poésie de Baudelaire en cours, cela évoque quelque chose aux élèves lorsque les thématiques les concernent. Il faut donc parvenir à parler sans se livrer, alors qu’en littérature, il est question de parler de soi ! Dans le troisième livre, je mets en scène un professeur qui dépasse ces frontières, et qui se livre sur la façon dont la poésie peut réduire les distances entre un professeur d’université français et un poète palestinien qui a vécu l’exil et plusieurs drames dans sa vie. Je me suis passionnée pour ce poète, et suis allée jusqu’à interroger le traducteur de Darwich, Elias Sanbar. Il y a une chose qui est propre à la poésie : elle peut nous toucher profondément sans qu’on la comprenne pleinement. J’ai commencé autre chose de complètement différent autour d’un poète irlandais, William Butler Yeats, qui a écrit un poème que j’ai lu et appris il y a très longtemps et qui m’est très cher. J’ai envie de l’interroger par rapport à mon histoire la plus personnelle, et aussi à la pensée de Jankélévitch. Après le texte sur Darwich, j’ai la sensation d’avoir clos un cycle…
Est-ce que vous êtes très influencée par le monde extérieur ?
Oui, comme par mes lectures. D’un autre côté, quand je me mets à écrire, je me coupe du monde. L’écriture se fait dans une grande solitude.
¹ « Quand il remplit ses feuilles de vœux, le fonctionnaire n’indique pas ses bonnes fortunes: cela n’intéresse pas l’Administration ; il mentionne les postes qu’il désire, énumère les décorations et récompenses qu’il a reçues, mais on ne lui demande pas le nom des femmes qu’il a aimées. Et pourtant c’est la chose du monde la plus importante et la plus grave! » Vladimir Jankélévitch, L’aventure, l’ennui, le sérieux.
² Cette année est difficile.
L’automne ne nous a rien promis,
Nous n’avons pas attendu les messagers
Et la sécheresse est telle qu’en elle-même : une terre souffrante
Et un ciel doré.
Que mon corps soit mon temple.
(…)
… A toi d’atteindre le pain de mon âme
Pour te connaître toi-même. Et je suis sans limites,
Si je le désire :
Avec un épi, j’agrandis mon champ.
Et j’élargis cet espace avec une tourterelle.
Que mon corps soit mon pays. »
Mahmoud Darwich
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
[one_half]
Le Principe de réalité ouzbek de Tiphaine Le Gall
La Manufacture de livres, septembre 2022
[button color= »gray » size= »small » link= »https://www.lamanufacturedelivres.com/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/LaManufactureDeLivres » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/la_manufacture_de_livres/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/LaManufDeLivres » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]
[/one_half][one_half_last]
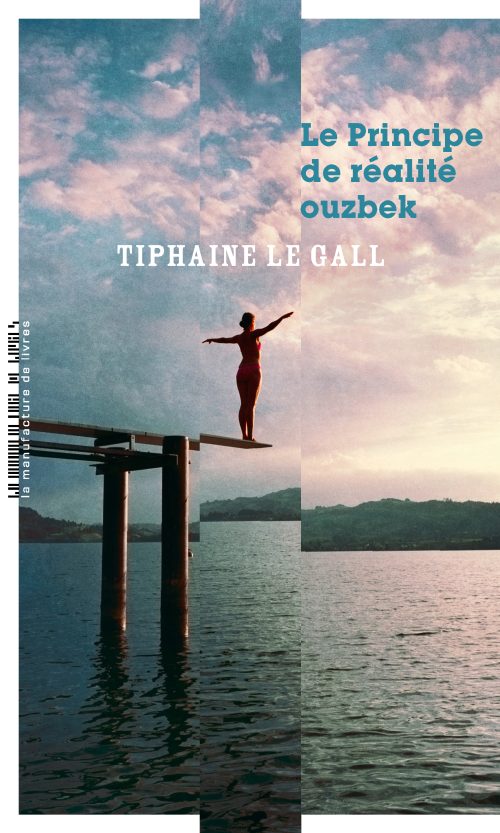
[/one_half_last]
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
Image bandeau : photo CDD

















