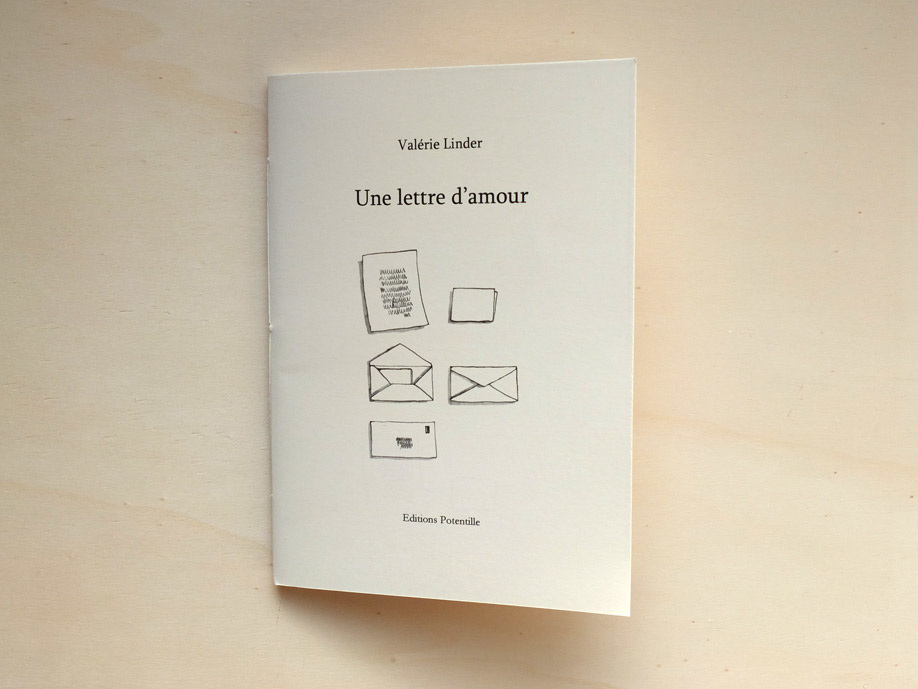[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]Q[/mks_dropcap]uelques rides. Un rectangle blanc, une épave, une carte marine — courbes, chiffres, symboles, fractales des côtes. Rompant le calme plat, l’instant où le vent se lève. Ne pas définir l’origine ni tout à fait qualifier la force. « Saisir l’indescriptible ». Un miroir troublé, les prémisses d’un souffle, une impression. Les effets d’une très légère brise sur les feuilles blanches.
Fixée, en premières pages, l’exposition : lieux, personnages, actions. Résumé, corps mort italique, coffre de surface. S’attacher à : identifier, nommer, se situer, reconnaître l’intrigue. 1. « Il y a un hôtel, posé sur le bout d’un pré, lui-même coupé par les vagues. Dans cet hôtel, géré par Capvrai, personne ne vient jamais. Les clients ne viennent pas passer de temps par ici, encore moins y dormir où se restaurer. Pourtant il y a un restaurant, et, parfois, les employés de l’hôtel y mangent. Il se passe différentes choses dans et autour de l’hôtel. » 2. Capvrai (le chef – moi – Monsieur Capvrai) est fou. 3. Un nouvel hôtel est construit, l’ancien ferme. 4. Capvrai tue, peut-être accidentellement, la muette, le chef et Nègue-Chin Devaux. 5. Cashon, le secrétaire médical, recopie et interprète le récit d’après les carnets de Kopeke, expert psychiatrique.
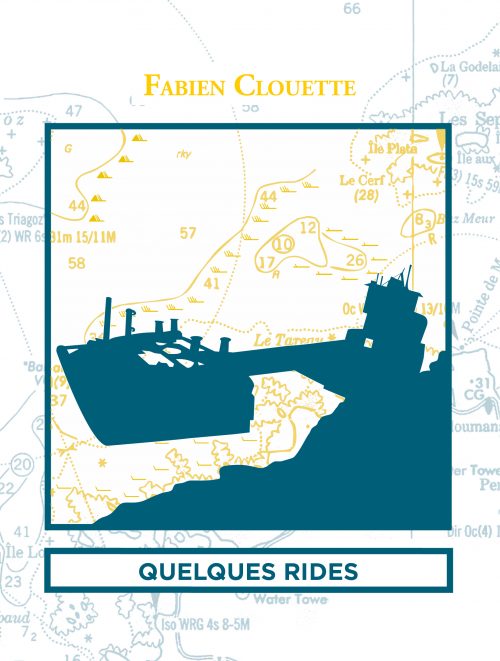
[mks_dropcap style= »letter » size= »83″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]R[/mks_dropcap]evenir à ces premières pages, pour s’accrocher à l’intrigue, quand les suivantes désorientent. Puis comprendre que le livre n’est pas contenu dans les faits. Que les événements et les lieux sont prétextes et matières. Que tout se joue dans les mouvements et les glissements, le cadrage, la focale. Dans les images qui surviennent. Celles que l’auteur induit, celles que l’on recompose à partir des fragments happés, celle que l’on invente. Apprécions que l’on nous ouvre la cage et que l’on nous relâche, lecteurs fauves, dans le roman. Prenons le risque d’une lecture libre. De jouer avec le montage, d’évoluer dans le livre et de ne pas craindre de s’éloigner du repère initial. Opérer des coupes, des retours, des sauts dans un texte débarrassé des habituels filins de rappel didascaliques. Se concentrer pour suivre et lâcher prise pour circuler. Accepter de se laisser porter, de s’immerger, de se projeter dans la situation proposée pour : voir – entendre – comprendre – sentir.
Visions fugitives. Les regards glissent, les visages se tournent. L’on aperçoit parfois la scène depuis la fenêtre du train ou le hublot d’un avion. (Alors : couper le vitrage, enjamber les murets.) Un bus longe la zone portuaire, « il y a toujours ces quatre personnes qui discutent à l’avant ». Plusieurs passages, quelques arrêts. Le journal local est ouvert à la page des annonces. S’emmêlent : les conversations des passagers, les bribes de dialogues, le temps des parents. Les souvenirs et le présent, les rêves et les témoignages rapportés. Libres, indirectes, les voix se confondent. Le bruit de fond parasite. Retransmissions multiples et simultanées, propositions alternatives. Choisir qui l’on écoute, qui l’on regarde. Se tenir à un interlocuteur, puis en changer. Certains, peut-être, se contredisent. D’un paragraphe à l’autre, les pensées des témoins dérivent et interfèrent. Se remémorer la lecture comme une latence, un suspens. Lire d’une traite et plusieurs fois. Écrire en immersion et écouter les bruits de l’extérieur avec attention, dans le même instant et la même intensité. Être à la fois hors et en. Poreuse. A l’affût des bulles qui crèvent la surface, du clapot des images qui persiste longtemps après la lecture.
[mks_pullquote align= »left » width= »250″ size= »24″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]« Confondre ses propres souvenirs et ceux du livre. » [/mks_pullquote]
Les cerfs traversent la chaussée à intervalles réguliers. Expéditions en hors-bord au pied des falaises pour voler des grumes. Les toilettes d’un hangar, un lavabo, un homme mort. Un plongeon dans une piscine, un mérou, les manœuvres dans l’anse du cimetière marin. Une femme à l’étage, les traces de pas sur le kaolin, la télévision allumée. Les tâches bleues sur la pelouse. Un verre de lait. Peupler l’espace laissé libre, les flous et le hors champ. Entre, il y a la proximité de la mer et ces lieux où l’on passe sans y penser, que l’on croit reconnaître, que l’on ne distingue pas. Qui pourraient être autres. Le gris sur les aspérités duquel la réalité s’effiloche. Repenser à l’absence des touristes, l’hiver, et les vieux blockhaus. A un porte-avions abandonné dans une rade. Confondre ses propres souvenirs et ceux du livre. Le premier dauphin était sur une grève, le ventre ouvert, et les goélands non loin, mais cela n’a rien à voir avec le livre. L’odeur de la zone qui s’étire le long des entrepôts et des silos, entre la ville et le port. Imaginer les étagères des bateaux en hivernage qui s’effondrent comme des dominos. Cela non plus n’a rien à voir avec le livre, dans lequel on trouve pourtant un saladier pour ranger les clefs et les « ex-voto plastiques » que l’on ramasse sur la grève, des soldats en plomb dissimulés dans les pots de gelée de coings et des singes qui pourraient voler les moissons, s’ils existaient.
« Une mère court entre les huit fauteuils vides du train, après son bébé, pour jouer. Des en-cas en voiture-bar. Quand on regarde à gauche, des collines, des collines, et furtivement le groupe du chef, de Capvrai et du jardinier. Un ou deux autres chasseurs. Les fleurs sur les mollets du chasseur, pas aussi brillantes que lorsque le tatouage a été fait, mais toujours bien imprimées. Ca semblait être ses bras plutôt que ses mollets. On ne peut pas voir les ongles nacrés du jardinier à cause de la vitesse. Et il est trop petit pour qu’on remarque que c’est un des chasseurs qui porte le jardinier comme une biche morte, et que son bras se confond avec les hibiscus, les narcisses et les pensées du jardinier. On lui a enlevé la veste pour voir si la balle était sortie derrière. Et la veste était restée sur le dos du chef depuis. Elle avait transpercé le poumon droit comme aiguille dans coton. Il y en a un qui porte vraiment une biche sur le dos, mais le train va trop vite pour dire lequel. Après c’est un noir de quinze secondes, dans le nuage du sol. Et tout ça passe inaperçu parce qu’il y a les buissons et les buissons encore. »
« Une écriture malhabile de l’autre côté de la frontière malmenée par la gîte. Il n’essayait pas de faire bien, mais il ne devait rien avoir à faire à bord, alors on craque le papier, on écrit avec n’importe quoi. Cette bande n’arrange rien. On n’en était plus aux nombreux moutons à ce moment. Alors cette mère que tu rencontres partout dans les souvenirs des uns et des autres, c’est juste un roulis, faut contre-viser, s’arranger pour qu’on ne tombe pas. T’utilises ou tu subis. Ça rentrera toujours dans le cadre, quoi qu’il arrive, parce qu’on peut se souvenir du verre de lait et des embrasures de porte à ne plus savoir qu’en faire. Les clous qui n’étaient pas bien rentrés dans le bois, musique de goèles dans l’oreille gauche seulement. Mais entre-temps, quand ils essayaient de vraiment mesure les tailles des vagues, ça blaguait. »
Quelques rides est le premier roman de Fabien Clouette. Le Bal des Ardents, second titre de l’auteur, paraîtra en septembre 2016, aux éditions de l’Ogre.
Quelques rides, Fabien Clouette. Editions de l’Ogre, 2015