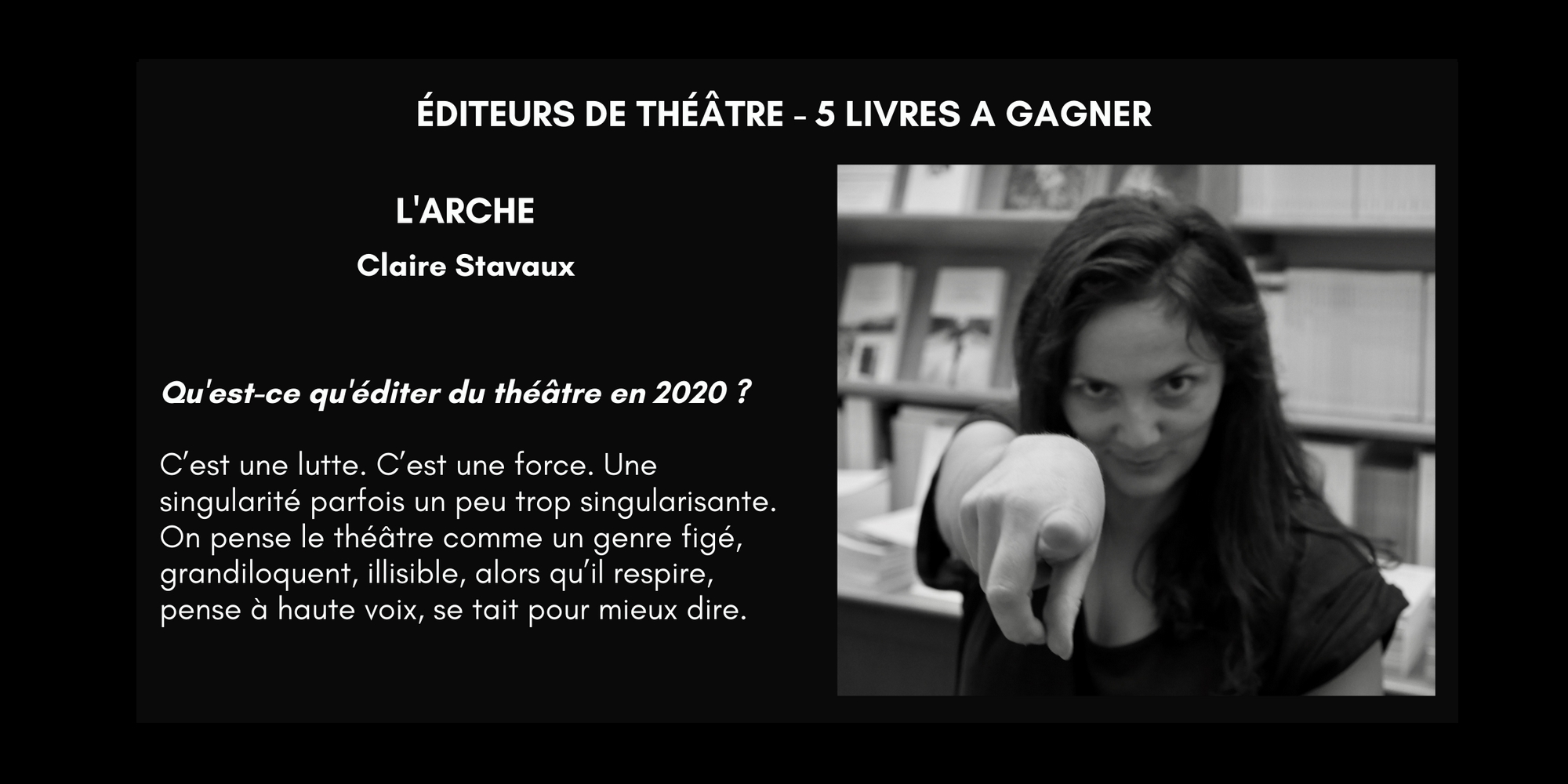Nous vous proposons de découvrir 3 maisons d’édition qui publient du théâtre ! Parce qu’il nous semble important de soutenir la création artistique, parce que l’édition théâtrale est un genre à part entière et qu’il raconte le monde et parce qu’Addict-Culture souhaite soutenir la création à travers tout ce qu’elle comporte !
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
LA MAISON D’ÉDITION
[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]
C’est en 1949 que Robert Voisin fonde la maison d’édition française L’Arche. Assez vite, la maison se dirige vers le théâtre en fondant la collection qui répertorie les pièces jouées au TNP de Jean Vilar, ainsi que la revue « Théâtre Populaire ». En sept décennies, elle ouvrira ses bras à de très grands noms tels que Bertold Brecht, Thomas Bernhard, Anton Tchekhov, Jon Foss, Jan Fabre, Sarah Kane, Lars Noren ou Kate Tempest.
Théâtre, essais, poésie, beaux livres, mémoires, DVD… ce n’est pas moins que 1800 pièces à son catalogue.
« Notre Arche se veut résolument indépendante et cosmopolite » confie Claire Stavaux, directrice de la Maison depuis 2017. Une femme passionnée à la sensibilité délicieusement subversive que nous remercions chaleureusement d’avoir accepté cet entretien.
L’ENTRETIEN
[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]

Tout d’abord comment allez-vous ?
(Long silence) Cette première question est un peu désarmante. Pourtant si naturelle et agréable. Mais il y a des jours où on n’aime pas entendre cette question, vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd’hui est un de ces fameux jours où on espère en voir le bout à peine les yeux ouverts. Où on a l’impression d’être déjà en retard.
J’ai fait un rêve matinal où j’arrivais à L’Arche et je ne trouvais plus la porte d’entrée. Je tournais dans la rue, passais et repassais devant la devanture, mais la porte était remplacée par un nuage épais, une autre fois un mur, puis j’entendais des voix tout autour qui disaient “L’Arche”. Puis je voyais des lettres s’effacer, le l, le r, et entendais seulement ache ache (Note de l’éditeur : en allemand Asche signifie cendre). Je me suis réveillée en pensant à Celan, à la poésie qui n’a plus de mots pour dire le monde. Un goût de cendres. Pas besoin d’un master en psychologie pour décrypter ces visions. L’Arche est un Phénix ! (grand rire)
Alors pour répondre à votre question : oui merci, je vais bien (sourire). Pour aller plus en profondeur, cette rentrée 2020 est synonyme de grandes incertitudes économiques mais paradoxalement d’une immense vitalité. D’une énergie un peu paradoxale. Ce qui m’anime ce sont les livres, les conversations autour des parutions, pas l’entre-soi germanopratin, puisqu’on entre dans la saison des vendanges éditoriales et des grands crus, mais les vraies disputes sur la nécessité de tel ou tel livre.
La journée qui arrive promet d’être dense, sous haute tension, avec des épreuves d’un livre à paraître en octobre à corriger (Chimerica), un autre à lancer en composition (Le père de l’enfant de la mère), notre diffuseur (Les Belles Lettres) à contacter pour revoir notre calendrier (report d’un titre à 2021 et divers décalages de calendrier), vérifier si l’imprimeur a bien livré les ouvrages de notre prochaine parution (Autobiographie du rouge) et s’ils sont entrés en stocks (de fait, ils ne l’étaient pas… grand bond sur la chaise, plusieurs appels entre le lieu de distribution et notre imprimeur pour retracer la livraison, recalcul des échéances, tremblement collectif à l’idée de rater l’office, et soulagement de pouvoir reporter d’une semaine), regarder les chiffres de vente de la veille (mon premier geste quand j’ouvre l’ordinateur le matin), quelques services de presse à faire, des libraires à contacter pour évoquer les livres tout juste parus mais aussi notre fonds, des questions juridiques, des virements, une relecture de traduction urgente à poursuivre de poèmes d’Audre Lorde que l’on édite en 2021 (pour laquelle j’ai besoin de calme et de concentration), des retours de traduction déjà relue à faire aux traducteurs (une des grandes joies de mon métier, c’est parachever le manuscrit achevé, un temps sans doute excessif mais crucial à mes yeux), divers mails, des décisions à prendre, les échange avec l’agence autour des productions en cours et les projets à venir, les idées de nos agentes pour promouvoir les textes (L’Arche est une Hydre à deux têtes : maison d’édition et agence théâtrale), tout ce qui est planifié et déjà en retard, et… les imprévus du jour qui viennent TOUT bouleverser. Des petits échanges qui jaillissent ça et là, des conversations que l’on a envie d’approfondir, mais pour lesquelles le temps manque.
Au fond j’apprécie beaucoup ce tourbillon, et l’équipe de L’Arche est vraiment unique. C’est une joie de travailler ensemble, même à distance. Nous développons de plus en plus le télétravail, pour des raisons d’efficacité aussi. Celui-ci est la clé d’un nouveau rapport au travail, à l’espace (professionnel et personnel) et à l’organisation plus optimale du temps dans une société de l’accélération permanente et des déplacements continus. En la matière, la France est très en retard et peu flexible.
Comment définiriez-vous la ligne éditoriale de L’Arche ?
Un mot, un seul : l’avant-garde. Elle l’a toujours été et le restera. Depuis sa création, en 1947, elle édite des auteur.e.s qui ne s’inscrivent pas dans une ligne à la mode. C’est en ce sens que L’Arche est résolument moderne, car elle ne se soucie pas d’être contemporaine, dans l’air du temps. J’édite les auteur.e.s qui (à mon sens) seront les classiques de demain, qui doivent l’être. Nos livres sont là pour faire bouger les lignes. Les normes, toutes les normes, littéraires, esthétiques, sociales. En tout cas les questionner et les déplacer. Il me semble capital de déplacer les horizons d’attente des lecteur.rice.s. C’est un geste politique. Ce ne sont pas les thématiques abordées dans les ouvrages qui le sont, mais la visée, le positionnement dans le champ. Pina Bausch dans ses créations de théâtre dansé, Jeff Koons ou Christo & Jeanne-Claude dont nous avons édité des beaux-livres sont aussi l’avant-garde. Sarah Kane l’était et le restera elle aussi. C’est un état d’esprit, un regard, qui transcende les époques, que nos auteur.e.s ont en partage.
Nous avons mis en ligne un nouveau site web : lui aussi, dans sa ligne, élégante et fluide, a quelque chose de l’avant-garde. On y entre par une photographie, cette entrée par un déplacement de regard, était importante à mes yeux. La photographie sera d’ailleurs présente dans une prochaine collection de poésie, que nous lancerons en 2021.
Quel auteur auriez-vous rêvé de publier ?
Mauvignier et Lagarce. Sans réfléchir.
Car ils détruisent l’impensé de la langue et de rapports humains pour mieux la redonner à lire et à comprendre. La violence du monde social et politique contemporain est dans leurs mots, à tâtons, avec une grande humilité, une grâce. Ce que j’appelle oubli est un de ces livres qui m’habitera toujours. Je ressens dans la bouche l’âpreté, la tendresse infinie de ce réquisitoire contre la brutalité de l’autorité, de l’instance qui contrôle et assène des coups, une violence autorisée, organisée, étatique.
Pour Lagarce c’est encore autre chose. Il aurait aimé être édité par L’Arche, il le raconte dans ses journaux, alors c’est même devenu un regret éditorial anachronique, car je n’étais même pas née. Sa puissance est indicible. Il est et restera toujours moderne. En avant sur la langue. La violence des rapports sociaux. L’infini mélancolie de l’être. Seul avec les autres. Seul avec sa langue.
 Qu’est-ce qu’éditer du théâtre en 2020 ?
Qu’est-ce qu’éditer du théâtre en 2020 ?
C’est une lutte. C’est une force. Une singularité parfois un peu trop singularisante. Notamment aux yeux des libraires, qui me répètent inlassablement, presque en chœur en lieux et moments différents : “le théâtre, ça ne se vend pas”. Je sais que j’arriverai à leur faire vendre du théâtre. Je dois en premier lieu les convaincre d’en lire, de l’importance du théâtre aujourd’hui, de la nécessité de cette littérature millénaire, qui a longtemps été la forme d’expression la plus répandue, supplantée par l’arrivée du roman et la trop grande place qu’il a prise, en France en tout cas, dans l’imaginaire des lecteur.e.s pour qui bien souvent, un livre = un roman, ou un essai. Tou.te.s les libraires qui ont passé le pas, nous le disent : “c’est fou, le théâtre. Ce n’est pas ce que j’imaginais. C’est vivant.” Le théâtre souffre de sa scolarisation. Les pièces imposées en lecture à l’école ou au collège font des dégâts inestimables. On pense le théâtre comme un genre figé, grandiloquent, illisible, alors qu’il respire, pense à haute voix, se tait pour mieux dire. C’est la possibilité d’être un personnage comme mille autre à la fois, c’est la démultiplication des identités, l’incarnation sensible en même temps. C’est la possibilité de pouvoir éprouver un texte dans son corps. C’est la possibilité de dire qu’il reste, toujours. C’est un formidable levier d’émancipation sociale. Un lac d’eaux calmes en apparence où sommeille des monstres endormis. On aime réveiller les monstres. Pour qu’ils ouvrent leurs immenses gueules. Le théâtre n’est pas une niche : c’est le lieu de la violence contenue, qui peut enfin lâcher ses chiens.
Pouvez-vous nous présenter les ouvrages qui font la rentrée de L’Arche ?
C’est une rentrée puissante, qui s’illustre par une extrême variété de formes. Une diversité au cœur de notre manière d’envisager la littérature. Nous proposons un récit choral, un roman en vers et une pièce de théâtre jeunesse illustrée.
Ce sont des livres qui font quelque chose. Et pas juste plaisir. Non que le plaisir soit étranger aux sentiments éprouvés. Au contraire ! Mais j’espère des lectures plus marquantes, qui laissent leur empreinte. Qu’on oublie pas de sitôt. On ne dira jamais de nos livres : oui c’était un moment chouette mais j’en garde pas grand chose.
Il faut garder quelque chose des livres. Nos 3 livres de la rentrée vous feront quelque chose.
Gratte-ciel est un récit à plusieurs voix, qui fait entrer en résonance des mémoires oubliées, des archives d’histoire, des récits familiaux, des voix adolescentes désireuses de vivre et prises dans des combats et des guerres de libération sans issue. Il dresse un chant libérateur qui vient “gratter” les nuages. On y voit comment l’architecture, celle faite par les hommes, est toujours un fantasme de domestication du réel, un enjeu de pouvoir. Toute architecture est pensée politiquement dans l’espace. Alors la beauté saisissante du texte est de faire entrer dans l’espace du récit des éléments d’architecture, qui viennent le modeler, y projeter des jeux de lumière et des points de vue. Ce sont les rouages mécaniques et les respirations organiques du texte. Un ami après sa lecture m’a écrit ce petit mot : “Je viens de lire Gratte-ciel qui m’a beaucoup touché. Les voix qui circulent entre le temps et les espaces, les guerres et leurs mémoires, sont portées par un rythme qui a les contours du désir. Il y a quelque chose de l’ordre de la recomposition, au sens fort, et ardente.” Merci A. pour ta lecture. Elle importe et dit bien plus qu’un article de presse.
L’Autobiographie du rouge est un volcan juste avant son éruption. Il gronde et fascine. LOVESLAVE. C’est une grande œuvre, un classique de la poésie moderne nord-américaine. Anne Carson est canadienne, traductrice, recompositrice. Elle entrelace les mythes, les registres de langue et entrechoque les époques. C’est un roman d’amour avant tout. Une ode à la monstruosité, bien plus belle et puissante que la bella figura. Un essai sur le pouvoir de la photographie. Une parodie d’une édition critique autour de Stésichore, poète grec du VIe siècle, avec interview finale en pied de nez anachronique. Une romance sublime et assumée. Une errance intime, un carnet de voyage pour apprendre à vivre. On peut l’appréhender de mille et une façons, c’est un renard indomptable. Et malicieux. Son traducteur, Vanasay Khamphommala (dont les textes théâtraux sont édités chez Théâtrales) a réalisé une œuvre magnifique. Il a appréhendé l’œuvre dans sa sensorialité, avec une attention inouïe au mot, à la virulence de sa douceur. Ce roman en vers entre dans la collection des “écrits pour la parole”, une collection de poésie libre et orale, créée à ma reprise de la maison, avec Les nouveaux anciens de Kate Tempest comme guide. Ce texte a suscité en moi un torrent d’émois. Il faut le lire et laisser s’ouvrir les vannes.
Amande-Amandine est pour moi une rêverie au royaume de l’hypocondrie. Dans cette pièce écrite pour le jeune public (mais qui ne lui est pas exclusivement destinée), une petite fille s’invente toutes sortes de maux pour se rendre chaque jour à l’hôpital, au chevet de l’Homme-Maladie. Une fois arrivée dans sa chambre, elle cherche par tous les moyens à attirer l’attention des Mains-Docteurs : maladie de l’araignée, maladie de la peur jaune, maladie de la bougeotte grimpante…, tout y passe. Elle ne supporte pas de ne pas être la malade. Ce texte est d’une grâce et d’une poésie qu’il serait dommage d’enfermer dans une phrase. Sa langue fourmille de trouvailles, de petits éclats de rire. Il est acrobatique, ses phrases n’arrêtent pas de faire la culbute, sauter de haut en bas. Il donne un peu le vertige, comme quand on s’est trop longtemps balancé sur une balançoire. Une petite expérience de la limite, qui est aussi une réconciliation avec la vie et ses tempêtes. Il raconte la résilience, l’acceptation de la peur, de la maladie, le courage des enfants et leur manière de déplacer le regard. Toujours en se balançant. En oscillant. Les évènements sanitaires de l’année 2020 le font résonner étrangement. Mais dans cette pièce, la maladie est aussi une parabole.
Et ces trois textes sont bien plus. Leur pouvoir, chacun à sa manière, dans sa langue, est au-delà des mots. Il faut les vivre. Je pourrai en parler sans fin, mais rien ne vaudra l’expérience de votre lecture.
 Á la lecture d’un manuscrit, comment se manifeste physiquement, chez vous, “l’évidence” ?
Á la lecture d’un manuscrit, comment se manifeste physiquement, chez vous, “l’évidence” ?
Quand je lis quelques lignes et qu’elles brisent quelque chose en moi. C’est très profond et impalpable, pourtant la sensation est vive. L’évidence n’arrive pas à la dernière page, elle est là d’emblée ou pas. Il y a des cas malheureux, j’ai envie d’aimer (car j’apprécie les personnes qui ont écrit les textes ou ceux et celles qui me l’ont recommandé) et non, on ne peut pas forcer l’amour, ça ne provoque rien. Ou si, de la déception. Je suis très difficile, mais c’est important.
Quand je vais au théâtre, c’est la même chose. Il y a de grands spectacles qui resteront toujours dans mon imaginaire théâtral, ma bibliothèque vivante : MayB par Maguy Marin, son hommage à Beckett par exemple. J’en parle, car c’est le même sentiment d’évidence devant la beauté : la fragilité, l’absurdité de la condition humaine, l’absolu impératif de dire cela, d’hurler le désespoir de vivre, de faire face, laisser une trace, qui ne soit pas que poussière ou craie (les interprètes sont revêtus de tissus de bure, avec comme de la craie ou de la poussière, ou du ciment). S’enlacer, vouloir se blesser. Tendre une main, laisser choir le corps. La solitude au milieu d’une grande fête. L’exil. C’est le même ressenti éprouvé à la lecture des Nouveaux anciens de Kate Tempest. Comme décrire l’évidence du sentiment du beau et du nécessaire. Pas au sens de l’utile, contraire à l’art, non, le nécessaire. Une autre définition de l’art finalement.
Combien de manuscrits recevez-vous par an environ ?
Beaucoup trop. Plusieurs centaines. L’armoire des manuscrits envoyés me fait toujours peur quand je passe devant elle, avec ses étagères trop lourdes. C’est la mauvaise conscience aussi du retard de lecture. Impossible de décrire ses choix, un mélange d’intuition, de nécessité, d’amour des mots et de la pensée. On décèle dès quelques pages, vous allez hurler… quelques lignes parfois, si c’est dans la ligne de la maison ou pas. Si on est porté ou bien si on reste à la lisière.
Qu’est-ce qui a éveillé votre goût pour la littérature ?
Ma grand-mère m’a lu et fait apprendre des poésies, 3 vers par jour, pendant des années dès le plus jeune âge. Ensemble on a appris des milliers de vers. J’en ai oublié la plupart. On les récitait partout, dans la voiture quand elle m’accompagnait à l’école puis au collège, quand on se promenait. Parfois on lançait telle ou telle citation, de manière incompréhensible pour notre entourage, comme une langue secrète. On en riait comme des folles, c’était ça la littérature, mon premier contact avec elle, de la beauté solennelle énoncée, qui devenait très quotidienne et détournée. Qui faisait partie de nous. Cette mélodie des vers, si familière. “Bon appétit messieurs” de Ruy Blas ou bien je lui lançais “ma mère Jézabel devant moi s’est montrée”, quand elle faisait irruption dans sa chemise de nuit, les cheveux en bataille. Les vers de Racine sont les plus beaux. Lyriques malgré eux. Plus tard, j’ai trouvé cette poésie trop classique, trop tatatatatata. J’ai découvert la poésie de l’adolescence, celle où on fait sauter les verrous. C’est à Berlin, et dans la poésie allemande contemporaine, que j’ai découvert une forme plus politique, directement orale, vitale. Lire Heiner Müller a été un accélérateur de particules. Une littérature aux prises avec des enjeux économiques, sociaux et politiques. Une poésie qui habite le monde.
Si vous n’étiez pas éditeur quel métier auriez-vous pu exercer ?
Je ne me vois pas faire autre chose. J’étais traductrice avant de rencontrer L’Arche, mais dévorée par les textes que je traduisais, incapable de mettre un point final et trop isolée. D’ailleurs l’auteur que je traduisais (Clemens Setz) m’a dit que j’avais bien raison d’arrêter ce métier qui confine à la folie. J’en ai touché les lisières en traduisant Le Syndrome indigo. Les derniers jours avant la remise du manuscrit à Jacqueline Chambon, qui m’avait déjà accordé plusieurs délais, je n’ai plus dormi pendant 3 jours et 3 nuits, me contentant de micro siestes d’épuisement à la table, la tête tombée en avant, où je rêvais d’animaux qui entraient dans mon appartement, de personnages étranges et inquiétants qui faisait écho à l’atmosphère des livres de Setz. Puis je me redressais comme un pantin dont on a tourné la vis et je reprenais la phrase où je l’avais quittée. Je ne mangeais plus car la digestion était devenue trop éprouvante pour le corps et je redoutais de m’endormir. Le corps était devenu léger, c’était grisant, je vivais uniquement dans l’épaisseur des mots. Je le prononçais à voix haute pour en éprouver la plasticité, la justesse. Mon entourage était un peu inquiet. Le lendemain matin de la remise, je donnais mon premier cours à la fac à Paris 3 en études théâtrales, j’étais éreintée, vidée et remplie de littérature à la fois. Je me souviens de ces deux heures interminables, où j’ai monologué sur Pina Bausch, le théâtre. Puis je leur ai fait écrire des fiches. Le temps, celui de la vie du dehors, était long. La semaine suivante, les étudiant.e.s étaient tou.te.s là et étaient même un peu plus. J’ai noué des beaux liens avec certain.e.s, dont j’ai suivi le parcours.
Si je n’exerçais pas ce métier, je vivrais ailleurs, c’est la seule certitude.
D’ailleurs, je ne pourrais pas être éditrice pour une autre maison, d’autres auteur.e.s. J’ai choisi ce métier parce que L’Arche.
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
LE JEU CONCOURS
[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]
[one_half]
Pour tenter votre chance de gagner un exemplaire de ces 3 ouvrages au choix rendez-vous sur nos réseaux sociaux :
[button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/addictculture/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/addictculture/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button]
[/one_half][one_half_last]
Retrouvez L’Arche éditeur sur leurs réseaux sociaux :
[button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/larche.editeur/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/larche_editeur/?hl=fr » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button] [button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/larcheediteur » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]
[/one_half_last]