[mks_dropcap style= »letter » size= »52″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]h ! Niroz ! C’est toi ! Entre !
J’ai lu ton livre une semaine avant les attentats qui ont touché Paris le 13 novembre dernier. À cette lecture, je t’imaginais comme un homme courageux faisant le choix de ne pas quitter son pays en guerre – la Syrie – pour continuer à écrire, à rendre compte de la vie et de la mort. Tu y racontes au début un dialogue schizophrène entre toi et toi-même :
– Alors, quoi ? M’a demandé mon autre moi-même.
Tu ne veux pas faire comme tout le monde, sortir une valise dans laquelle tu rangeras les documents et les quelques objets dont tu auras besoin pour t’expatrier ? Tu ne veux pas faire comme tous ceux qui ont quitté les quartiers touchés par les bombardements, tous ces quartiers changés en décombres ?
Tu lui répondras quelques lignes plus tard :
Comment pourrais-je laisser Naguib Mahfouz ? ai-je poursuivi. Comment pourrais-je laisser le roi Lear seul face à son destin ? Comment ne pas inciter Hamlet à mettre fin à ses tergiversations et à sa philosophie à laquelle je n’ai jamais adhéré ? Comment pourrais-je interrompre le dialogue avec Raskolnikov, au sujet du châtiment divin et du jugement profane des hommes. Et qui défendrait ces statuettes de Pouchkine et de Gogol, ces photos de Tchékhov et Hemingway ? Qui protégerait de la destruction les vinyles de Beethoven, de Tchaïkovski et Rachmaninov ? Dis-le-moi.
Tu nous dis pourquoi partir serait synonyme d’abandonner ce que tu es et qui te constitue, à savoir ta bibliothèque, ta discothèque, bref, ta culture. Tu ne cesseras alors de parler non seulement de littérature et d’art, de ton impossibilité à faire autre chose qu’écrire, mais surtout de ton combat quasi quotidien, malgré les bombardements, les barrages militaires, les balles perdues, à aller boire un café en terrasse.
Avant d’arriver au café, tout près du trottoir, je tombe nez à nez avec un ami. Il me demande où je vais.
– Au café.
Il me saisit le haut du bras :
– Fais demi-tour. Le café et les boutiques alentour ont dû tirer leurs rideaux de fer. On ignore la raison précise de cette injonction, une information a filtré du barrage comme quoi une voiture piégée se trouverait à proximité. Tu vois, il vaut mieux rentrer à la maison.
– Non et non, je ne veux pas retourner chez moi, dis-je en colère. Qu’est-ce que je vais pouvoir y faire ? Le courant est coupé, ce qui signifie absence de télévision et d’Internet.
– Où est-ce que tu veux aller ? M’interrompt mon ami.
– N’importe où, même s’il me faut flâner au hasard des rues.
– Quoi, flâner dans les rues ? Toi qui ne supportes pas la vue d’un barrage, tu es prêt à en voir par dizaines ?
– Suis-moi. Nous passerons par les rues où il n’y en a pas.
Ces mots résonnent maintenant de façon étrange. Ma mère, inquiète, me demande de moins sortir. Mais qui suis-je si je ne bois plus un café le matin et une bière le soir avec mes amis du quartier ? Pourquoi devrais-je me priver d’embrasser la barmaid, de me faire lire mon horoscope par le gentil junkie, de refaire le monde et d’élargir le cercle de mes bras pour qu’il puisse contenir de plus en plus de gens que j’aime ? Qui suis-je si je n’assiste plus à des concerts ou des pièces de théâtre ? Des amis proches ont perdu des amis proches. Et je sens monter le ridicule de la situation. Et je t’imagine rire doucement de notre bravoure et de notre « résistance » à poursuivre notre quotidien d’alcooliques et de bons vivants comme si de rien n’était.
Je sais la différence entre mon trajet qui me mène au café et le tien. Tu es entré dans ma bibliothèque. Nous faisons partie de la grande famille des lecteurs et admirateurs des lettres, des amoureux de la musique. Ton pays est en guerre et le mien en connaît des répliques, secousses et effets secondaires.
Je te fais un café ?
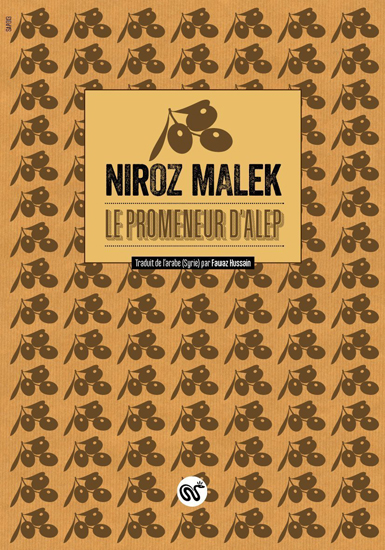
Tu connais peut-être ce joueur d’oud, Khaled AlJaramani, syrien lui aussi, qui joue depuis plus de dix ans avec Serge Teyssot-Gay dans un groupe qu’ils appellent Interzone. L’un et l’autre dialoguent avec leurs instruments, comme nous pourrions dialoguer avec nos plumes.
À demain.
Le Promeneur d’Alep, de Niroz Malek, traduit de l’arabe (Syrie) par Fawaz Hussain, disponible aux Editions Le Serpent à Plumes.


















