Je me suis souvent demandé pourquoi de nombreux textes classiques de la littérature portugaise étaient si peu connus en France ; pourquoi un chef d’œuvre comme Les Maia de José-Maria Eça de Queiroz n’était pas autant étudié que d’autres classiques étrangers ? À la place d’une réponse c’est une question du même type qui se pose après la lecture de Humus, de Raul Brandão, publié en 1917 et dont, je l’avoue humblement, je n’avais jamais entendu parler… Heureusement les éditions Chandeigne, qui font un remarquable travail pour faire entendre les voix des cultures lusophones en France, nous rendent aujourd’hui ce texte accessible dans une superbe édition dont la couverture verte et noire, de terre et de végétaux mêlés, pourrait presque déjà nous laisser des traces sur les mains….
La lecture de Humus, elle, c’est certain, laissera au lecteur qui tentera cette plongée vertigineuse dans les angoisses métaphysiques du narrateur, une marque absolument indélébile. Dès l’ouverture de Humus, nous voici placés dans le temps, au cœur du temps ; le temps d’un journal intime, d’une chronique de village, du long monologue intérieur du narrateur ponctué de dialogues hypothétiques, oniriques ou trop réels avec ceux dont il partage l’humaine condition. Nous sommes au centre d’un village, un village pauvre où les édifices se fossilisent autant que les habitants. La peau des femmes, une petite dizaine de vieilles attablées pour jouer au piquet, possède la texture de la pierre et leurs langues perfides sont lourdes, lourdes surtout des mots qu’elles n’ont pas prononcés.
« « Nous avons passé notre vie à retenir en nous un autre être, une autre chose, une autre stupeur. Il y avait un fil invisible que nul n’osait franchir. Un ordre que nul n’osait rompre. »
─ Raul Brandão, Humus
Le narrateur qui les observe, qui s’observe aussi, y lit le miroir du monde, le miroir de nos existences. De toute petites vies, figées dans l’habitude, les règles, les conventions et la foi, emmurées dans un quotidien qui prend toute la place, qui tient finalement lieu de vie, là où la vie n’est plus rien, n’a peut-être jamais rien été. C’est en effet le point de départ de ce long poème métaphysique que cette prise de conscience de la vanité de nos existences, de l’impossibilité de donner sens à nos vies. Est-ce cela vivre ? le narrateur bute inlassablement contre cette lancinante question. Est-ce remplir de quotidien notre quotidien, ad nauseam et ce jusqu’à la mort, cette mort absurde qui lorsqu’elle arrive projette rétrospectivement son ombre délétère sur le contenu de nos vies ?
« Oui, à certains moments, tous clament : « Je n’ai pas vécu ! » En de tels moments, nous nous heurtons à une haute et inquiétante figure. La vie n’est donc que cela ? Je n’arrive pas à me débarrasser de mes petitesses, de mes ridicules, de toutes ces idioties, ni de l’être écorché vif qui s’étend d’un pôle à l’autre. Il me faut supporter tout à la fois et cette idée et cette posture ridicule. Il me faut être grotesque, devant la vie et devant la mort ; »
Raul Brandão, Humus
Humus est le cri lancé
par Raul Brandáo,
un appel profond et hypnotique
Si la date de rédaction d’Humus et sa thématique paraissent préfigurer les littératures de l’absurde et les plus fortes interrogations métaphysiques du XXème siècle qui s’ouvre et que Le livre de l’intranquillité de Pessoa dira, pour la littérature portugaise, avec puissance, il demeure cependant un texte totalement atypique qui convie autant le tragique lyrique que la chronique sociale. Les destins des femmes du village s’y entrecroisent comme les racines des arbres sous terre, puis s’effacent derrière la voix torturée du narrateur. On les entraperçoit comme le permettrait une fenêtre ou une porte entrebâillée, lessivant des parquets, sauvant des enfants ou des patronnes injustes, décidant toujours par rapport à la norme et souvent contre elles-mêmes. Car non seulement la vie n’est peut-être que cela, mais c’est de surcroît, lorsque la foi faiblit ou disparaît, la faillite de la promesse d’une autre vie dans l’autre monde qui fait érode la vie, comme s’effritent les pierres rongées par l’eau ou le vent. L’absurde serait alors double ? Une absurdité d’ici-bas doublée d’une absence totale d’espoir en un au-delà ? Pourquoi dès lors faudrait-il autant souffrir, pleurer, trimer si cette souffrance ne se troque contre rien. Le doute spirituel qui assaille le narrateur le glace et libère une force et une rage à vivre, à détruire, voire à tuer. Car si rien ne nous oblige, si l’absurde n’a même pas le rempart de la foi, si cette idée de Dieu qui était peut-être la pire idée pour l’homme n’est qu’un mot, alors le vertige est total. Alors Dona Leocádia n’avait pas besoin de nourrir en son sein la fille qui lui ravira son fils ; alors Joana n’avait pas besoin de se sacrifier pour sa fille ; alors notre narrateur peut avouer qu’il a souhaité la mort de celle qu’il a aussi tellement aimée. Soudain, cette liberté qui surgit est trop grande, trop effrayante.
Nos existences, ruines de nous-mêmes, se déroulent sur des théâtres sur lesquels nous seront rapidement remplacés à l’identique par ceux qui nous suivent. Partout la vie est en contact avec la mort jusqu’à avoir de la peine à s’en distinguer. Le texte ressasse cette obsession de la mort de manière cyclique à l’image de la grande roue de la vie qui tourne inexorablement et qui livre le narrateur à une lutte acharnée contre lui-même. Le texte est sombre, sombre à l’extrême mais aussi vraiment magnifique. Raul Brandão, servi par la belle traduction de Françoise Laye, ensorcelle par des images somptueuses, des métaphores de lumière. Car si le noir domine largement sa prose, c’est un noir absolu, un de ces noirs qui comme chez Soulages fait jaillir la lumière, avec de l’or partout, quasiment à chaque page, un monde « doré de débris et de douleur».
La partie de tric-trac du monde et des petites vieilles est sans fin et sans but. Dans le grand vide laissé par l’effondrement du sens, on n’entend plus que le cri du monde. Le cri des vivants autant que celui des morts, le cri de ces générations qui se succèdent sans qu’il soit possible de les distinguer, les uns enterrés vivants par les pelletées de cendre projetées par les autres. Humus est le cri lancé par Raul Brandáo, un appel profond et hypnotique qui dit avec beauté notre difficulté d’être au monde, celui d’un homme qui s’en allait « vers la tombe avec, dans la bouche, un goût de banalité fade et de poussière. »
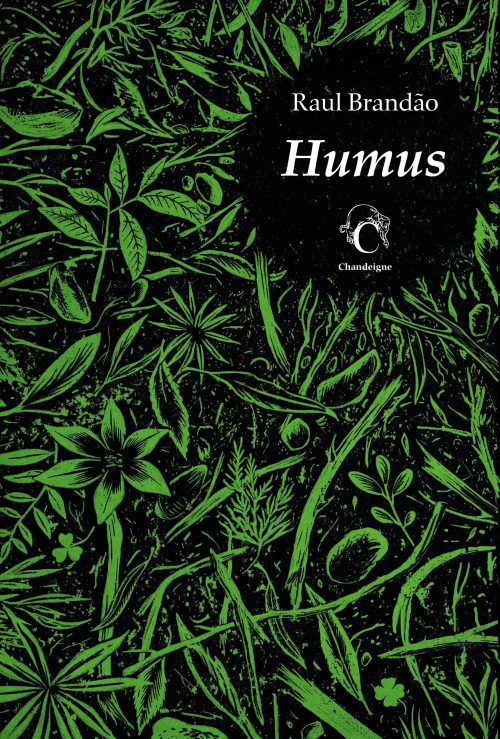
Humus de Raul Brandão
Traduit par Françoise Laye
Chandeigne, Mars 2023


















