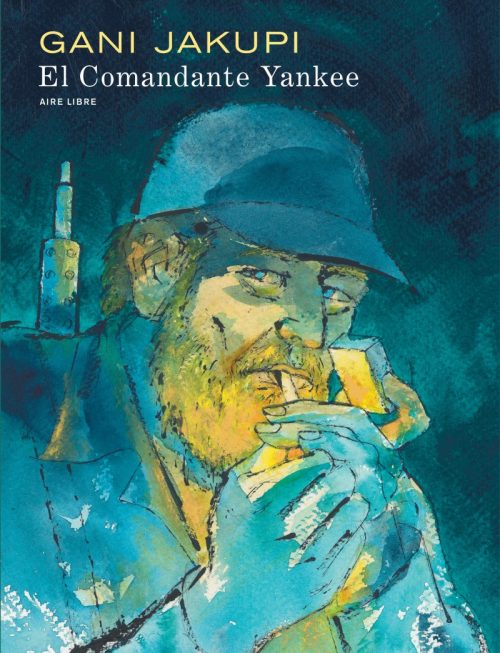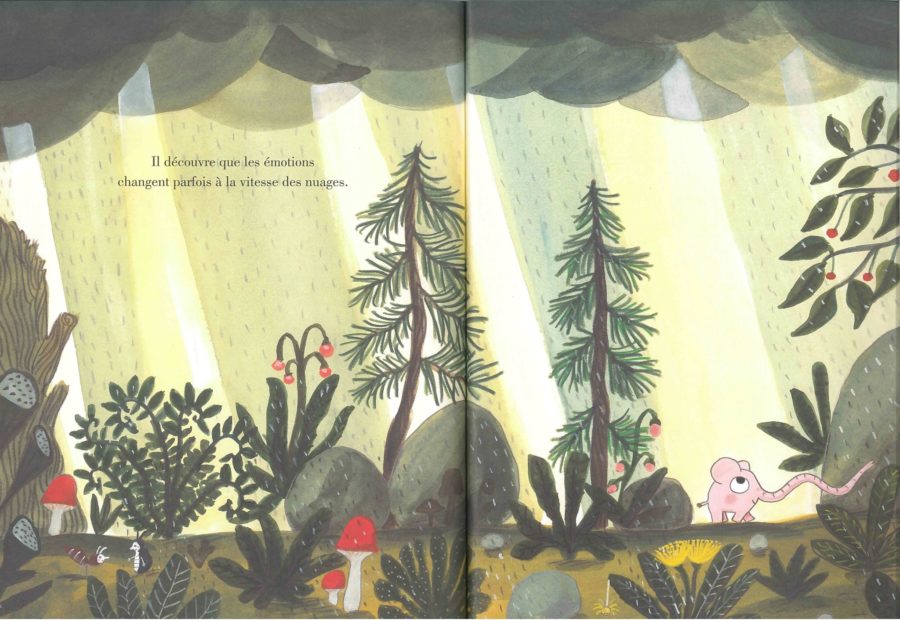Toutes les semaines jusqu’au 10 juillet, retrouvez une sélection hebdomadaire de conseils de lecture pour vous accompagner cet été.
Les choix de Julia
Les Martyrs et les Saints de Larry Fondation
Paru aux Editions Tusitala, septembre 2018

Le premier mérite de Larry Fondation est de rendre visibles ceux que la société ne regarde plus : les pauvres, les sans-abris, parmi lesquels beaucoup de vétérans des guerres du Vietnam, d’Irak, d’Afghanistan, abandonnés à leur sort et à leurs traumatismes.
Tout comme son précédent livre (Effets indésirables, publié également chez Tusitala), ce recueil est composé de plusieurs histoires courtes, âpres, sortes d’instantanés de vies ordinaires, avec toujours pour toile de fond Los Angeles, ville où la plus sordide des violences devient banale.
Los Angeles, ses rues malfamées, ses chambres de motel miteuses, ses bars crasseux, ses strip clubs, d’où surgissent des histoires où le corps et ses écoulements sont omniprésents : sueur, crasse, sang, urine, sperme sont autant d’humeurs faisant s’incarner un peu plus les sentiments de personnages qui, s’ils sont souvent désespérés, sont tous à la quête d’un bonheur, même fugace ou artificiel.
Quand on lit Larry Fondation, on pense immédiatement à William T. Vollmann et à son Pourquoi êtes-vous pauvres ? (traduit de l’anglais par Claro et édité par Actes Sud en 2008) : il fait partie de ces auteurs qui écrivent sur la pauvreté, la « sous-normalité miséreuse », selon Vollmann.
Puisant son matériau dans une expérience de plus de trente années de médiateur de quartier, son écriture est incisive, nerveuse, auréolée d’humour noir, et réussit le tour de force de faire naître de la plus cynique, la plus glauque, la plus absurde des situations, la beauté.
« Nous avons grimpé une courte volée de marches pour rejoindre sa chambre.
Nous avions bu toute la soirée sur un pas de porte. Nous avions siroté (avec classe) du whisky caché dans un sac en papier.
Tout était pâle : la chambre, sa peau, la lumière.
Il n’y avait pas de marron, seulement du beige ; pas de rouge, seulement du rose ; pas de noir, seulement du gris.
Elle a gardé son chemisier pendant que nous faisions l’amour.
Peu après, j’ai remonté son haut pour voir ses seins. Le chemisier est resté autour de ses épaules.
Je suis parti bien avant l’aube, à moins que ce ne soit elle. Je ne m’en souviens plus. Je me suis peut-être réveillé dans son appartement ; peut-être qu’elle s’est réveillée dans le mien. Je n’en sais rien.
J’étais tout seul.
Je me sentais tellement bien.
Lorsqu’on regarde une étoile, on voit des choses qui se sont passées il y a un million d’années, voire plus.
C’est pareil pour nos vies. On comprend ce qui nous est arrivé (nos actions, leurs conséquences) longtemps après, très longtemps après.
Dans une rue, quelque part, nous marchons vers un café ; nous traînons en ville, nous jouons dans un jardin public, ça n’a aucune importance ; c’est toujours la même chose ; c’est nous trois, ensemble, tous les trois, notre triade, notre trinité. Elle est tout le temps là et moi aussi, ainsi que cet enfant qui est le nôtre. »
Au fil de ses livres, Larry Fondation retranscrit, avec toute la brutalité et l’étrangeté qui la caractérise, la langue de ceux dont la voix, inaudible, ne compte plus, la langue des fantômes cabossés qui peuplent L.A. Et c’est sans doute pour cela qu’elle doit être lue.
Le témoin solitaire de William Boyle – traduit de l’américain par Simon Baril
Paru aux Editions Gallmeister
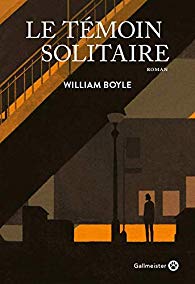
Amy a enterré son passé de fête et d’alcool pour mener une vie quasi-monacale en consacrant tout son temps à l’Eglise et aux personnes âgées.
Elle est la reine des mauvais choix : fascinée par un inconnu qui suscite l’inquiétude des vieilles dames de sa paroisse, Amy décide de le suivre et assiste à son assassinat en pleine rue. Sa curiosité aussi dévorante qu’inexplicable la pousse à ne pas prévenir la police et, contre tout bon sens, à s’emparer de l’arme du crime et à filer le meurtrier.
La trajectoire qu’elle décide ainsi de suivre la précipite, lentement mais sûrement, dans un univers de violence auquel il lui sera difficile d’échapper.
Ecrire Brooklyn
Avec Le témoin solitaire, traduit par Simon Baril et publié chez Gallmeister, William Boyle s’emploie à une exploration minutieuse et sensible de Brooklyn au travers des vies modestes qui peuplent ses rues, ses bars. Son écriture suit précisément le regard d’Amy, ses trajets, l’observation silencieuse de ce qui l’entoure et le dérèglement progressif de son quotidien.
« Sans cesser de jeter des coups d’œil derrière son dos, elle court jusqu’au quai. La station est vide, triste. On n’est pas sous terre, mais ce n’est pas non plus le métro aérien, c’est un de ces arrêts de la ligne N qui sont au niveau du sol. Elle ne sait pas comment on appelle ça. Un arrêt à ciel ouvert, peut-être. Des murs en béton. Des colonnes bleues. Des graffitis. Des voies qui dégagent une impression de vide intense. Des lignes jaunes pour vous rappeler de ne pas vous tenir trop près. Des détritus débordant des poubelles. Du bruit qui produit le même effet que le silence. Levant les yeux, Amy voit des fenêtres pourvues de stores abîmés et de barrières de sécurité pour enfants. Elle voit des cordes à linge et des fils téléphoniques. Il lui semble que, très récemment, elle a entendu parler d’un homme qui s’est pendu ici. Elle aimerait savoir où exactement. A quelle poutre ? Elle ne s’assoit pas, elle attend son métro debout. Quand il arrive, c’est un soulagement : elle va pouvoir être l’ancienne Amy là où l’ancienne Amy existait autrefois, même si le trajet est long. »
Se contenter du réel
Chaque livre de William Boyle est une déclaration d’amour au quartier qui l’a vu grandir, entre Gravesend et Bensonhurst. Ici, il opère un retour réussi au roman noir, en taillant la part belle à la complexité des parcours et des sentiments des protagonistes. Ces derniers sont évoqués avec une sensibilité, une mélancolie et une intelligence dénuées de tout cynisme dont on ne peut que se réjouir et qui permettent d’affirmer que William Boyle est l’architecte d’une œuvre à suivre attentivement.
Les choix de Catherine
Le Dernier thriller norvégien de Luc Chomarat,
Paru à La Manufacture de livres
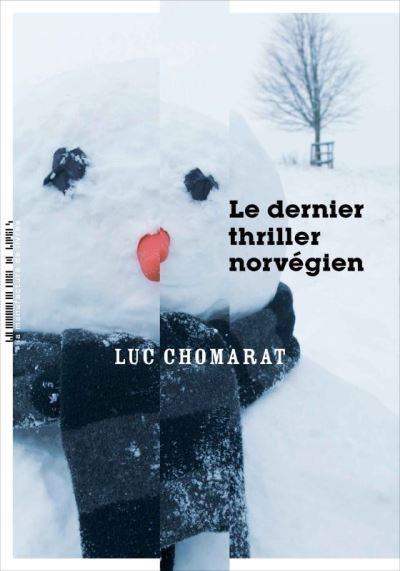
Jo Nesbo, Henning Mankell, Ake Edwardson, Arnaldur Indridason, gare à vous! Voici venir une concurrence déloyale, celle de Luc Chomarat. Déloyale parce que l’homme n’est ni suédois, ni danois, ni norvégien, ni finlandais, et encore moins islandais. C’est sans crier gare que Luc Chomarat, auteur français, fait irruption dans le petit monde des auteurs scandinaves. Comme quoi, les catégories, à quoi est-ce que ça tient ? Il n’y a pas bien longtemps, l’auteur nous avait déjà piégé et séduit avec son Petit chef d’œuvre de littérature . Il récidive aujourd’hui, à la veille des vacances, avec un roman venu du froid, étourdissant, drôle, joueur et formidablement intelligent.
Nous sommes à Copenhague, dans un hôtel de luxe envahi par un aréopage d’éditeurs français venus là pour essayer d’emporter le morceau : les droits du dernier thriller norvégien signé Grundozwkzson, star du moment, dont le titre est… Le dernier thriller norvégien. Parmi eux, l’éditeur Delafeuille (dont le prénom n’est par Arnaldur, ce serait trop facile), et d’autres illustres représentants de l’édition parisienne. Et puis un certain Sherlock Holmes. Pendant ce temps-là sévit un tueur en série judicieusement surnommé l’Esquimau, qui découpe consciencieusement ses victimes en morceaux. Tout dérape quand Delafeuille reçoit l’édition danoise du fameux best-seller. Ne dirait-on pas que le livre raconte très exactement ce qui est en train de se passer à l’hôtel de Copenhague, découpage de l’agent de Grundozwkzon compris ? Si, on dirait bien… Commence alors une sorte de slalom géant qui mêle présent et futur, fiction et fiction dans la fiction, où Delafeuille et Holmes vont devoir essayer de retrouver sinon la raison, du moins un dénouement tout aussi surprenant que le plus haletant des « twists » chers aux lecteurs de thrillers.
Le dernier thriller norvégien se déguste comme un millefeuille: on commence par le sucre glace, puis on déguste une par une toutes les couches d’un feuilletage tour à tour léger et profond : amour de la littérature, culture sans cuistrerie, tendresse parfois cruelle pour les auteurs, parodie grand-guignolesque des excès du thriller (de la violence à l’érotisme), le tout lié par une crème pâtissière absolument imparable : un humour ravageur, qui vous garantira, cher lecteur, une lecture absolument irrésistible.
Les Sept morts d’Evelyn Hardcastle de Stuart Turton,
traduit par Fabrice Pointeau, Paru chez Sonatine éditions
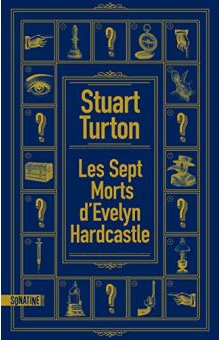
Pour son premier roman, l’Anglais Stuart Turton nous offre un bien singulier tour de force. Dans une interview accordée à la Los Angeles Public Library, il avoue son obsession : depuis l’âge de 8 ans, il rêvait d’écrire un roman à la Agatha Christie… Mais il voulait y ajouter sa touche personnelle, unique. C’est donc à l’âge de 33 ans que lui est venue une idée qui lui est apparue suffisamment originale pour servir de base à son premier roman. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’effectivement, son idée est singulière !
Nous sommes donc, comme dans un roman d’Agatha Christie, au beau milieu d’une réunion organisée dans une sinistre demeure au milieu des bois. Pour aider le lecteur, l’éditeur a choisi de reproduire le plan du manoir et la liste des protagonistes. On va le voir, la précaution n’est pas superflue. Ce jour-là, le narrateur arrive à Blackheath House, la demeure de la famille Hardcastle. Tout de suite, le caractère étrange de l’affaire nous saute à la gorge : le narrateur semble ne pas savoir où il se trouve, ni qui il est et ce qu’il est venu faire là. Il est à terre, sous la pluie, ses doigts s’enfoncent dans la terre. Il parvient à se relever, s’efforce de reprendre ses esprits. Peine perdue… Au loin, une femme appelle à l’aide. Anna, s’écrie le narrateur. Mais qui est Anna ? Et surtout, qui est le narrateur? Bientôt, un homme en guenilles surgit et remet une boussole à notre héros inconnu : à l’est, il faut aller à l’est. Voilà le manoir, grande bâtisse georgienne en briques rouges : Blackheath. Et là, un homme l’accueille et le conduit à sa chambre, sans prêter attention à ses élucubrations sur la mystérieuse Anna. C’est le premier jour.
Tout au long du roman, les journées vont se succéder et se ressembler. Les invités sont réunis à Blackheath pour fêter le retour d’Evelyn, qui vivait jusqu’alors à Paris. Se ressembler, certes, à une exception près, et elle est de taille. Car chaque journée, notre héros va la vivre dans la peau d’un personnage différent. Et chaque jour qui passe est marqué par un ultimatum. A 23 heures, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Chaque jour les événements vont se succéder, vus sous un angle différent, par une conscience différente, ponctués par de maléfiques présences. S’enfuir? Impossible.
Tant que l’énigme ne sera pas résolue, le héros est prisonnier, nulle voiture ne l’emmènera loin de ce lieu maudit… Au fil du temps, le narrateur commence tout juste à se remémorer qui il est, en proie à des bouffées de mémoire vite estompées. L’effet sur le lecteur est saisissant : non seulement il faut savoir qui va assassiner Evelyn, mais encore, et surtout, il faut élucider le mystère de l’identité du narrateur.
Les événements s’entrecroisent, s’interprètent, les personnages se parlent, se mentent, se cachent, complotent, leurs personnalités se recouvrent, se dissimulent en des strates brumeuses et impénétrables. Et nous, pauvres lecteurs, sommes pris aux pièges diaboliques tendus par l’auteur, sautons à pieds joints dans les chausse-trappes, nous perdons dans le labyrinthe que Stuart Turton a minutieusement construit à notre intention, et nous laissons manipuler, entre frayeur et délices, par cette histoire incroyable qui, malgré sa complexité, nous restitue notre âme d’enfant et notre capacité d’étonnement. Oui, décidément, ce roman est un bien étrange tour de force.
Le choix de Dominique
El Comandante Yankee de Gani Jakupi
paru chez Dupuis (collection Aire Libre)
Plus de 200 pages illustrées s’offrent à vous avec El comandante yankee, qui raconte l’histoire secrète de la révolution cubaine. Ce roman graphique n’est pas un documentaire, en ce sens que des événements ont été synthétisés pour faciliter la lecture, mais il constitue néanmoins une formidable plongée dans un conflit aux bouleversements politiques majeurs. Pour cela, l’auteur a mené un travail de fourmi, à partir de nombreux témoignages, de multiples sources et documents inédits. Il a également trouvé, en la personne de William Alexander Morgan, le seul comandante non cubain avec le célèbre Che Gevara, le personnage éponyme qui sera le fil rouge de son récit.
Ancien combattant pour la cause de Fidel Castro, Morgan s’est d’abord battu pour les valeurs démocratiques défendues par le Segundo Frente, cette guérilla qui opéra dans la Sierra de l’Escambray, sur les hauteurs de Banao. L’ouvrage débute en décembre 1957, alors que l’Américain fraîchement débarqué à La Havane, a reniflé la bagarre et souhaiter y foncer tête la première. Il est finalement recruté par Eloy Gutiérrez Menoyo, qui n’est autre que le frère de Carlos Menoyo, abattu quelques mois plus tôt lors d’un assaut manqué sur la palais présidentiel de Batista. Les pages qui suivent témoignent de la difficulté de Morgan à se faire accepter comme nouvelle recrue, avant de finalement faire ses preuves et de gravir tous les échelons.
Menoyo, mais aussi Lazaro Artola, Armando Fleites Diaz, Roger Redondo Gonzalez, Raul Castro… La liste de tous les personnages dotés d’un rôle plus ou moins capital dans cette grande saga cubaine qu’est El Comandante Yankee, est très longue. Et pour cause : plus de 10 ans de recherche ont été nécessaires à Gani Jakupi pour croiser faits historiques et petits meurtres entre amis. Dès lors, la somme de détails qui nous est donnée est à la hauteur de la passion – parfois dévastatrice – qui habite tous les protagonistes. S’il est toutefois un événement heureux à retenir dans cet océan d’informations, c’est le mariage de Morgan avec l’impétueuse Olga, combattante et militante qui, malgré toute sa force de conviction, ne réussira pas à organiser l’évasion finale du Yankee. Elle a quitté Cuba en 1980 pour se rendre dans l’Ohio, auprès de la famille de Morgan…
Au cœur de la rébellion castriste, de ses ambitions et de ses déceptions, de ses combats et de ses trahisons, El Comandante Yankee se lit avec beaucoup d’attention et d’intérêt. Son découpage, nécessairement tiré au cordeau pour ne pas perdre lecteurs et lectrices, laisse parfois de grandes pages blanches faire la liaison entre deux faits d’armes ou événements. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir encore plus, les éditions de la Table ronde ont publié un ouvrage où sont rassemblés tous les documents et témoignages consignés par Jakupi. On y découvre le cheminement de la création d’El Comandante Yankee.