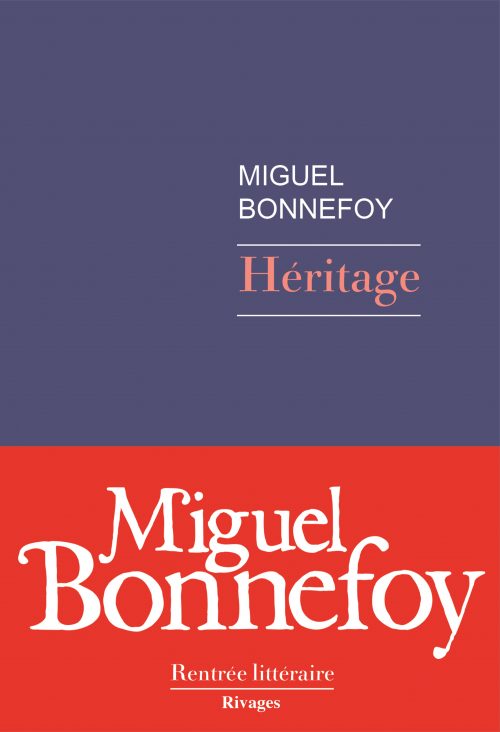LA CHRONIQUE
[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]
Héritage réussit le tour de force, en 208 pages, de peindre et de sculpter, en couleurs, en relief, en parfums et en sons, une fresque familiale couvrant un siècle d’histoire. Miguel Bonnefoy s’inspire ici très directement de la partie chilienne de ses origines familiales. Si ses romans précédents ont pu être qualifiés de romans d’aventure (sans « s »), Héritage est sans aucun doute un roman d’aventures au pluriel. Car le livre renferme autant d’histoires fabuleuses que de personnages hauts en couleurs, et l’ouvrir – comme on ouvre un coffre aux trésors – est la garantie de ne le refermer qu’une fois la dernière page tournée, à regrets.
Un Jurassien émigré au Chili, un fou de musique, le fondateur d’une fabrique d’hosties, une femme éleveuse d’oiseaux rapaces, une autre pilote d’avions de guerre, une victime du putsch de 1973, un retour aux sources, et même un spectre amoureux… Comment Miguel Bonnefoy a-t-il réussi à réunir des personnages aussi baroques sans jamais perdre son lecteur, comment leur donne-t-il vie à tous sans jamais tomber dans le superficiel ni la caricature ? Comment nous émeut-il tout en nous faisant traverser les épreuves que l’histoire a infligées au Chili ? Il a bien voulu répondre à quelques questions pour nous aider à affronter le flot d’interrogations que suscite la lecture de Héritage. Même si, au bout du compte, bien sûr, la magie et la poésie l’emportent…
L’INTERVIEW
[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]

Vos romans précédents comportent une partie autobiographique. Dans Héritage, cette partie prend une importance considérable. Pourquoi avez-vous souhaité raconter l’histoire de votre famille de façon aussi proche de la réalité ?
En grande partie pour rendre hommage à mon père, et aussi pour garder une trace de cette histoire familiale tellement particulière…
Dans ce roman, vous nous faites traverser tout un siècle en 200 pages. Comment avez-vous réussi ce tour de force ?
J’ai dû couper à peu près la moitié du texte d’origine. Je voulais garder l’essentiel, éviter la complaisance de l’écrivain, ne pas distraire le lecteur par des effets de style. J’ai donc coupé 200 pages, ce qui n’a pas toujours été simple…
Quel a été votre plus grand défi pour écrire ce livre ?
Le dosage entre le réel et le baroque, probablement, le mariage entre le style latino-américain et la langue française, et entre mes deux héritages historique et familial. Le dosage entre les personnages, la place qu’ils prennent dans le roman. Et puis ce que nous venons d’évoquer, le fait de couper sans pitié…
Qui a été votre premier lecteur pour ce roman ?
Mon père bien sûr. Comme le roman parle de la période du putsch et de la dictature de Pinochet, je voulais absolument qu’il lise ce passage. D’ailleurs, le nom de mon personnage, Ilario Da, est le pseudonyme de mon père. Quand ce dernier est arrivé en France, après avoir été torturé et avoir fui la dictature, il avait peur d’être poursuivi par l’opération Condor et c’est sous ce pseudonyme qu’il a publié son premier livre. Ce personnage est un immense hommage au pseudonyme de mon père. Quand il arrive, à la fin du livre, sur les côtes françaises, il choisit le nom de Michel René… Mon père s’appelle Michel Bonnefoy – René, c’est pour renaissance. Tout est un clin d’œil dans ce livre. Je voulais avoir son aval, je voulais qu’il soit d’accord pour que je raconte comment il avait réagi face à ses tortionnaires, y compris les aspects particuliers, douloureux et d’une grande violence. Hélas, cette partie est probablement la plus « vraie » de tout le livre. Il faut dire que je suis né de cela… Quand mon père arrive en France, il rencontre ma mère, et c’est de là que je viens. D’ailleurs, pour l’anecdote, j’ai dédié le livre à ma fille Selva, qui est bien sûr celle qui connaît la suite. A la dernière page du livre, j’évoque ce petit-fils, qui, cinquante ans plus tard, retourne vers les racines. Et aussi celui qui, plus tard, retournera vers la jungle* – la jungle, « selva » : cette boucle-là est bouclée !
On doit vous parler souvent de ce « réalisme magique » qui caractérise une partie de la littérature latino-américaine. Vous semblez l’assumer particulièrement bien. Comment avez-vous procédé pour intégrer la partie « magique » de votre récit, et les personnages imaginaires aux personnages réels ?
Mon premier personnage, Lonsonier, est celui qui arrive au Chili avec un pied de vigne et 30 francs dans la poche : il s’appelait Claude-Georges Bonnefoy. Ensuite lui succède son fils Emile Bonnefoy, que j’appelle Lazare Lonsonier, qui crée la fabrique d’hosties et fait la Première Guerre mondiale. Et puis à la fin, j’avais Ilario Da, mon père. Il fallait que je crée la boucle avec le fil rouge qu’est Michel René. Au milieu, j’avais un trou générationnel entre Lazare et Ilario. Le trou est comblé par ma grand-mère, Fanny Rosenszweig qui a fui les pogroms et qui est arrivée en Argentine dans les colonies juives – c’est l’histoire d’Ilario Danovski que je reprends pour lui rendre hommage. Et puis un jour, j’étais dans le métro et il y avait un journal sur le siège à côté. Parmi les informations, je tombe sur cette dépêche : « Aujourd’hui est morte Margot Duhalde, 93 ans, première femme franco-chilienne à avoir combattu dans la Royal Air Force, décorée de la Légion d’honneur par le Président Jacques Chirac. » Je commence à me renseigner, et je m’aperçois que cette femme est une grande figure de l’histoire de l’aviation chilienne, qui a exactement la même histoire familiale que la mienne : vieille famille française ayant quitté la France pour fuir la famine et débarqué au XIXe siècle au Chili. L’histoire de Margot Duhalde, figure historique que tout le monde connaît au Chili, revenue au Chili pour y fonder une école d’aviation qui est aujourd’hui un musée qui porte son nom, est absolument fascinante. C’était le personnage qui me manquait. Je l’ai transformée en Margot Lonsonier, je l’ai maquillée à ma façon.
Comment l’avez-vous travaillée ? Et surtout, pour en revenir au réalisme magique, comment avez-vous imaginé son étrange maternité ?
Soit Margot faisait un enfant avec Ilario Danovsky mais alors je perdais la scène où il meurt dans un sacrifice en Angleterre, soit je lui inventais une rencontre soudaine et arbitraire avec un homme. C’est Jorge Luis Borges qui disait que les personnages ne doivent jamais apparaître de manière arbitraire, qu’ils doivent être là depuis le début, qu’ils ne font que revenir. Je me suis donc demandé quel était le personnage disponible qui pouvait revenir, former une boucle. J’ai pensé à Helmut Drichman, qui était là depuis le début, et je me suis posé la question de savoir si je pouvais le faire resurgir sous la forme d’un spectre. Est-ce que ça casserait le naturalisme du livre, ou est-ce qu’au contraire cela lui donnerait un pétillement, une touche latino-américaine ? Je me suis lancé dans cette aventure-là. Et c’est sans doute le chapitre que j’ai le plus travaillé. A aucun moment il ne fallait utiliser un adjectif qui risque de briser les fondations… Il fallait pouvoir raconter ce réalisme magique avec les mots les plus cartésiens. Encore une fois, une affaire de dosage.
Ce personnage est extrêmement symbolique : il est l’objet du premier dilemme du livre, celui du deuxième également…
Et il est le père du troisième dilemme d’Ilario Da dans sa prison, qui se demande s’il doit donner le nom de Bracamonte, qui est mort, pour sauver sa peau, ou non… Ce livre est bourré de clins d’œil, plein de pierres d’attente, ces pierres que je pose pour les livres à venir ou ceux d’avant, afin que l’ensemble constitue un tout cohérent. Je ne fais que commencer, je pose des pierres.
Donc vous êtes parfaitement conscient d’être en train de construire une œuvre ?
Oui, très humblement c’est clair pour moi. Si dans 10 ou 15 ans je suis parvenu à construire ce que je veux faire, tout en gardant la tête froide et les pieds de plomb, j’aurai accompli quelque chose.
Y a-t-il des choses que vous écrivez aujourd’hui et que vous n’auriez pas pu écrire il y a quatre ou cinq ans ?
Oui, comme tous les jeunes auteurs, j’avais quelques obsessions. Vous savez, ces jeunes écrivains qui lisent passionnément Victor Hugo, qui constatent que Hugo utilise sans cesse le mot « farouche » et qui deviennent obsédés par l’idée d’avoir ce mot « farouche », eux aussi ! Ce que j’ai réussi à faire ces dernières années, c’est de ne pas me laisser polluer par ce que j’ai sans cesse envie de dire, de me libérer de certains topoi, des piliers du temple que je voulais absolument nommer.
Pour vous, les influences sont-elles importantes ?
J’entendais il y a peu un écrivain qui disait qu’il ne lisait pas de peur d’être influencé. Pour moi, c’est une terrible erreur ! Je ne suis pas fier des choses que j’ai écrites, mais de celles que j’ai lues. Qu’il s’agisse de littérature chilienne – comme Isabel Allende, la poésie de Neruda, le détective sauvage de Bolano – ou d’autres comme Alejo Carpentier, Benedetti, j’ai pris ces influences à bras le corps. Je pense aussi à Jean-Pierre Blancpain qui dresse dans un ouvrage monumental un portrait extraordinaire de l’influence française non seulement sur la pensée mais aussi sur l’organisation politique chilienne. Pour Héritage, j’ai lu des biographies passionnantes d’aviatrices : Amelia Earhart, Adrienne Bolland, Maryse Bastié, et des livres d’aviateurs – de Saint-Exupéry à Kessel ou Roland Garros. J’ai également amassé beaucoup de documents sur la participation latino-américaine aux deux guerres mondiales. On défriche ces livres, on prend beaucoup de notes, et on les réintègre très délicatement au corps du texte, on leur donne un peu de poésie pour que ça ne ressemble pas à du Wikipedia. Un travail que peut-être, il y a 5 ans, je n’aurais pas fait.
Certains auteurs disent qu’il est capital d’amasser et d’assimiler la documentation, mais qu’il n’est pas obligatoire de l’utiliser. L’important, c’est de la chercher.
Exactement ! Ce qui me fait penser à cette belle phrase de Baudelaire : « Un écrivain plagie un livre, un romancier en plagie mille. » J’aime bien cette idée que derrière tout livre, il y a d’énormes bibliothèques, un gigantesque puzzle de 1000 informations. Quant on lit la correspondance de Flaubert, obsédé par la documentation au point que pour pouvoir écrire Bouvard et Pécuchet, il avait lu 1700 livres – Théophile Gautier persiflait : « Monsieur Flaubert abat une forêt pour construire une boîte d’allumettes » -, on s’aperçoit que Flaubert avait lu des textes inimaginables, comme de la poésie bavaroise du Moyen-Age, dont on ne retrouve rien dans Bouvard et Pécuchet. Et pourtant, s’il n’avait pas lu ce livre, il n’aurait pas pu écrire sa page.
Vous avez évoqué vos influences latino-américaines, quelles sont vos influences francophones ?
Léopold Sedar Senghor, Dany Lafferrière, Aimé Césaire, Edouard Glissant, Lyonel Trouillot : tous ces grands francophones m’ont beaucoup touché, ne serait-ce que parce que comme eux, j’ai appris le français sous les tropiques ! Ces auteurs-là arrivent à mêler cette structure française rigoureuse à une poésie, une déraison, des cabrioles, des labyrinthes. En ce qui concerne les Français, j’ai été un grand lecteur de Louis Aragon, surtout dans sa période surréaliste. Et les écrivains qui ont choisi le français alors que ce n’était pas leur langue maternelle : Cioran, Beckett, Gary… Bref, tous ceux qui ont mis un coup de pied dans la fourmilière.
Il n’est pas utile de vous demander si vous avez des projets, puisque vous savez exactement où vous allez.
C’est vrai. Le prochain roman sera probablement pour 2022. Si ma maison d’édition me fait suffisamment confiance pour me laisser travailler en toute quiétude sur un seul projet, ce sera bien. Entre-temps, je vais probablement écrire des articles ou d’autres textes, des collaborations, des recueils, etc. Et puis je commence à avoir des invitations en librairie, en festivals, et j’en suis ravi.
Vous avez écrit Héritage en partie pendant votre séjour à la Villa Médicis. Est-ce un véritable atout en termes de concentration que de travailler dans un lieu pareil ?
De concentration, pas forcément; Vivre dans la beauté n’est pas nécessairement favorable ! En revanche, le fait que la Villa Médicis accueille des créateurs de toutes disciplines est quelque chose de merveilleux, pour peu que l’on sache où l’on va. Ce séjour a été très enrichissant.
Vous parlez beaucoup de boucles, de systèmes. Y aurait-il quelque chose de Georges Perec chez Miguel Bonnefoy ?
Sûrement, en ce que je me pose des contraintes. Mais il n’y a rien d’oulipien, pas de mathématiques, pas d’algèbre ! En revanche, la notion de quadrillage, de géométrie de la langue et de cohérence à l’intérieur du livre n’est pas absente.
*Jungle est aussi le titre d’un récit de voyage publié par Miguel Bonnefoy chez Paulsen en 2016, dans lequel il raconte sa plongée dans la jungle vénézuélienne.
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
[one_half]
Héritage de Miguel Bonnefoy
Rivages, août 2020
[button color= »gray » size= »small » link= »https://www.payot-rivages.fr/rivages/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/EditionsRivages/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/editionsrivages/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/editionsrivages » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]
[/one_half][one_half_last]
[/one_half_last]
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]