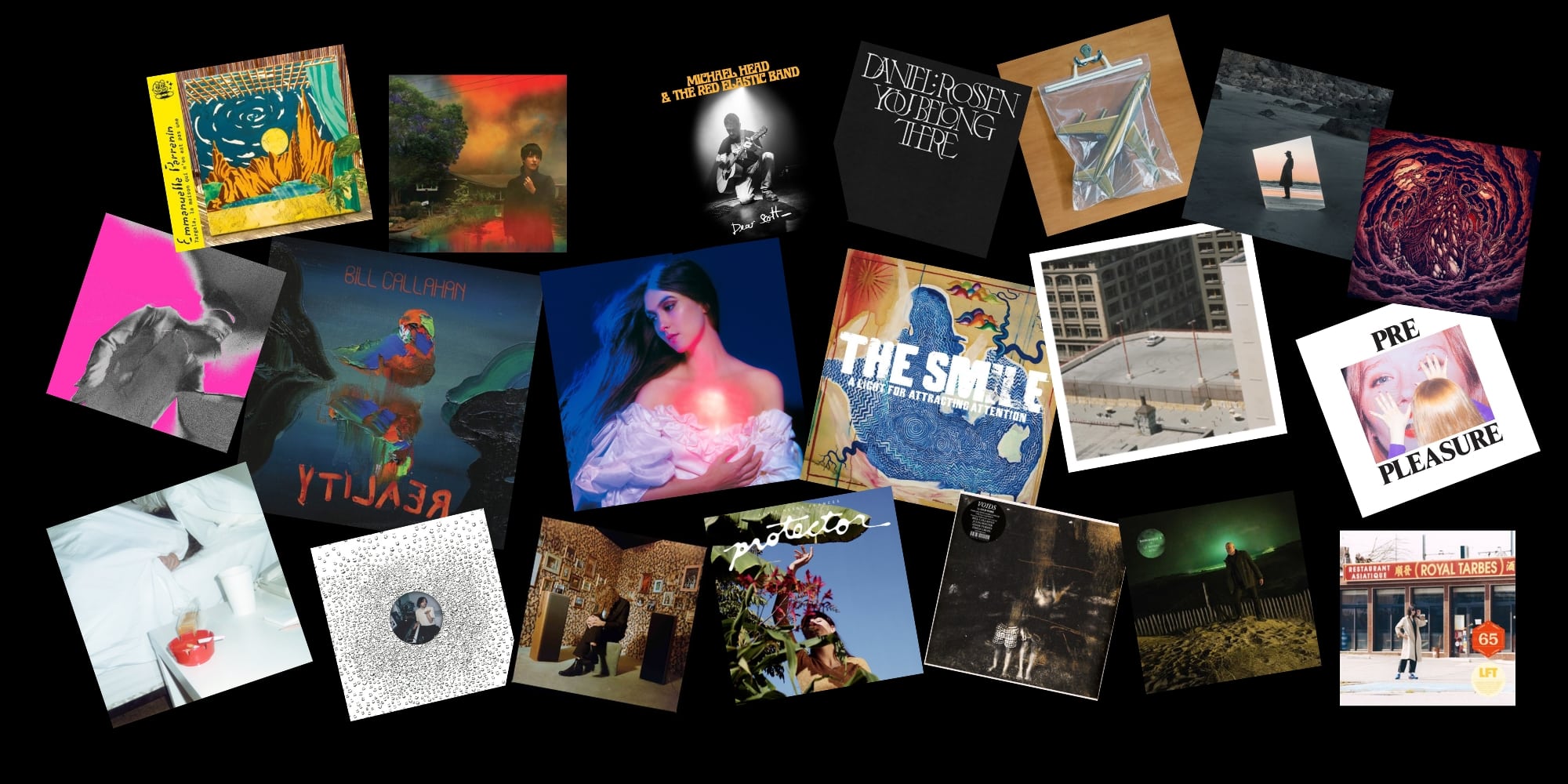[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]C[/mks_dropcap]ertains artistes font montre d’une régularité apaisante. Publiant un album studio à une périodicité constante, jamais moins de deux ans mais jamais plus de quatre, ils nous rassurent en nous promettant tacitement dès la parution d’une œuvre, que la suite, semblable mais différente, adviendra dans un délai raisonnable, et qu’on ne subira alors ni bouleversement fondamental ni déception. Thomas Fersen est de ceux-là.
Avant de récapituler les neuf premiers chapitres de son œuvre, puis de décortiquer le dernier, Un Coup de Queue de Vache, commençons par nous pencher sur les atouts maîtres que l’auteur-compositeur-chanteur-musicien parisien cache dans sa manche.
Thomas Fersen : le chanteur
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]D[/mks_dropcap]ans la chanson française la plus traditionnelle, la voix est mise en avant, afin que passent en priorité les mots et les intonations. La musique n’est souvent que supplétive, réduite au rang d’accompagnement. Thomas Fersen ne peut, bien sûr, être rangé dans cette catégorie, mais l’organe vocal demeure naturellement le point d’accroche de l’édifice.
Ce timbre éraillé, qu’on sent toujours prêt à dérailler, est une de ses marques de fabrique, même si Arthur H le toise de haut sur ce plan. Mais à des degrés divers : c’est surtout quand la chanson s’emballe et que son auteur s’enflamme (La Chauve-souris, Mais Oui Mesdames) ou monte dans les aigus (Dracula) que, mécaniquement, la voix prend cette raucité caractéristique qui contribue au charme de l’interprète.
En sus des variations de grain, Thomas Fersen sait user de variations de ton. Entre prose dévalée à toute allure (Chez Toi), et brouillard cotonneux (Mon Iguanodon, Jean), air goguenard (Cravates) ou moqueur (Diane de Poitiers) et exaltation quasi-lyrique, il est souvent autant comédien que chanteur. Il n’est pas étonnant de l’entendre se lancer dans le parlé-chanté sur Coccinelle. Mais cet art est toujours au service des chansons, jamais à leur détriment.
Thomas Fersen : le compositeur-arrangeur
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]a vocation musicale de notre homme ne naît pas de la fréquentation assidue du répertoire national, mais d’une passion adolescente pour les musiques anglo-saxonnes. Sa première idole est Nick Cave, sans que la passion semble-t-il commune pour les chauves-souris soit pourtant déterminante. Et ça se ressent dans les compositions, qui visent l’efficacité et l’immédiateté avant toute chose. Thomas Fersen bâtit la plupart de ses morceaux sur une ou deux idées mélodiques qu’il développe et décline de manière futée, avec en visée la simplicité qui fait mouche. Une des conséquences de cette manière de faire, c’est qu’à la première écoute l’impression de déjà-entendu nous saisit, surtout quand on connaît déjà les précédentes œuvres par cœur. Mais il faut faire confiance à l’animal, et attendre la ré-écoute, puis la ré-ré-écoute, pour trouver de nouvelles pistes et de nouveaux plaisirs. En fait, c’est un vrai compositeur pop, comme le prouvent Deux Pieds, Le Chat Botté, Dracula ou La Boxe à l’Anglo-saxonne.
Le Thomas Fersen léger côtoie en permanence le Thomas Fersen mélancolique : il est aussi passé maître de ces morceaux nostalgiques, un peu troubles, dans lesquels il laisse tomber le masque du conteur ou du moraliste, pour colorer sa musique d’une teinte grisée, alanguie et vaguement inquiète (Pommes, Pommes, Pommes, Dugenou, Maudie, Mon Iguanodon, Ce qu’Il Me Dit). Une atmosphère qui confère à cette partie de son œuvre un caractère élégiaque.
Côté instrumentation, le nuancier est plus contrasté que ne pourrait le laisser penser une connaissance superficielle de son corpus. Réduite initialement à une assez simple expression, elle a pris une certaine amplitude à partir de l’album 4, sous la houlette de Joseph Racaille. L’électrification, qui a présidé à Pièce Montée des Grands Jours et Le Pavillon des Fous, a laissé de la place pour des envolées instrumentales, notamment sur les deux magnifiques morceaux qui les closent (respectivement Né Dans Une Rose et Cosmos). Commence alors la fixette sur l’ukulélé, puis c’est la pop de chambre de Je Suis au Paradis et la formation plus rock de And the Ginger Accident, preuves de son aisance dans plusieurs registres.
Thomas Fersen : l’auteur
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]e fait d’aborder cet aspect du talent fersenien en dernier n’est pas tout à fait anodin : ne pas se focaliser, comme tant d’autres, sur ses textes, participe d’une volonté de ne pas faire passer la facilité mélodique et l’aptitude à charmer musicalement au second plan.
Mais il faut tout de même rappeler sa finesse de plume. Thomas Fersen use et abuse d’un vocabulaire volontiers désuet : où parle-t-on encore de pardessus, de mules en reptile, de tricot de peau, de jabots, de plastrons (cette obsession pour les vêtements anciens !), de communion solennelle, de baignoire oblongue, ou de waters pour dire toilettes ? Cette prose archaïque, qui pourrait passer pour ronflante et démodée, Fersen en fait une force en multipliant les acrobaties verbales, les rimes futées et les trouvailles lexicales, en une écriture pleine de d’énergie et de fantaisie. Il ne néglige pas non plus les punchlines drolatiques en assonance (« Elle n’aurait pas la bouche qui fermente, Si elle suçait des bonbons à la menthe » dans Borborygmes, ou « Ce grain de beauté-là, c’est un genre de blason, Il constitue les armes de notre maison, Et je suis rassuré, le jour où je le cherche, Même entre dix millions, je retrouverai mon derche« dans Coccinelle).
Ce grand art trouve son point d’orgue dans Georges, seul inédit du best of acoustique Gratte Moi la Puce, et histoire irrésistible menée de main de maître mêlant coming-out, grammaire défaillante et tentative d’ingestion d’une pâtisserie manquée.
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]C[/mks_dropcap]ar Thomas Fersen, c’est bien connu, est aussi un conteur et un fabuliste, que Les Malheurs du Lion et La Chauve-Souris sur 4 ont contribué à rendre célèbre. Une Autre Femme, sur Je suis au Paradis, poursuivait dans cette veine de raconteur d’histoires doué. Mais notre homme a aussi remis au goût du jour le concept même d’album concept, sans la prétention auquel on l’associe souvent, et sans trop s’y enfermer : la folie (Le Pavillon des Fous), le voyage (Trois Petits Tours), les contes effrayants (Je Suis au Paradis). Il ne s’y laisse pas trop enfermer car il s’autorise, même dans ces thématiques balisées, des digressions au gré de sa fantaisie. Mais ces thèmes lui permettent de donner libre cours à son imaginaire riche.
Et dans cet imaginaire, quelques marottes occupent une place de choix récurrente. On a trop souvent, notamment dans un journal de programmes télé et de critiques artistiques, évoqué le « bestiaire » propre à Thomas Fersen. Il est vrai qu’il donne le nerf de bœuf pour se faire battre, notamment en posant sur la pochette de ses disques en compagnie d’un lapin (Les Ronds de Carotte), d’un poisson (Le Jour du Poisson), d’une tête de cochon (Pièce Montée des Grands Jours) ou d’une vache (Un Coup de Queue de Vache), mais si le thème zoologique est présent dans son œuvre, il s’efface derrière les portraits d’humains, la plupart du temps inquiétants, décalés ou franchement terrifiants (Bambi, Hyacinthe et Le Balafré ont de nombreux points communs), mais aussi drolatiques ou touchants. Son attirance profonde pour la Bretagne traverse également ses disques, à partir de Pièce Montée des Grands Jours et son fameux Saint-Jean-du-Doigt, les albums précédents, et notamment Les Ronds de Carotte, étant plus parisiano-centrés.
Après cette étude à visée transversale, l’épisode suivant de ce triptyque suivra le fil chronologique du Bal des Oiseaux à And The Ginger Accident.