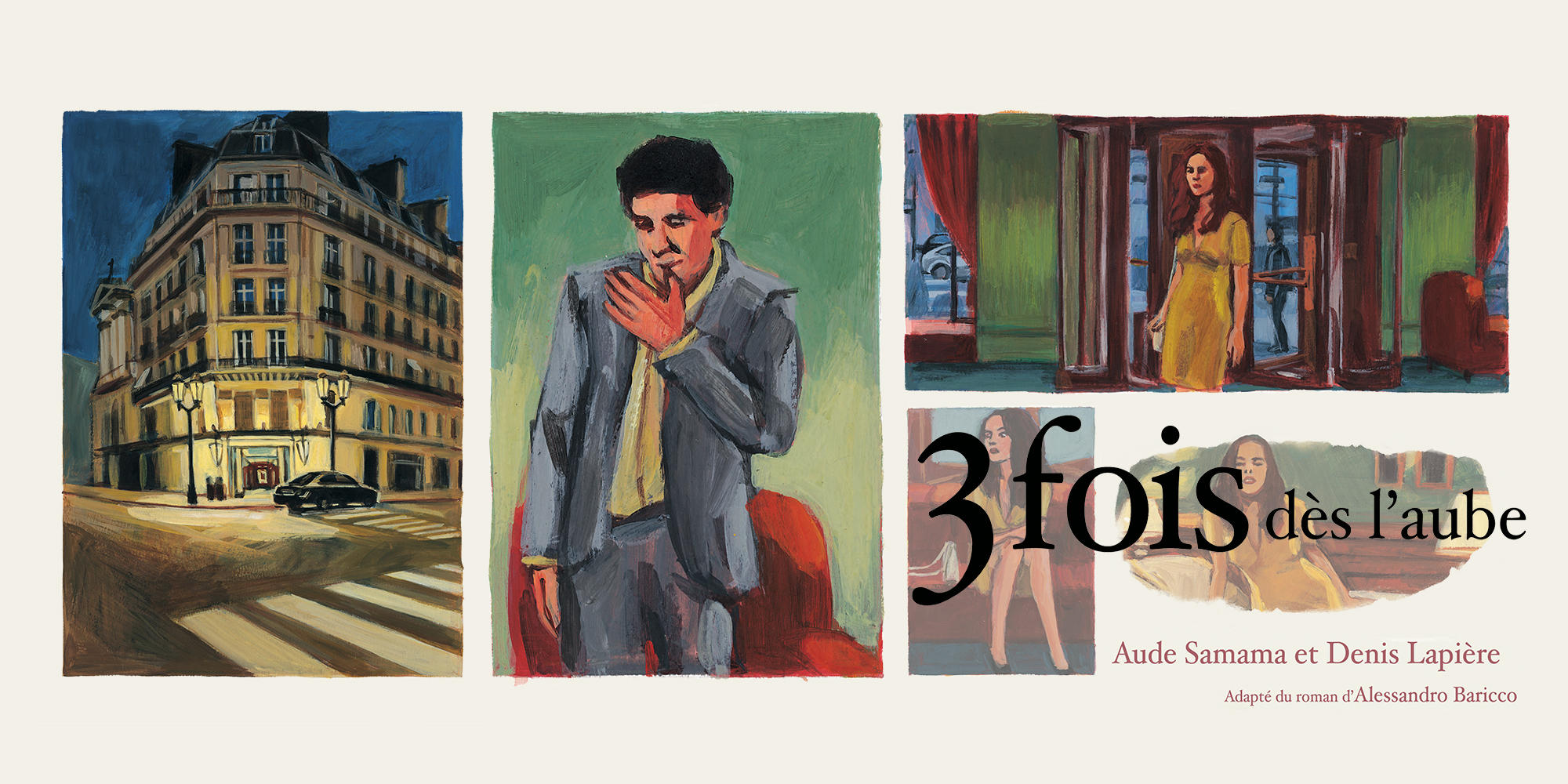Silent Jenny a tout du livre qui vous secoue. Avec ses monades roulantes qui sillonnent un monde ravagé, cette nouvelle fable post-apocalyptique de Mathieu Bablet s’inscrit dans la continuité des récits du Label 619 dont les récits denses et nerveux donnent le vertige et multiplient les contre-pieds. Avec ce one-shot massif composé de 320 pages serrées comme un poing, l’auteur ne déroge pas à la règle et ajoute une profondeur mélancolique. Comme si, après avoir exploré les grandes fresques technologiques, il se penchait désormais sur ce qui reste lorsque tout s’effondre.
Le monde de Silent Jenny repose sur une idée simple et terrifiante. Les abeilles ont disparu et, avec elles, le vivant tel que nous le connaissions. Le reste n’est qu’une réaction en chaîne. Terres mortes, écosystèmes vampirisés, survie organisée dans de gigantesques cités ambulantes, à mi-chemin entre villages motorisés et convois de réfugiés éternels. Ces « monades » avancent pour ne pas mourir, sous le contrôle étouffant d’une corporation omniprésente, Pyrrhocorp, qui gère les ressources restantes comme on administrerait les reliques d’un monde défunt.
Dans ce décor calciné, Jenny explore. Elle descend de la monade comme on descend dans un gouffre. Rétrécie par une combinaison qui se raccourcit, elle arpente les forêts toxiques, les friches irradiées et les restes d’un vivant invisible qu’elle tente de reconnaître. Sa mission ? Retrouver un miracle. Un fragment d’ADN d’abeille. Une trace ténue d’un passé qui permettrait encore d’imaginer un avenir. Autant dire un acte de foi.
Bablet a toujours su créer des univers. Ici, il invente surtout des atmosphères. Des laboratoires où tout est brun, ocre et sec. Des extérieurs où la lumière découpe les ruines comme si le soleil tentait un dernier baroud d’honneur. Nous restons bien souvent abasourdis devant la qualité et la précision stakhanoviste du dessin, tantôt saturé ou épuré. Le travail sur la couleur est l’une des plus grandes forces de l’album, tant il souligne la porosité entre l’émerveillement et la désolation.

Ce que l’on retient, pourtant, c’est moins la technologie ou les monstres que les silences de Jenny. Le titre n’a rien d’un gimmick. Il dit ce que le livre porte en lui, une manière de raconter l’effondrement sans éclat, sans grand discours, mais avec une vulnérabilité constante. Ce monde a perdu ses abeilles, mais Jenny semble, elle aussi, avoir perdu quelque chose de plus profond encore. Une envie, un élan, un sens. Ses illusions. Son exploration devient donc double puisqu’il s’agit de trouver un fragment d’ADN, mais surtout une raison de continuer à se battre.
On sent dans Silent Jenny un glissement par rapport aux précédents albums de Bablet. La critique dit qu’il s’agit d’une « clôture écologique » de son œuvre de science-fiction. C’est plausible, tant l’album semble refermer une parenthèse en proposant un conte moral, quasi-méditatif. C’est aussrément dystopique et, dans un autre registre, on pensera à Walking Dead pour cet instinct de survie dans un monde de désolation, ou à la série Colony pour cette nécessité d’organiser sa lutte dans l’ombre.
Silent Jenny rappelle que la science-fiction la plus puissante n’est pas celle qui montre des galaxies, mais celle qui parle de ce que nous risquons de perdre ici et maintenant. Les abeilles, bien sûr. Mais aussi la capacité de s’émerveiller, de regarder autrement et de croire que le vivant mérite encore qu’on se batte pour lui. Bablet signe là une BD dense, exigeante, parfois rude, mais profondément humaine. Une œuvre qui laisse une trace durable, comme un bourdonnement persistant dans un monde qui n’en émet plus.
Une grande bande dessinée, à ne pas lire pour se divertir, mais pour se laisser traverser. Comme un murmure. Comme un avertissement.