[mks_dropcap style= »letter » size= »52″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]D[/mks_dropcap]epuis dix ans, Céline Leroy traduit , principalement des auteurs américains contemporains tels que Edmund White, Peter Heller, Renata Adler. Exception notable à la règle : elle est aussi la traductrice de la formidable auteure anglaise Jeanette Winterson. Outre son talent, sa particularité est sa connaissance du monde de l’édition, qui lui donne de son métier une vision plus large et plus ouverte sur un marché du livre en pleine évolution… Un grand merci à elle pour son temps, sa patience et sa vision passionnante d’un métier qu’elle adore.

Avez-vous toujours voulu être traductrice ?
Oui, c’est arrivé très tôt. Pendant mon année de bac, en 1994, il y avait une épreuve de traduction. C’était mon initiation, en quelque sorte, et ça m’a plu très vite, sans pour autant que j’envisage d’en faire mon métier. J’étais déjà très axée sur les études de langues, je savais que j’allais faire des études d’anglais. A Paris IV, j’avais pris une option « traduction », et les années passant, je me suis aperçue que c’était vraiment mon domaine préféré. Mais je n’avais pas de contacts dans l’édition, tout le monde me disait que pour y entrer, il fallait un réseau. Ce qui est vrai, mais dans une certaine mesure seulement.
Pendant mon année de maîtrise, j’ai cédé au réflexe français qui consiste à vouloir un diplôme pour tout, je me suis inscrite au DESS de traduction de Paris VII. J’y suis allée les mains dans les poches, et je me suis lamentablement ramassée, de façon très ironique puisque le texte que j’avais à traduire était signé Nicholas Shakespeare, le biographe de Bruce Chatwin. Or j’allais me lancer dans une thèse… sur Bruce Chatwin. C’était une affaire de maturité : je n’étais pas prête.
Et j’ai continué sur ma lancée universitaire – tout le monde disait qu’on ne pouvait pas vivre de la traduction – : DEA, puis thèse sur Bruce Chatwin. En année de DEA, j’avais un séminaire et Dominique Bourgois y est venue parler de son métier d’éditeur. Elle a lancé une sorte d’appel : elle était à la recherche de lecteurs et de lectrices. J’ai levé la main, et c’est là que j’ai mis un pied dans le monde de l’édition, un peu par la petite porte. Pierre Yves Pétillon, très grand professeur de littérature américaine, avait été lui aussi lecteur pour Christian Bourgois. Je suis donc devenue lectrice pour Dominique et Christian Bourgois, moi aussi !
Au bout de trois années d’une thèse que je n’ai jamais terminée, je me suis dit que j’allais retenter ma chance. Cette fois, j’ai eu le DESS à Paris VII, puis j’ai fait un stage chez Rivages. C’était l’époque où Catherine Argand était éditrice en littérature étrangère, et à partir de là, j’ai toujours eu du travail. J’ai aussi traduit des documentaires animaliers pour la télévision, sans formation spécifique puisqu’il ne s’agissait pas de sous-titrage. J’ai fait ma première traduction pour un ancien collaborateur de Rivages qui avait monté sa propre maison, éphémère d’ailleurs… Puis Catherine Argand m’a proposé une traduction : c’était l’année où les « Belles étrangères », cette manifestation qui, chaque année, se consacrait à un pays, avait pour sujet la Nouvelle-Zélande. Il se trouve que j’avais voyagé là-bas, et que je connaissais la littérature qui s’y publiait. On m’a fait choisir un roman néo-zélandais à traduire : j’ai donc eu la chance de choisir ma première traduction chez Rivages, en quelque sorte.
Si vous n’aviez pas obtenu votre DESS de traduction, pensez-vous que votre carrière aurait démarré aussi vite ?
Je suis certaine que cela m’a aidée, bien sûr. Mais il y a eu aussi le fait que j’avais déjà un pied dans l’édition en tant que lectrice; chaque année, je tenais le stand Bourgois au Salon du livre, j’avais donc déjà rencontré beaucoup de gens. Mais c’est un métier où on est vite mis dans des cases… Donc le fait d’avoir eu ce stage m’a permis de savoir comment on travaillait dans une maison d’édition, de voir l’envers du décor, de travailler avec des traducteurs. En plus, vu que je travaillais déjà pour Bourgois, j’étais un peu plus qu’une stagiaire chez Rivages. L’aura Christian Bourgois a facilité les choses. J’ai beaucoup travaillé avec l’assistante de Catherine Argand, j’ai eu l’occasion de la remplacer de temps à autre, je suis donc un peu entrée dans la famille. Et vice versa, le fait d’avoir traduit pour Rivages a incité Dominique Bourgois à me proposer d’autres traductions. C’est ainsi que je me suis retrouvée à traduire deux romans de Laura Kasischke, ce qui a grandement contribué à améliorer mon CV !
Le tout premier roman que vous avez traduit ?
C’était un roman d’espionnage pas extraordinaire, avec un titre à la James Bond, Mourir une dernière fois, écrit par une auteure, Francine Matthews, qui a ensuite publié des polars, pastiches de Jane Austen, sous le nom de Stephanie Barron.
Qu’est-ce que cette première expérience vous a appris ?
La peur absolue face à un texte… J’ai appris que je n’avais rien appris, que tout était à faire. J’avais beau avoir je ne sais combien d’années de fac derrière moi, les compteurs étaient vraiment remis à zéro, et je tombais de très haut. C’est là que j’ai découvert aussi la question de la distance qu’il faut avoir par rapport au texte, et c’est une question qui me préoccupe encore. A quel point faut-il s’éloigner ? C’est vraiment la corde raide avec deux gouffres de chaque côté. Par la même occasion, j’ai travaillé dans un genre littéraire que je ne connaissais pas du tout : j’avais lu des polars, mais pas du tout de romans d’espionnage. Il y avait donc tout un lexique nouveau à constituer. En plus, le roman traitait d’anthrax, j’ai donc dû faire des recherches sur le sujet. Je dois probablement être fichée par la NSA… Pour tout dire, le texte n’était pas formidablement bien écrit, ce qui n’arrangeait rien.
Et la deuxième expérience, vous l’avez choisie.
Oui, c’était un roman néo-zélandais signé Owen Marshall, un roman d’anticipation, Les hommes fanés. L’auteur était plutôt auteur de nouvelles, il a écrit seulement deux romans, je crois. Le monde – ou la Nouvelle Zélande ! – est décimé par une étrange maladie. Tous les gens qui sont atteints sont mis en quarantaine, et le roman est le récit d’un personnage qui soigne ces gens qui meurent les uns après les autres. Un texte très littéraire, avec une présence très forte du paysage et le vocabulaire qui va avec, une approche beaucoup plus psychologique.
Avez-vous été confrontée à des difficultés liées à l’anglais utilisé en Nouvelle-Zélande par rapport à celui utilisé au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis ?
Sur ce texte-là, très peu. Uniquement de petites questions de vocabulaire, liées à l’oralité et à l’accent. Mais comme on ne peut pas rendre un accent par écrit, sauf à sombrer dans le ridicule, il a fallu que je trouve d’autres moyens. Je me retrouve d’ailleurs un peu dans cette situation en ce moment : je travaille pour Buchet Chastel sur un texte de Atticus Lish, le fils de Gordon Lish, éditeur de Raymond Carver, Preparation for the next life. C’est un livre extraordinaire qui raconte l’histoire de deux personnages : un qui revient de missions en Irak et qui est en plein syndrome post-traumatique, et une immigrée clandestine chinoise musulmane qui arrive à New York, sans papiers bien sûr. Ils se retrouvent tous les deux dans le fin fond du Queens, là où les touristes ne vont pas et les petits écrivains de Brooklyn encore moins. On se retrouve avec des flash-backs avec les combats en Irak, et le vocabulaire qui va avec ; et puis la façon de s’exprimer de cette Chinoise qui parle un mauvais anglais. Comme l’histoire se déroule dans le Queens, il y a aussi beaucoup de blacks, de latinos, d’ex-taulards. Là, j’ai droit à tout ! On ne peut pas calquer la façon de parler les noirs du Queens sur celle des noirs de Sarcelles. C’est la même classe sociale, mais ça n’a rien à voir. Il faut que je trouve le moyen d’intégrer un peu du parler banlieue français, pour que le lecteur aie ses repères, mais surtout pas trop.

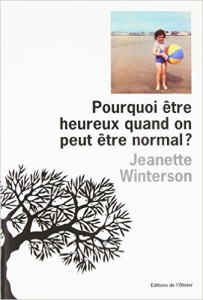
Cette différence liée à l’anglais, je l’ai plutôt ressentie, curieusement, avec Jeanette Winterson. Là, j’ai eu l’impression de traduire une nouvelle langue, car elle a une façon de placer ses mots très particulière. Et bizarrement, ça n’avait pratiquement pas d’impact sur la version française… Peut-être que cela vient, en partie, du manque de souplesse de la langue française. L’anglais a un rapport au substantif et à l’adjectif qui est extrêmement libre, et cette liberté nous est interdite en français. Le portugais également, apparemment, est plus souple. Et puis la traduction est une loupe : dès qu’on change une petite chose, l’effet est grossi. C’est une jauge dont il faut tenir compte.
Le fait que vous ayez traduit surtout de la littérature américaine, c’était un choix ?
Non pas vraiment, au début c’était surtout dû aux circonstances. Et je suis allée beaucoup aux Etats-Unis, c’est vrai. On m’a surtout proposé des auteurs américains. Pas de choix délibéré, donc. En revanche, comme j’ai surtout traduit des Américains, aujourd’hui je suis plus à l’aise avec les romans américains. Avec la littérature anglaise, il y a toujours un moment où ça achoppe. Je viens de terminer pour L’Olivier une traduction de Rachel Cusk, c’est le troisième texte d’elle que je traduis, et pourtant il y a toujours un moment où son côté auteur britannique, son style, me paraissent étrangers, ce que je ne m’explique pas totalement d’ailleurs.

Vous avez toujours traduit des textes contemporains ?
Oui, j’ai fait quelques auteurs morts, mais tous nés dans les années 30 ! Je n’ai jamais traduit de textes du XIXe ou antérieurs. Je pense que cela me serait très difficile, car je n’ai pas une bonne connaissance de la littérature du XIXe, en anglais comme en français d’ailleurs. Pas question d’écrire comme à l’époque, mais quand même, il est important d’être à l’aise avec l’époque, la culture, la façon de penser.
Quel est le roman avec lequel vous avez eu le plus de difficultés ?
Je pense à une anthologie de nouvelles de Leonard Michaels, Conteurs menteurs, publiée chez Bourgois. J’avais ce texte en lecture pour Dominique Bourgois, et en faisant ma fiche de lecture, j’ai conclu en disant qu’il fallait absolument traduire ce texte et que je me proposais de le faire. Des nouvelles qui s’échelonnaient entre les années 60 et les années 2000, pratiquement toute sa production de nouvelles, un livre de 400 ou 450 pages. J’avais déjà traduit un très beau roman de Michaels, Sylvia. Un vrai choc de lecture, le genre d’auteur qu’on croise rarement. Il s’agissait de suivre l’évolution d’un auteur, et chez lui, si côté thématique cela restait assez cohérent, en revanche, côté style, son évolution était compliquée. Pour les premières nouvelles, c’était vraiment difficile, non pas en termes de vocabulaire, mais d’atmosphère : il y avait toute l’ambiance de New York dans les années 60, l’évolution du West Village, la culture de cette époque, son côté auteur juif d’origine polonaise, avec une langue foisonnante et baroque, des torsions du langage, un recours à l’absurde et aux images étranges…
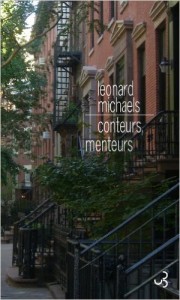
Je n’étais jamais complètement sûre : étais-je dans l’invention ou dans un travail sur l’idiome ? J’étais donc dans la terreur permanente ! Il y avait beaucoup d’humour, très dense, très compact, très drôle et très sombre. Cet auteur enseignait la littérature à Berkeley, il y avait donc aussi des histoires qui se passaient en Californie, et beaucoup de références à Byron, qu’il adorait. Avec des allusions plus ou moins claires à Wittgenstein. Typiquement le type d’auteur avec un bagage intellectuel très important : quand il faisait allusion à quelque chose, il n’allait pas le chercher dans le Dictionnaire des citations, il l’avait vraiment travaillé. Donc il ne fallait pas se planter : tous les jours, je me sentais à moitié idiote et inculte, limitée dans mon vocabulaire et ma façon d’écrire. A la fois un cauchemar et un bonheur incroyable. C’est un des textes qui comptent le plus pour moi.
Comment travaillez-vous ?
En général, je lis tout le texte avant de le traduire, sauf dans le cas de textes pas extraordinaires pour lesquels je me permettais de découvrir l’intrigue au fur et à mesure… Ensuite, premier jet où il s’agit vraiment de remplir la page blanche. Je ne regarde pas ce que j’écris, je traduis directement, il y a probablement des fautes à tous les mots… Pour moi, c’est comme un scan, une façon de repérer les difficultés. C’est comme un sas qui me permet d’entrer dans le travail, et puis l’illusion : « tout ça va infuser tout seul, mon cerveau va me donner la réponse à la dernière minute. » Il arrive que ça marche, ce qui est une impression étrange. Ensuite réécriture : j’ai tout un système de surlignage qui me permet de suivre l’évolution du travail, et qui m’aide à rester dans les délais. Puis première relecture qui va plus ou moins vite selon le texte. Enfin, dernière relecture au fil du texte, rapide. Sur les deux derniers textes que j’ai traduits, cela pouvait aller de 80 pages à 15 pages par jour ! Et personne d’autre ne me relit. Pendant que je travaillais sur le Rachel Cusk, j’avais chez moi une amie plus que bilingue, et je lui ai fait lire mon texte. Et ça a été très difficile pour moi. Je préfère attendre le moment où je remets à l’éditeur.

Vous sentez-vous auteur ?
Pas du tout ! Légalement oui, puisque ça me permet de gagner ma vie ! En dehors de ça, absolument pas. Si je suis traductrice, si ce métier me plaît tellement, c’est que j’ai un rapport très compliqué au langage. J’ai un mal de chien à écrire, à m’exprimer. J’ai toujours cette impression de grande difficulté à formuler mes idées, à les construire intelligemment. J’ai toujours la sensation que le bon mot qui va exprimer ce que j’ai dans la tête m’échappe. Dès que je dois écrire quelque chose, c’est comme un gouffre qui s’ouvre devant moi.
Est-ce l’exercice de la traduction qui vous a rendue plus exigeante ?
En fait, la traduction m’a un peu apaisée. J’ai toujours un texte sur lequel m’appuyer, même si face à une phrase, tout est possible ! Il faut faire des choix, comme dans la vie ! Le fait d’avoir devant moi un texte écrit par quelqu’un d’autre, qui a su exprimer ce qu’il avait en lui, me fascine et m’émeut d’une certaine manière, tout en me rassurant. Un de mes amis dit volontiers qu’il admire toujours ceux qui savent faire ce que lui ne sait pas faire. C’est un peu ça ! Mais cela ne me donne absolument pas envie d’écrire. C’est une question que je me pose souvent en ce moment d’ailleurs. J’en suis arrivée à la conclusion que si je voulais exprimer ce que j’ai en moi, il faudrait que je fasse de la poterie, ou quelque chose comme ça ! Et en même temps, la traduction est aussi une façon de s’exprimer, en creux, de façon discrète. Pour l’anecdote, pendant un an, j’avais une corde vocale paralysée. Moi qui étais censée traduire la voix des autres, j’avais perdu la mienne…
Pensez-vous que la traduction soit un peu aliénante ?
Oui, sans doute. On vit plusieurs mois avec un texte, la pensée d’un auteur. Avec le pouvoir des mots, qui est grand. Ce peut être envahissant, sinon aliénant. Certains textes m’ont beaucoup marquée, comme le roman d’Aimée Bender, La singulière tristesse du gâteau au citron (L’Olivier). L’histoire y est racontée par la petite voix assez drôle d’une enfant de 9 ans, et c’est une affaire d’empathie, d’une noirceur et d’une tristesse absolues. J’ai mis beaucoup de temps à m’en détacher, c’était très lourd à porter.
Donc la traduction, c’est addictif aussi ?
Oui, on attend toujours le texte suivant : ailleurs, l’herbe est plus verte ! Même quand on travaille sur un texte qu’on aime, il y a toujours cette excitation. Si un éditeur m’appelle pour me proposer un nouveau texte, même si je suis bookée sur un an et demi, je suis toujours très curieuse, je veux savoir ce que c’est, qui est l’auteur, etc. On accumule du feuillet, comme le kilomètre pour le marathonien, avec les poussées d’endorphine qui vont avec !
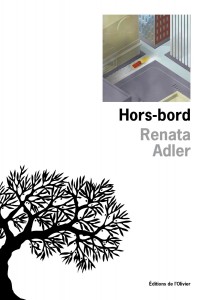
Quand un texte vous tient à cœur, vous arrive-t-il de vous investir pour le faire connaître ?
Autant que je peux, oui. Il m’est aussi arrivé de faire publier un texte que j’avais découvert, dans le cas de Renata Adler, formidable journaliste américaine des années 60-70 qui s’investissait très fort dans les questions des droits civiques, qui connaissait tous les acteurs du Watergate, et dont le photographe attitré était son ami… Richard Avedon. Elle a écrit deux romans : son premier, Hors-bord, que j’ai traduit pour L’Olivier, et un deuxième, que je traduirai à la fin de l’année, et qui a été écrit en 1976. Quelqu’un qui écrit en subjectivité absolue, avec un humour et une originalité incroyables. Du coup, j’ai pu la rencontrer l’année dernière. Dans un autre ordre d’idées, pour le livre de Don Carpenter Sale temps pour les braves sorti chez Cambourakis, j’ai beaucoup participé à la promotion, rencontré des journalistes… Cela me réjouit de voir que des textes marchent, que des journalistes les lisent, c’est un vrai bonheur. La joie d’essayer de porter une littérature qui n’est pas « mainstream ».
Travaillez-vous souvent avec les auteurs ?
J’ai eu quelques mauvaises expériences avec des personnes assez mal aimables… Je me rappelle en particulier un auteur qui avait vécu en France il y a cinquante ans, et qui avait dit à mon éditrice que sa femme, dont le père était traducteur, était mieux placée que moi pour traduire son livre. Comme s’il y avait un gène de la traduction… Sa femme n’avait jamais fait de traduction, n’était pas de langue maternelle française et n’avait pas mis les pieds en France depuis 50 ans. Je l’ai très mal vécu, même si l’éditrice m’a défendue. Je sais que cet auteur-là a récidivé avec un autre traducteur, et qu’en plus il a réécrit complètement certaines traductions…
Avec Rachel Cusk, il m’est aussi arrivé quelque chose de beaucoup plus inoffensif. Je lui ai écrit pour lui demander certains éclaircissements, elle m’a répondu qu’elle ne comprenait pas ce que je ne comprenais pas, et qu’il fallait que je lui explique. Comment lui répondre que si je comprenais, je n’aurais pas besoin d’elle… Un genre d’impasse, je suis passée pour une idiote ! Avec Renata Adler, j’étais terrifiée et là, au contraire, ça s’est très bien passé, elle a aimé mes questions et même elle a trouvé que certaines d’entre elles méritaient réflexion… Elle m’a même dit que je pouvais sauter certains passages ! Avec Peter Heller, c’était un autre type de problème, des problèmes de vocabulaire : j’avais besoin d’éclaircissements sur certains gestes de pêche à la mouche, sur certaines espèces de moutons bien spécifiques, là c’était plutôt drôle. En fait, mes mauvaises expériences, je les ai eues plutôt en début de carrière. Aujourd’hui, en général, ça se passe bien.
Aujourd’hui, qu’est-ce que vous conseilleriez à un étudiant de 20 ans qui aurait envie de faire de la traduction ?
C’est toujours très délicat : ça dépend du parcours de chacun, de son envie de travailler dans l’édition aussi. Moi, j’ai eu la chance de croiser Dominique Bourgois, et puis de faire cette formation universitaire, qui est loin d’être inutile, ne serait-ce que pour le stage, qui permet de rencontrer des acteurs de l’édition. Rencontrer d’autres traducteurs, ce n’est pas forcément ça qui va aider. C’est très difficile de recommander le travail de quelqu’un dont on ne connaît pas les compétences.
De mon côté, je voulais travailler dans l’édition, c’était le milieu dans lequel je me sentais bien. Quand j’avais 20 ans, j’avais travaillé tout un été à la librairie d’Actes Sud, à Arles, et j’y avais été très bien accueillie, malgré mon manque de formation. Dans mon parcours, j’ai toujours voulu rencontrer tous les gens de la chaîne du livre : des éditeurs, des fabricants, des commerciaux, des attachés de presse.
J’ai eu la chance de ne jamais avoir à demander du travail. Quand je rencontrais des gens, je n’étais pas en demande systématique, puisque j’avais déjà du travail. Et cela a grandement facilité les choses d’être à la rencontre et à l’écoute des gens, sans être forcément en attente. C’est un milieu où les gens sont débordés de demandes : les traducteurs, les rédacteurs, les illustrateurs… Aujourd’hui, c’est différent puisque mon CV est assez bien rempli. Maintenant, on me contacte parce que j’ai traduit tel ou tel auteur. Et puis je ne suis jamais arrivée en disant : « je suis traductrice, je veux une traduction. » J’ai fait tout ce qu’on me demandait. Je me rappelle avoir travaillé avec Suzanne Mayoux, la formidable traductrice de David Lodge. Elle avait besoin de quelqu’un qui connaissait les techniques de recherche et de documentation, ce qui était mon cas à cause de mes études universitaires. Donc je l’ai aidée, j’ai cherché des références pour elle. J’ai aussi relu des traductions, accompagné des auteurs dans des émissions de radio, travaillé au Salon du livre…
Est-ce que vous pensez que les choses ont beaucoup changé depuis vos débuts il y a 10 ans ?
Je ne sais pas trop comment ça se passe pour les jeunes traducteurs qui arrivent. Ce que je sais, c’est que ça a changé dans les maisons d’édition car le marché du livre est très compliqué. Un livre qui se vendait à 30 ou 40 000 exemplaires il y a dix ans se vend aujourd’hui à 10 000, et on est très content si on y arrive. C’est très compliqué même quand on a tous les réseaux. Alors effectivement, dans les statistiques, schématiquement, vous avez les trois premiers titres qui vendent à 150000 exemplaires, mais dès le quatrième, on tombe à 30 000 ! Et le cinquième, 5 000. Cela a un impact très fort sur les choix éditoriaux : on a de plus en plus de mal à publier des choses un peu exigeantes. Ceux qui s’en sortent ont de l’entregent, savent rencontrer les bonnes personnes. Sur certains CV, on voit aujourd’hui « Ecole Normale Supérieure » ou « ESSEC » : ces gens-là ont déjà des réseaux bien établis. A cet égard, le manque d’égalité des chances est dramatique : quelqu’un qui a fait l’ESSEC et qui se dit, finalement je veux écrire, se dira que la traduction peut être une bonne porte d’entrée. Et comme il a le réseau qui va bien, même si ses études n’ont rien à voir avec l’édition, il va réussir mieux qu’un autre peut-être plus talentueux, qui aura eu un parcours en fac, qui viendra de banlieue, et sans réseau… c’est incroyable.
Il ne vous est jamais venu à l’esprit de traduire d’autres langues que l’anglais ?
En fait j’ai fait de l’espagnol et du russe. Le russe, je ne l’ai pas assez travaillé, et c’est une langue vraiment difficile. Pour l’espagnol, il m’est arrivé d’y penser. Mais pour traduire, il faudrait une meilleure connaissance de la littérature, de la culture. Il faudrait tout arrêter et me consacrer uniquement à ça. Je ne suis même pas sûre qu’en dehors de toute raison financière, je serais capable d’arrêter. On le disait tout à l’heure : la traduction est une activité addictive. C’est une question d’organisation du temps aussi, de mode de vie…
Il y a d’autres choses qui me passionnent, comme l’art contemporain. Il peut y avoir des passerelles d’ailleurs : j’ai traduit, à la demande de Edmund White, un texte qu’il avait écrit pour le catalogue RMN de l’exposition Mapplethorpe. La RMN m’a donc demandé si je ne voulais pas aussi m’occuper du texte de Patti Smith ! Ce que j’ai fait avec grand plaisir bien sûr. Mais c’était un cas particulier, et cela restait des textes d’auteur.



















comment connecter avec Céline Leroy? Merci, Erika Ginsberg-Klemmt