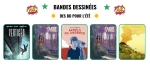[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]vant même d’évoquer la nature plurielle de la musique symbiotique du très prometteur combo DBFC, avant même de céder à la facilité de la décrire comme un hypothétique télescopage de genres, il paraît opportun de préciser que la formation cofondée par le bordelais Bertrand Lacombe et le mancunien David Shaw est avant tout le fruit d’une rencontre humaine.
Si le premier s’est surtout fait connaître à la mi-temps des années 2000, avec la parution d’un très bel album pop signé sous le pseudonyme Dombrance, porté par l’irrésistible tube radio I’m Down, le nom du second trouvera certainement un fort écho du côté des amateurs de musiques dites électroniques : pourvoyeur d’une techno âpre et délétère publiée sous les alias Siskid ou Animal Machine mais également premier guitariste de la réinvention rock du groupe Black Strobe d’Arnaud Rebotini, le britannique, installé en France depuis maintenant plusieurs années, sera l’auteur en 2012, sous son véritable patronyme, d’un excellent album d’électro-pop à la fois souple et tendue, le sombre et addictif So It Goes. Étrangement, malgré leurs hauts faits d’armes respectifs, c’est bien la collusion de leurs identités propres, bigarrées mais complémentaires, qui allait accélérer les choses pour l’un comme pour l’autre, avec la parution en 2014 d’un premier EP quatre titres commun, Leave My Room, emmené par le cauchemardesque et martial morceau du même nom.
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]D[/mks_dropcap]ans la foulée de ce très concluant premier essai, le duo se taillera très vite une réputation scénique enviable, augmentant son effectif d’un bassiste efficace et d’un batteur chevronné, histoire de donner encore davantage d’incarnation à leur formule ambitieuse : comme me disait un ami à l’époque, « DBFC sur scène, ça fait grave le job ». Deux autres maxis suivront au cours des deux années suivantes, puis viendra l’annonce, l’été dernier, de la préparation d’un premier véritable album, laissant entrevoir la possibilité d’un classique en puissance : en effet, la singularité de cette paire de passionnés tient autant dans leur appétit vorace d’en découdre avec tous les matériaux sonores à leur portée que dans leur refus de la facilité et des schémas préétablis. À l’écoute de l’impressionnant Jenks, qui sort finalement ces jours-ci, on se dit que David Shaw et Bertrand Lacombe ont fait bien plus que croiser leurs univers respectifs pour en réaliser une « simple » synthèse, qui aurait pourtant déjà eu, et pas que sur le papier, toutes les raisons d’être excitante.
DANCE BELIEF, FORCE CONTROL
Contrairement à tant de groupes ou artistes qui se targuent de croiser rock et dance en plaquant les atouts de l’un sur les forces de l’autre, pour ne parvenir au final qu’à faire couler les deux, DBFC distille avec un naturel désarmant un élixir d’une subtilité épatante sans rien gâter de son efficacité programmatique : ici, on ne décèle aucune couture ni aucun artifice, tant la cohésion qui parcourt les dix titres du disque semble travaillée par l’intelligence, sans rien sacrifier de l’urgence viscérale qui reste le coeur de leur matrice spécifique. Ainsi, du boogie poisseux et moderne de Bad River, qui marie le déhanché sexy de Marc Bolan à un riff chromé digne de Mick Ronson, jusqu’à la synth pop arrogante de New Life qui, au-delà de son titre, semble rendre hommage à la carrière entière du précurseur Vince Clarke, de la sécheresse aguicheuse de Yazoo à l’exubérance torride d’Erasure, c’est la conviction inébranlable du duo qui emporte tout sur son passage. Ailleurs, on est charmé par la pop solaire et délicatement ouvragée d’un In The Car dont la banquette arrière promet des voyages plus étourdissants que le dépaysement offert par un tour du monde, puis littéralement sonné par la charge de The Ride, qui nous embarque dans une ascension vertigineuse, encastrant avec fougue une carrosserie psychotrope sur un moteur résolument rock, ou encore hypnotisé par le très explicite Disco Coco, groove décadent et obsédant, simultanément habité par une guitare claire et entêtante et vrillé par une boucle synthétique dissonante et acide.
[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]M[/mks_dropcap]ais au-delà de ce qui fait tout l’attrait évident de cet album, du soin extrême apporté aux compositions à la richesse stupéfiante d’une production inventive mais jamais clinquante, c’est encore un autre aspect, peut-être plus étonnant, qui donne à ce Jenks toute sa noblesse altière. En effet, David Shaw et Bertrand Lacombe ont fomenté une arme de séduction massive en travaillant les registres disparates mais complémentaires de leurs voix : au timbre aigu et gracile du premier répond celui, plus grave et autoritaire, du second. Ainsi, en point d’orgue du déploiement implacable du morceau-titre placé en ouverture, c’est ce mariage inattendu qui procure au climax toute sa force suggestive, avec un chant hypnotique déroulé comme un mantra invincible : « We’re all part of the beautiful now » (« Nous faisons tous partie de ce bel instant présent »). Même sur les sept minutes du redoutable Autonomic, à la basse puissante et aux glissements rythmiques évocateurs, ce sont les parties vocales qui semblent être les vraies porteuses d’une lubricité extatique. Dans ces moments-là, on a l’impression que les DBFC se rêvent en Beach Boys du bitume, troquant le soleil californien pour l’épilepsie des stroboscopes, et la langueur des plages de la West Coast pour la promiscuité des clubs de Berlin.
DRY BODY, FRIED CELLS
Et si la pression se relâche en bout de course, ce n’est pas absolument pas le cas de la tension intrinsèque à leur musique : sur un judicieux brelan final, David Shaw et Bertrand Lacombe offrent une facette plus intimiste mais pas moins prenante de leur association de bienfaiteurs. Tandis que Staying Home, avec son émouvant choeur en pleine descente et sa rythmique chaloupée à la Stereo MCs, aurait pu dissuader les Ride d’Oxford de tenter tout retour discographique, le plaintif Sinner, aux accents quasi-mystiques, nous entraîne vers une conclusion aussi épique qu’introspective : les neuf minutes psychédéliques de The Rest Of The World, traversées par une cavalcade salvatrice, apportent en toute fin d’album une délivrance saisissante, comme un contrepoint indispensable aux excès caractérisés par les titres qui ont précédé.

[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]A[/mks_dropcap]près l’écoute d’un tel disque, qui ne se contente pas d’additionner les talents de ses auteurs mais propose une audacieuse troisième voie, j’ai eu envie de rencontrer les deux acolytes pour tenter de comprendre comment leurs parcours respectifs ont pu les conduire à s’accepter l’un et l’autre, au-delà d’une alliance de circonstance et de ce qui aurait pu n’être qu’une collaboration épisodique, pour faire de DBFC leur principale occupation et leur projet phare.
DO, BE, FEEL, CLEAR
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet entretien, réalisé le vendredi 19 mai dernier, par un bel après-midi ensoleillé, s’est déroulé dans une ambiance très similaire à celle de l’album de mes deux interlocuteurs : chacun finissant harmonieusement les phrases de l’autre, tout en prenant soin de ne pas l’interrompre, manifestant tout autant son caractère propre que la profonde estime de celui de son partenaire. Pendant cette grosse demi-heure, j’ai eu le sentiment d’avoir été admis dans leur club, en tant que témoin privilégié d’une relation de travail aussi fructueuse que devenue indispensable à leur propre équilibre intime.
Comment vous êtes-vous rencontrés ? Chacun de vous connaissait-il auparavant le travail de l’autre ?
David Shaw (à Dombrance) – Vas-y toi, tu le racontes bien (rires).
Bertand « Dombrance » Lacombe – Nous nous sommes rencontrés il y a quatre ans, par l’intermédiaire de notre tourneur commun, Antonin, qui m’avait envoyé l’album de David (So It Goes, sous alias David Shaw & The Beat, ndlr). J’ai beau être quelqu’un d’assez difficile, dès la première écoute, j’ai trouvé le disque incroyable. J’ai tout de suite rappelé Antonin pour lui demander d’organiser une rencontre. À l’époque, David galérait un peu pour trouver quelqu’un qui puisse l’accompagner sur scène pour défendre cet album. J’ai donc joué des coudes pour lui faire comprendre que j’étais « son homme » (sourire). On avait dix jours pour préparer un concert pour les Bar en Trans à Rennes.
DS – Le casting de musiciens qui m’entourait alors pour mettre en place ce live était très sympathique, mais ça ne fonctionnait pas. Alors que la scène est quelque chose de très important pour moi, et pour Bertrand aussi d’ailleurs. Je me rappellerai toujours du soir où je suis rentré chez moi en larmes, alors que je commençais à vraiment paniquer : je débordais d’envie et je savais où je voulais aller musicalement, mais je n’arrivais pas à l’exprimer. Ma copine ouvre la porte et, me voyant dans cet état épouvantable, me dit de me ressaisir illico, que Bertrand et Antonin sont là, à m’attendre sur le canapé. Bertrand a été très positif, plein de bonnes vibrations, alors que je luttais pour me contenir. Il était au courant de la situation, et m’a convaincu de le laisser revenir le lendemain pour voir ce qu’on pouvait faire ensemble. Il est arrivé à dix heures du matin, et on s’est mis derrière les machines. Je ne lui ai donné que quelques vagues indications, car j’avais déjà compris que c’était un super musicien. Et à la fin du premier morceau joué ensemble, on s’est mis à rire comme des gamins. C’était un rire nerveux, libérateur, et je lui ai demandé « mais où donc étais-tu caché pendant toute ma vie ? » (sourire). Évidemment, nous avons ensuite donné les concerts prévus, mais le plus intéressant, c’est qu’à partir de ce moment-là, jusqu’à maintenant, et même dans ce qui arrivera par la suite, j’en suis sûr, notre rapport est d’une immense fluidité. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, nous sommes humains, mais que ce soit sur le plan musical quand on travaille ensemble ou au niveau personnel, nos réflexes sont synchrones. C’est presque une valse : l’un leade l’autre, sans prendre le pas sur lui. Nous vivons pour ainsi dire l’un de l’autre. Je pense aussi que ça tient au fait qu’à notre niveau, nous maîtrisons toute la chaîne de production du début à la fin, et que bien que nous soyons complètement différents, notre complémentarité tourne à plein régime. Voilà où nous en sommes aujourd’hui, ça fait quatre ans que ça dure, et pour reprendre une formule que répète souvent Bertrand, « les planètes se sont alignées ». C’est un vrai couple en fait, qu’on vit avec beaucoup de fierté : c’est quelque chose de magnifique et rare, et parce que c’est rare, on sait aussi que c’est précieux, on le chérit, on l’entretient. Parce que notre environnement est ce qu’il est, parce que la vie est telle qu’elle est, on fait attention à l’amour qu’on a l’un pour l’autre.
Vous créez ensuite DBFC : était-ce dès le départ une évidence pour vous d’aller au-delà d’une formule en duo et de former un vrai groupe, pour le studio comme pour la scène ?
BL – Oui, parce c’est notre culture, et que dès nos tout premiers morceaux en commun, nous avions cette volonté-là. On trouvait intéressant de travailler avec plusieurs voix, d’avoir ce mélange entre électronique et organique. Après les choses ont évolué, mais ce que nous aimons avant tout aujourd’hui, c’est être libres. Il n’y a plus de dogme chez DBFC : on a des guitares, des synthés, une batterie, une basse, un ordinateur, tout ce qui nous tombe sous la main. Le moteur du groupe c’est nous deux, j’ai fini par prendre en charge la basse et on a quelqu’un qui s’occupe davantage des claviers. On a aussi notre mascotte Guillaume Rossel à la batterie, qui est prêt à intervenir en studio s’il le faut.
DS – C’est notre Keith Moon à nous.
BL – Oui, mais alors dans tous les sens du terme (rires).
DS – Mais c’est aussi ça la beauté de la personne. Encore une fois, on parle de liberté, mais ça englobe aussi cet aspect-là. Ce n’est pas juste une question d’instrument, ça ne se réduit pas à ça.
BL – C’est un électron libre assumé du projet : il est là pour être le batteur et… pour faire la fête, comme on sait si bien la faire (sourire). Même si le noyau dur, ça reste David et moi.

Le graphisme des pochettes de vos premiers maxis évoque celui des écussons d’équipes sportives. Le sigle DBFC signifie-t-il « David & Bertrand Football Club » ?
DS – C’est ce que tout le monde dit. Mais ce n’est pas ça (sourire).
BL – On aime bien le côté un peu mystérieux de ce nom, que les gens puissent y projeter ce qu’ils veulent. Notre petit jeu en ce moment, c’est de demander à ceux que l’on croise ce qu’ils en pensent.
DS – On sélectionne leurs suggestions, et on fera un poster avec les propositions qu’on aura retenues, qui inclura aussi la vraie signification du nom. Enfin, disons plutôt qu’on révélera quels sont les quatre mots qui le composent, plus exactement.

Le terme de fusion vous convient-il lorsqu’il s’agit de décrire la musique que vous faites ?
DS – Personnellement je n’aime pas ce que ça m’évoque, mais je laisse Bertrand te dire ce qu’il en pense.
BL – Parce que je le connais bien, je sais que David n’aime pas parce que ça lui rappelle ces centaines de groupes qui ont singé Rage Against The Machine ou les Red Hot Chili Peppers durant les années 90. Après ce qui est important c’est ce que tu désignes par ce terme. Pour moi, la musique c’est de toute façon de la fusion. Depuis la nuit des temps, les compositeurs s’imprègnent de ce qu’ils entendent pour essayer d’en faire leur propre truc, en mélangeant plein de petits ingrédients. Alors c’est vrai que si tu écoutes notre album, ça brasse beaucoup de choses, il y a plein d’influences…
DS – … et c’est normal qu’il y en ait, vu qu’on écoute énormément de musique tous les jours, depuis que nous sommes gamins. Mais il n’y a rien de prémédité dans notre démarche, dans le sens où on ne rentre jamais en studio en se disant qu’on va faire un morceau d’un type prédéfini. Pour nous ça vient naturellement, on considère par exemple les synthés comme des instruments, au même titre que les guitares, et c’est lorsqu’on entend un plan ou un riff particulier, au moment où on l’interprète, qu’on décide de l’utiliser parce qu’il va servir notre propos et mettre en valeur la façon dont vous voulons que le morceau sonne.
BL – Nous sommes surtout guidés par nos émotions, il ne nous appartient pas d’analyser le résultat, c’est davantage un travail de journaliste (sourire).
C’est ce que j’aime beaucoup dans votre album : on se dit que c’est un disque extrêmement référencé, alors qu’il est très difficile de mettre le doigt sur un nom ou un courant précis.
DS – Quelque part, c’est la preuve que c’est complètement digéré (rires). Nous sommes sincères, notre album n’est pas une compilation liée à un trip nostalgique.
BL – C’est vrai que ce n’est pas nostalgique, mais même si je n’ai pas envie de reproduire quelque chose au premier degré, j’aime bien l’idée de pouvoir piocher, de manière instinctive et inconsciente, dans la multitude de musiques que j’ai écoutées et que j’aime, et d’être libre de naviguer là où j’ai envie d’aller. Et je pense que pour David c’est pareil (il acquiesce) : on aime cette liberté-là.
J’ai particulièrement été marqué par le titre The Ride, qui est une sorte d’hybride entre une base très rock’n’roll et un élan krautrock, avec ce son de guitare qui évoque fugitivement celui de Michael Karoli sur le Mother Sky de CAN (groupe allemand mythique des années 70, ndlr).
DS – On a voulu faire quelque chose à notre sauce, sans tomber dans l’exercice de style. On ne s’est pas dit « faisons un morceau kraut », sinon ça nous aurait profondément ennuyés.
BL – Il faut ajouter que c’est un morceau qui a une empreinte émotionnelle particulière pour nous, parce qu’il nous est arrivé beaucoup de choses au moment où nous le préparions. Je ne sais pas si l’auditeur peut s’en rendre compte et le ressentir, mais pour nous ce titre est vraiment très fort de ce point de vue-là. Il ne se limite pas à ce qu’il peut évoquer comme référence musicale, le plus important c’est ce qu’il raconte, et la façon dont on l’a… craché. En deux jours.
DS – On a fait toute cette première partie, qui est assez nerveuse, dans une tradition un peu « rockabilly », pour arriver sur une deuxième section qui est extrêmement dense et intense. Et c’est aussi ça que j’aime bien : il y a des gens qui adorent ce morceau, et d’autres qui me disent ne pas arriver à rentrer dedans.
BL – Quand on le joue sur scène, après l’introduction très noise et quand la rythmique part, j’arrive à complètement décrocher de ce qui se passe devant moi, les lumières, le public… Je sais dès le départ que je vais pouvoir m’abandonner sur ce morceau-là. Et ça, en tant qu’artiste, c’est ce qu’on recherche le plus, et qui est le plus compliqué à atteindre en live, parce qu’il y a beaucoup d’aspects techniques à maîtriser. Mais avec The Ride, je sais qu’on peut arrêter de réfléchir et juste… éprouver.

Lorsque l’on connaît vos antécédents respectifs, on a tendance à imaginer que Bertrand amène l’élément pop-rock et David la partie plus électronique de votre musique. La réalité est-elle plus complexe ?
BL – Forcément, il y a un peu de ça, mais tout le monde touche à tout. Pour parler de la dimension pop-rock, David et moi sommes tous les deux friands de hooks (motifs mélodiques ou rythmiques destinés à capter l’attention de l’auditeur, ndlr), qui est un truc pop par excellence. Sans parler de changer la face du monde, on aime bien l’idée que notre riff ou notre petite mélodie vocale puisse tenir à cette petite originalité qui, même si elle peut te faire penser à autre chose, apporte quand même quelque chose de frais. D’une manière plus générale, je vais peut-être avoir tendance à vouloir structurer davantage les choses, de façon plus « classique », autour de la formule couplet/refrain …
DS – … alors que moi je suis plutôt dans le chaos (rires). J’ai plus une culture punk de ce point de vue-là.
BL – Je comprends qu’on puisse se dire, à l’écoute de notre album, que l’un ou l’autre a plutôt apporté tel ou tel aspect, mais il n’y a rien d’arrêté, ce ne sont que des tendances. Je peux très bien avoir eu une idée folle et David avoir apporté un plan plus carré. Chacun de nous deux est capable de surprendre l’autre sur son « terrain », ce qui est quelque chose d’excitant aussi. Et puis on a eu beaucoup de moments de souplesse : les trois quarts de l’album, ce sont des jam sessions. Quand on enregistre, on ne se pose pas la question de savoir qui apporte quoi, on se lance directement.
DS – Je dois aussi avouer que c’est Bertrand qui m’a réconcilié avec la pop, que j’ai longtemps boudée. J’allais plus volontiers vers des choses plus industrielles, comme Throbbing Gristle et autres, justement parce que j’étais en recherche de non-format et de son pur, au sens strict du terme. Quand nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes beaucoup apportés en termes de complémentarité, en se faisant découvrir ou redécouvrir beaucoup de choses. Ça a été la plus-value de notre rencontre et donc, forcément, de notre travail.
BL – Ça se ressent aussi sur l’album, puisque si certains morceaux sont très classiques dans leur structure, d’autres sont complètement éclatés sur sept à huit minutes. Encore une fois, sans que ce soit calculé, c’est marrant de se dire qu’on a digéré tout ça et qu’on peut faire voyager les gens dans n’importe quelle direction. Je pense que c’est très fatigant de se cantonner à ne faire « que » de la musique pop, que du couplet/refrain, mais je pense que ça l’est également si l’on ne fait que du noise ou de l’expérimental…
DS – … et peu de gens savent bien le faire. Faire du Throbbing Gristle aujourd’hui, ça n’a aucun intérêt. Ce que je trouve important, c’est que même sur les titres les plus pop de notre album, on a toujours une recherche au niveau de la production : même s’il y a les gimmicks que Bertrand évoquait tout-à-l’heure, on veut qu’il y ait aussi ce petit truc en plus qui fasse tilter les gens et qu’ils identifient notre griffe.

Jenks est une autoproduction. Vous avez vraiment réalisé chaque étape seuls ?
DS – On a tout fait à deux, on a juste fait appel au grand Frédéric Soulard de Maestro, qui a travaillé avec Poni Hoax, pour mixer l’album.
BL – Vu qu’en général on fait tout le reste seuls, ça peut être vraiment lourd, et on avait besoin de…
DS – … prendre du recul, tout simplement. Que nous ayons une vision c’est une chose, mais on voulait aussi prendre un peu de distance et retrouver une certaine excitation. Comme dit Bertrand, on est tellement à fond dans ce qu’on fait, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, entre l’écriture et la production, chanter et arranger, qu’on aurait facilement empilé quinze versions différentes par morceau au moment du mixage. On a préféré aller en studio avec quelqu’un qu’on aime beaucoup, avec des pré-mixes qui étaient déjà très proches de ce qu’on voulait au final. Ça nous a empêchés de stagner et redonné de l’adrénaline.
Bertrand, vous avez pratiqué le violoncelle durant huit ans au conservatoire. De quelle manière cette expérience influe-t-elle sur votre travail au sein de DBFC ?
BL – Ce qui a changé ma vie c’est de faire de la musique, et d’en faire jeune, puisque j’ai débuté à l’âge de six ans. Quand tu commences le violoncelle, tu fais surtout un son de grincement de porte (rires). Mais je me rappellerai toute ma vie de la première fois où j’ai eu des frissons en jouant de la musique, à huit ans. J’imagine que les gens qui m’écoutaient jouer mon morceau devaient trouver ça affreux, mais je sentais cette émotion-là me parcourir. En un mot, je vibrais. Ce truc-là a changé ma vie, et c’est quelque chose que je partage aujourd’hui avec David, puisque c’est un vrai marqueur pour nous lorsque l’on travaille en studio : ça lui arrive de me montrer qu’il a des frissons en écoutant ce qu’on joue. C’est quelque chose qui m’accompagnera jusqu’au bout, ça dépasse ces histoires d’influences, de production, je te parle d’un truc qui se passe et qui te submerge d’émotion.
DS – Ce n’est plus intellectuel mais purement… sensoriel.
BL – J’ai toujours été un cancre, donc je l’étais aussi au conservatoire, mais j’étais amoureux de musique. J’étais un mauvais violoncelliste, en tout cas je ne travaillais pas assez, mais c’est un instrument qui permet de vraiment développer ton oreille. Comme tous les instruments sans fret, si tu joues un peu à côté, ça sonne faux. Donc très jeune, ça t’enseigne la justesse et la discipline. Bon, aujourd’hui, tout le bagage que j’aurais dû garder pour m’aider, je l’ai zappé et je suis incapable de lire une partition. Il faut dire que quand j’ai eu quatorze ans, j’ai découvert Pink Floyd et les pétards, donc j’ai dit au violoncelle de dégager (sourire).

Lorsque le maxi Autonomic est sorti en juin 2016, le bruit courait que votre premier album était imminent, et celui-ci sort finalement un an plus tard. Vouliez-vous vraiment prendre le temps de peaufiner les choses ?
DS – Oui et non. On tournait déjà beaucoup, ce qui est très éprouvant et, vu ce qu’on donne sur scène, très fatigant physiquement. Le côté rock’n’roll, ça a l’air facile mais c’est quand même beaucoup de travail (sourire). Et puis si on a écrit les morceaux sans trop de contraintes ni de difficultés, ça a pris un peu plus de temps de les amener où on voulait d’un point de vue sonore.
BL – Ensuite, arrivés à l’été, nous nous sommes dit que nous pourrions attendre et faire de nouveaux morceaux à la rentrée. C’est là qu’on a fait Disco Coco, The Ride, In The Car et The Rest Of The World. On ressent un besoin permanent de fraîcheur, et même si nous avions plein de morceaux prêts, nous avons préféré retourner en studio sans nous précipiter, pour voir ce qui en sortirait. Et on a eu de la chance, puisqu’en très peu de temps nous avons fait plusieurs titres qui nous plaisent vraiment.
DS – Beaucoup de gens nous disent que ça paraît facile à faire. Pourtant ce n’est pas une question de facilité, on constate juste que ça marche entre nous. Et je pense que ça marchera encore parce que nous avons énormément de choses à dire tous les deux. C’est à la fois un bonheur et un travail quotidien : nous sommes constamment excités à l’idée d’être ensemble.
Cela a-t-il un sens important pour vous de sortir un long format en 2017 ? Cherchiez-vous à raconter une histoire en suivant un fil conducteur tout au long du disque ?
BL – Le plus important, c’est de respecter le format dans lequel tu te lances. Si tu veux faire un album, alors fais-en un vrai. On aimait bien l’idée de jongler avec ce côté « classique », avec un début, un milieu et une fin. Mais franchement tout est possible aujourd’hui dans la pop, et l’a toujours été : tu peux sortir des titres au fur et à mesure, mais si tu sais que tu fais un album, ça va raconter une histoire, et tu dois te mettre à la place de l’auditeur. Faire juste une compilation de titres, je trouve que ça n’a aucun intérêt. J’aime les disques qui possèdent un fil narratif.
DS – Je vomis notre époque de zapping permanent, mais à aucun moment on ne s’est dit qu’il FALLAIT faire un album : on VOULAIT faire un album, parce qu’on a cette culture-là, assez traditionnelle. À titre de comparaison, je ne crois pas être un vieux con si je dis que lire une seule page d’un livre, ça ne m’intéresse pas (rires).
BL – Après, tu peux écrire de très bonnes nouvelles, mais un recueil de nouvelles, ce ne sera pas un roman.
Vous avez repris sur l’album un extrait de votre premier EP, Staying Home, mais pas Leave My Room qui en était pourtant le titre phare. Est-ce parce que ce dernier était trop électronique, et ne convenait pas au cadre narratif que nous évoquions ?
BL – Non seulement Leave My Room ne convenait pas au cadre de l’histoire de l’album, mais il faut ajouter que c’est un morceau qui a déjà bien vécu sa propre vie.
DS – Et puis c’était un titre un peu facile, non ? Si les gens le veulent, il est toujours disponible en maxi, et c’est très bien qu’il appartienne à ce segment-là de notre projet. Là, on avait d’autres choses à raconter, qui n’en sont pas forcément éloignées, mais qui marquent une évolution logique et nous n’avions pas envie de revenir en arrière.
BL – On sait très bien que les gens n’écouteront pas forcément notre album en entier, qu’ils le découperont sur des playlists ou ne mettront que leur morceau préféré, mais notre volonté artistique était de faire un disque qui raconte une histoire qui se tienne. Et ensuite on détruira tout ça pour faire autre chose (rires).
Sur le morceau-titre Jenks, vous chantez « We’re all part of the beautiful now ». Le message de DBFC est-il une sorte de « carpe diem pour tous » ?
DS – Ce n’est pas LE message à proprement parler, mais il y a une envie d’hédonisme, c’est sûr. C’est surtout une référence à tous les moments de communion qu’on a vécus, que ce soit en club, en festival ou en concert, où l’on oublie tous les codes sociaux pour se retrouver tous ensemble. Le côté physique de ce que ça provoque, ça n’a pas de prix. Même si ça paraît un peu cheesy ou naïf, ces paroles sont vraiment à prendre au premier degré.
BL – C’est pour cette raison que nous avons mis ce morceau au début de l’album, pour inviter les gens à rentrer dans notre club, dans notre univers. On prend la main des gens pour les emmener dans notre voyage, qui est fait de notre passion pour la musique, en tant que langage universel. Je pense que si on n’avait pas ça, on péterait un câble parce qu’on est trop sensible pour supporter le monde sans la musique.
DS – C’est comme parler d’amour : ça paraît naïf, mais c’est un thème inépuisable, puisque même si les scénarios sont les mêmes, les acteurs changent. Ce sera toujours la même histoire, mais sous un angle précis et des perspectives différentes.
À l’autre extrémité du disque, le morceau qui clôt l’album est d’une humeur différente des autres, comme un renoncement après les excès qui précèdent. « The rest of the world can go to hell » (« le reste du monde peut aller se faire voir »), c’est une question de survie ?
DS – On a fait The Rest Of The World après une grosse journée de studio, alors qu’on avait remis nos manteaux et qu’on était prêt à partir. Bertrand était au téléphone avec sa femme, on était en plein hiver et il faisait très froid. L’essence de la conversation, c’était qu’elle lui demandait de rentrer parce qu’il était tard, et je me suis mis à chanter ça sur une boucle qui tournait. Et « the rest of the world can go to hell », ce n’est pas dans un sens négatif ni haineux, mais le constat qu’au-delà du poids du quotidien, il faut trouver des moments pour se préserver. L’idée, c’était de dire qu’en ces instants précis, le reste du monde ne compte plus.
BL – Après quelque chose d’aussi intense, ça fait du bien de se retrouver à la maison.
Si votre tout premier single Leave My Room vous a été inspiré par un cauchemar, la musique qui parcourt votre album est-elle celle de vos rêves ?
BL – Tu viens de mettre le doigt sur la raison majeure pour laquelle ce morceau n’est pas sur l’album : Leave My Room est un morceau très sombre et spontané par rapport à ce qu’il raconte, et je pense que l’album a une couleur plus positive, mais aussi plus profonde…
DS – … parce qu’au-delà de ce qui nous lie tous les deux, qui est précieux et génial, on a aussi traversé des moments difficiles. Au-delà des événements qui nous ont tous touchés, des choses très personnelles (silence). À cette période-là de notre vie, nous avions envie d’évoquer et d’éprouver de l’amour et de la tolérance, sans être dans un trip baba cool. « Éprouvons ». Je tiens à ce terme, parce qu’on ne s’en rappelle pas toujours, ou qu’on ne l’applique pas assez.
DRIVEN
BY
FULL
COMMITMENT
BY
FULL
COMMITMENT

Jenks est une production Her Majesty’s Ship, disponible en CD, vinyle et digital depuis ce vendredi 2 juin 2017 via le label Different Recordings distribué par PIAS.
DBFC sera en concert le samedi 1er juillet 2017 à Clermont-Ferrand (Coopérative de Mai) dans le cadre du festival Europavox. D’autres dates à venir seront annoncées ici.
Site Officiel – Facebook Officiel
Photo bandeau © Chris Almeida.
Je remercie chaleureusement Valérie Talagas de PIAS, pour sa confiance et son professionnalisme, et je dédie cet article à Daniel Dauxerre, qui m’a fait découvrir tant de belle musique, depuis le début des années 1990 jusqu’à nos jours.
« We wanna be free to do what we wanna do. »