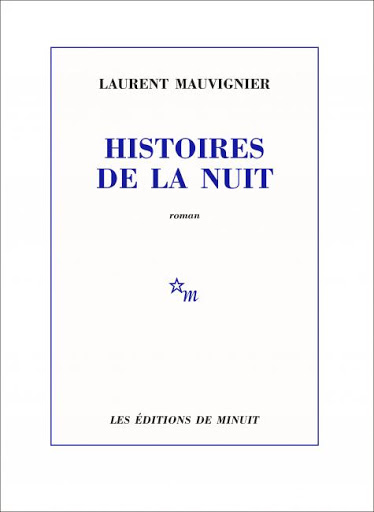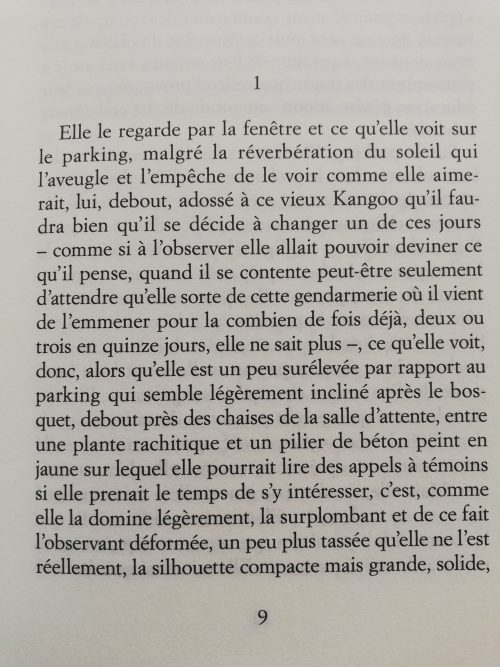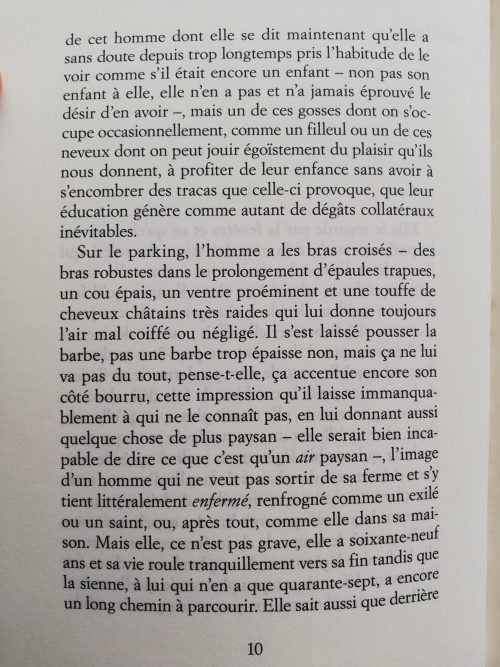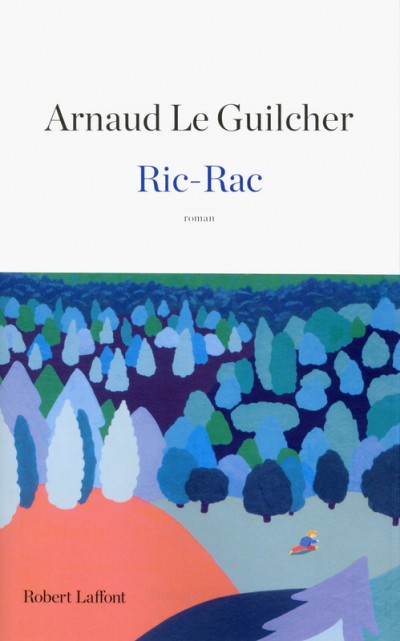LA CHRONIQUE
[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]
Chez Laurent Mauvignier, l’écriture est affaire de tension. C’est elle qui va chercher et impliquer le lecteur. Dans son nouveau roman Histoires de la nuit, cette tension est perceptible dès l’incipit. Le lecteur est emporté par le souffle des phrases et la virtuosité de la langue. On comprend donc bien que l’auteur s’empare du genre du thriller. L’histoire se concentre sur quelques personnages. D’un côté on trouve les Bergogne avec Patrice le mari, sa femme Marion et leur fille Ida ; de l’autre leur voisine Christine. Nous sommes le jour de l’anniversaire de Marion et tout semble aller pour le mieux. Si ce n’est ces lettres anonymes reçues par Christine. Et ces gens qui semblent rôder.
Le roman est extrêmement bien construit avec des chapitres équilibrés, ce qui confère un rythme haletant. La fin laissera le lecteur véritablement à bout de souffle. Le thriller est pour Laurent Mauvignier une manière d’explorer en profondeur les mobiles et les actions de ses personnages. Il évite toute simplification et cherche ainsi à creuser leurs « tropismes », leurs motivations souterraines et inconscientes.
Toute la force de l’écriture de Laurent Mauvignier, c’est toujours de partir de situations concrètes. C’est une écriture de la sensation et des perceptions. Ce qui est passionnant dans Histoires de la nuit, c’est la manière dont l’auteur va puiser dans les ressorts du thriller pour travailler sur l’acte même d’écriture. Cette tension qui règne autour des personnages éclaire son travail sur l’aspect organique de l’écriture. Laurent Mauvignier est un romancier rare qui possède l’art de faire naitre le texte à lui-même. Il sait faire émerger quelque chose à travers la nuit. Autant d’histoires pour faire naitre une émotion. Celle de relier l’auteur et ses personnages au lecteur.
L’ENTRETIEN
[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]
En dehors du fait que ce roman soit le plus long et le plus ample jamais écrit, il semble aller le plus loin possible dans le fait de repousser les limites de la tension narrative. L’écriture du roman a-t-elle été particulièrement physique, au sens où cette tension permanente vous amène à repousser vos limites des conditions physiques d’écriture ?
Paradoxalement non, c’est un livre qui s’est écrit dans un relatif calme – c’était une course de fond, un problème d’endurance et de ténacité plus que de force. Il a été écrit de manière très organisée. Il se trouve que j’avais écrit son scénario pour réaliser un moyen métrage, et que j’ai commencé à écrire le livre en me demandant ce que ce serait un roman à partir de ce scénario, en me fixant comme contrainte d’étirer au maximum, de prendre le temps, de creuser la durée, en donnant tant de pages par séquence. Donc, quelque chose d’assez programmatique, ce qui m’a permis de ne pas me faire dévorer par ce monstre. À la fin, j’ai surtout récrit, c’est-à-dire beaucoup retiré, enlevé, à l’intérieur des phrases, des excroissances, des longueurs, des redites qui ne produisaient pas d’effets esthétiques satisfaisants, qui alourdissaient, mais rien sur la partie narrative, qui du coup n’était pas tant mon problème – mais l’intrigue n’est jamais vraiment le problème principal d’un roman. C’est une façon de faire qui a été très jouissive avec ce livre, elle a réglé la question de l’histoire, tout était sur l’écriture, la durée des actions et des non-actions, les personnages, comment les nourrir de l’intérieur, enrichir leurs histoires, leurs vies. C’était un problème de patience et d’énergie, qui a été résolu en domptant le problème de la durée, parce que c’était construit dans le temps, chaque jour sa partie de chapitre. Un vrai plan de combat.
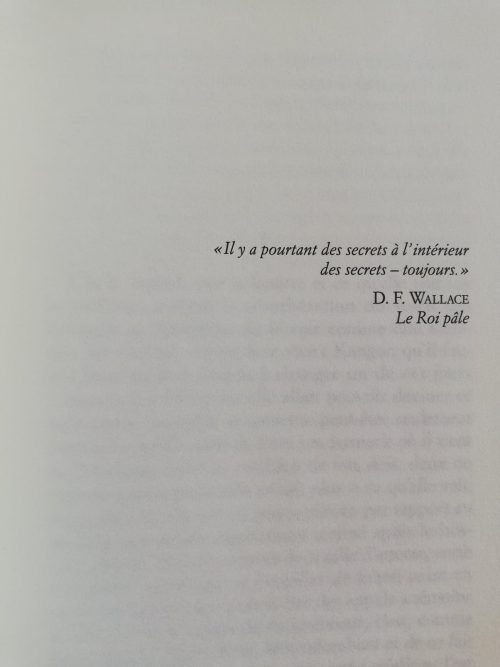 En citation liminaire, vous citez une phrase du romancier américain David Foster Wallace, extrait de son roman Le Roi pâle: « Il y a pourtant des secrets à l’intérieur des secrets-toujours ». N’est-ce pas là votre ambition de romancier d’aller, sans jamais juger vos personnages, chercher à saisir et à déplier toute la complexité d’un être ?
En citation liminaire, vous citez une phrase du romancier américain David Foster Wallace, extrait de son roman Le Roi pâle: « Il y a pourtant des secrets à l’intérieur des secrets-toujours ». N’est-ce pas là votre ambition de romancier d’aller, sans jamais juger vos personnages, chercher à saisir et à déplier toute la complexité d’un être ?
Tout à fait. C’est l’intérêt majeur quand on prend un genre comme le thriller, et même comme un sous-genre dans le thriller, qui s’appelle le home invasion movie : on a tellement affaire à des clichés, que la seule question qui va c’est : comment fissurer les stéréotypes narratifs pour aller voir, derrière, si de l’humain est possible, si la vie est possible. Ainsi, tout le travail consiste à déconstruire des clichés pour en faire des personnages, et construire suffisamment les personnages pour en faire des personnes : le vrai trajet d’un livre, pour moi, c’est toujours celui-ci. C’est que je crois que le roman a cette puissance très rare aujourd’hui, complètement à contre-courant, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir proposer de la nuance et de l’opacité, dans le sens où il peut creuser et cerner, et donner à voir, entendre, ressentir, les parts sombres et les parts lumineuses des individus, et tout le chemin qui sépare et relie l’obscurité à la luminosité de chacun, toute son épaisseur, qui est celle du temps, la traversée souterraine d’une histoire. Le roman, en effet, peut déployer toute l’épaisseur d’un être – sa complexité psychique, sociologique, culturelle, mais aussi celle liée à son histoire, à la persistance du passé dans le présent.
Chacun de vos nouveaux romans semblent souvent s’inscrire en contre-point de votre roman précédent. Dans Continuer, paru en 2016, une mère partait au Kirghizistan avec son fils afin que ce dernier puisse se reconstruire alors que dans Histoires de la nuit, le lieu de l’action est circonscrit à deux maisons, celle de Christine, la peintre, et celle de la famille Bergogne. Avez-vous ainsi cherché à épuiser toutes les possibilités de décrire un lieu ?
Mes premiers livres se passaient dans des maisons. Des huis clos familiaux, dont, au fil du temps, j’ai voulu me libérer en écartant les murs. Ça a commencé par Dans la foule, où j’ai choisi un roman ample, dont je me suis aperçu en le terminant qu’il reprenait pourtant la forme du huis clos : même à soixante mille personnes, un stade représente un espace circulaire, fermé sur lui-même. Puis il y a eu Autour du monde, qui se passait partout sur la planète au moment du tsunami au Japon, en 2011. Je me suis aperçu que cette tentative d’ouverture était aussi vaine que la précédente : je travaillais avec mon planisphère punaisé, et j’organisais l’espace comme si chaque continent, à la fin, était une pièce de la grande maison Terre. À la neige russe répondait le soleil de Jérusalem, mais au bout du compte j’ai fini par prendre conscience que décidément, c’était encore, d’une certaine manière, un huis clos. Continuer était une excroissance de cette tentative, ou plutôt une focalisation sur ce qui aurait pu être un épisode de Autour du monde. Il s’agissait cette fois encore de repousser les murs, mais j’avais conscience d’écrire un huis clos à ciel ouvert. La première partie, à Bordeaux, l’espace clos était là de façon très volontaire, comme un contrepoint à l’espace kirghize. Avec Histoires de la nuit, j’assume comme jamais auparavant que mes livres sont des livres qui ont à voir, sans doute, avec l’enfermement, la peur de l’enfermement, comme ils ont tous – je crois que pas un seul n’échappe à la règle et celui-ci la développe considérablement – tous, une scène de cuisine, une scène de repas. Mais que le lieu soit ouvert ou fermé, immense ou très réduit, ce qui compte, c’est comment il est en phase avec ce que le roman dessine. De ce point de vue, Continuer et Histoires de la nuit sont les deux bornes d’une même vision.
À la lecture d’Histoires de la nuit, on pense à l’écriture de Claude Simon. En effet, dans ce roman, l’écriture est pareille à un corps conducteur, comme si votre écriture était un courant qui passait d’un lieu à l’autre, de l’histoire d’un personnage à l’histoire d’un autre personnage. En quoi vous inscrivez-vous dans cette dynamique ?
C’est une question qui me tient particulièrement à cœur. Dans mon premier roman, Céline, la cousine du personnage principal, prend en charge la parole du mort pour expliquer son vœu, tout à la fin du roman : parler une langue comme une seule parole qui circulerait entre nous tous, comme une seule voix. Je ne me souviens plus de la formule, mais c’était assez programmatique, même si bien sûr, ce sens programmatique m’est apparu bien après avoir écrit le livre. C’est aussi quelque chose que j’ai eu beaucoup de mal à faire comprendre avec Autour du monde. On m’a beaucoup soupçonné d’avoir lié artificiellement des histoires autonomes autour du tsunami japonais, d’avoir déguisé en roman des nouvelles. Pour moi, ce qui fait roman dans ce livre, c’est précisément de considérer l’écriture comme ce corps conducteur – comme l’eau du tsunami – qui propulse, à travers sa dynamique, un courant qui circule d’un personnage à l’autre, d’une histoire à l’autre. La figure de Claude Simon est bien sûr fondamentale sur ce point, mais il y a un rapport à l’écriture qu’on trouve chez beaucoup d’autres auteurs, c’est plutôt une façon d’attaquer la langue, par des phrases longues qui veulent embrasser plusieurs éléments de réel : Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Proust mais bien sûr aussi Claude Simon, Thomas Bernhard, Lobo Antunes, Javier Marias, Antonio Muñoz Molina, László Krasznahorkai et d’autres encore, qui peuvent être assez différents les uns des autres par ailleurs, ont tous, je crois, travailler à faire de leur écriture un corps conducteur.
Ce roman, à l’instar de toute votre œuvre, est travaillé par l’idée du souffle et de la suffocation. Autant celui des personnages qui vont se battre pour rester en vie que le lecteur qui est littéralement à bout de souffle à la fin des phrases et de chapitres. Est-ce que ce souffle représente pour vous le souffle même de l’écriture qui vous porte dans travail ?
Oui, il y a quelque chose que je découvre de livre en livre, qui se joue entre la violence faite aux corps, où la question du souffle et de la mort, de l’étouffement est très liée à l’écriture elle-même. J’ai compris après coup que pour Dans la foule et Ce que j’appelle oubli les protagonistes étaient confrontés à la même mise à mort : l’étouffement par compression de la cage thoracique. C’est ce livre, Ce que j’appelle oubli, qui est sans doute au plus près de votre question, celui qui en serait la réponse incarnée : aucun point, le point m’étant apparu avec ce livre comme une chose impossible, comme l’incarnation de la mort elle-même, de la finitude, alors que toute la vie tient dans le souffle, jusqu’à l’épuisement ultime. Dans Histoires de la nuit, le retour à la vie de l’un des personnages se fait au contraire par des phrases très courtes, nominales le plus souvent. C’est qu’il s’agit de montrer que le personnage revient pas à pas à la vie, comment la vie remonte en lui, comment il s’arrache à la mort.
[one_half]
[/one_half][one_half_last]
[/one_half_last]
Dans ce roman, tout comme dans vos précédents, le lecteur a une place privilégiée dans l’histoire à laquelle il assiste. Nous sommes quasiment à bout de souffle à la fin. Est-ce pour vous toujours important d’impliquer à ce point le lecteur dans vos romans ?
Il y a cette citation que j’aime beaucoup, de Kafka, qui nous dit qu’un livre doit être comme un coup de poing sur la tête pour nous réveiller. Je pense qu’un livre, bien sûr il doit nous divertir et le lecteur n’est pas masochiste au point de subir sans éprouver la moindre joie, mais tout de même, le livre n’est pas qu’un divertissement, il est aussi un avertissement, il doit vous mettre suffisamment K.O, il doit vous traverser, vous chambouler, c’est-à-dire littéralement vous bouleverser. Un livre, c’est d’abord l’expérience d’une traversée pour le lecteur, d’une rencontre avec ses propres limites, avec celles des autres, une rencontre avec de l’altérité. C’est pour cette raison qu’il n’y a rien de plus dur à décrire que les bons sentiments – et je ne crois pas du tout qu’on ne fasse pas de bonne littérature avec les bons sentiments, simplement ils offrent des difficultés littéraires très difficiles à traverser, car comme disait Tolstoï toutes les familles heureuses se ressemblent, toutes les familles malheureuses sont uniques, souvent donc plus intéressantes. Mais ce qui compte, c’est de partager cette traversée de l’âme humaine, de la sociologie à la psychologie, jusqu’à ébranler ou mettre en danger le lecteur, en venant le chercher à un endroit de lui-même qu’il avait mis, sinon en jachère, du moins en repos.
Comme cela a été indiqué avant, un de vos personnages, Christine, est peintre. On trouve de très beaux passages sur l’acte de peindre, à l’image de cet extrait qui se trouve au début du roman : « Ce bleu, ce rouge, ce jaune orangé et ces coulures, ces taches vertes d’à-plats, de glacis, et ces formes brouillonnes, bouillonnantes, ces corps et ces visages qui surgissent d’un fond brun sombre et profond, d’un halo mauve et comme luminescent ou au contraire brossé, rêche, rocailleux, ténébreux, ces formes arrachées à l’obscurité par des éclats colorés ; des paysages et des corps, des corps qui sont des paysages, des paysages qui sont autre chose que des paysages mais des vies organiques, minérales, proliférant, envahissant l’espace, se répandant sur les toiles très grandes qu’elle peint – le plus souvent des formats carrés de deux mètres, parfois moins, parfois rectangulaires, mais alors verticaux et presque jamais horizontaux. » La manière dont Christine peint, n’est-elle pas proche de votre manière d’écrire, au sens où votre écriture restitue ce qui est de l’ordre de l’organique, de la vision et de la perception ?
Bien sûr la tentation est forte de voir la peinture comme elle est décrite dans le livre comme une sorte de métaphore de l’écriture, et la figure de Christine comme une métaphore de l’artiste et de l’écrivain est tout aussi tentante, et sans doute assez juste, même si pas complètement. L’écrivain, il est vrai, fonctionne comme le peintre, il embroussaille avant de débroussailler, il accumule les couches, puis joue avec les matières, repentirs, retours, etc. Et ce qui est très juste, c’est le rapport organique – les mots, les phrases, leur déroulement et leur enroulement autour d’une image, d’un mot, sont tout à fait des phénomènes qui fonctionnent de manière organique – mais traiter de la peinture dans un roman est une chose particulière, comme l’art ou la pratique d’un art. C’est toujours infiniment difficile, car on tombe vite dans des métaphores trop visibles, et si le procédé est trop transparent alors il devient factice et ennuyeux, on aimerait alors autant que les écrivains assument des écrivains comme personnages, plutôt que des faux peintres ou des faux musiciens pour parler de leur pratique en général. Dans le cas présent, je voulais que la peinture soit très visuelle et basique dans des effets de matière et de couleur, qu’elle ait quelque chose à dire de l’art peut-être, mais qu’elle soit d’abord repérable comme matière organique, comme le morceau de viande saignant qu’on donne au chien, comme les morilles et la sauce qui dégouline, etc. C’est-à-dire que la peinture entre ici dans une composition globale de la matière, ou de la texture du livre, comme si c’était son grain, en parlant d’image. Mais c’est vrai que Christine peint comme j’écris, au moins dans le rapport au temps, c’est-à-dire par des couches successives, un travail qui s’inscrit dans la durée et dont les strates, à la toute fin, donne à l’écriture sa densité et sa matière, son épaisseur.
Ce roman est marqué par une construction hypnotique, avec un style qui est marqué par la variation et le leitmotiv. Votre personnage, Christine, se réfère d’ailleurs à un album de Bach interprétées par Anne Gastinel. On pense à l’écriture d’un romancier portugais comme Antonio Lobo Antunes qui propose dans ses romans des sortes de symphonies désarticulées basées sur la variation et le ressassement, proche de la musique. Cherchez-vous avec l’écriture à atteindre une sorte de limite de l’écriture qui tendrait vers la musique ?
Cette question rejoint celle que vous me posiez au sujet de Claude Simon, et d’une dynamique de mouvement qui touche le phrasé, mais aussi la façon dont les éléments que draine la phrase s’articulent entre eux. Bien sûr, le phrasé ample est une façon d’embrasser le maximum d’éléments d’une réalité ou d’une scène ou d’un personnage qui m’échappe, dont je pense que je n’arriverais jamais à, littéralement, les cerner. Mais avec le phrasé dans son contenu, il y a la musicalité de la langue, sans quoi ce n’est rien, ça ne produit rien, ça ne vient d’ailleurs même pas, on reste en rade et rien ne s’écrit. Il y a les écrivains ornithologues, et les oiseaux. Les ornithologues maîtrisent leur sujet, conduisent leur livre en fonction de leurs idées et de leurs projets, et les autres, allez savoir pourquoi, qui, s’ils connaissent moins la grammaire et l’écorchent parfois, produisent un chant qui n’appartient qu’à eux ; c’est ce qui m’attire chez Lobo Antunes, sa musicalité, mais aussi sa façon folle de produire des images insensées et de les charrier dans un mouvement symphonique qui va très vite, qui s’interrompt, se rompt, reprend, se détourne. C’est un écrivain immense pour moi, pour toutes ces raisons qui sont autant de déraisons d’écrire, et rendent ça passionnant. Oui, ça pose la question de la limite, de la logorrhée dangereuse où tout finit par se confondre et le son se brouiller à force de se soûler de lui-même, car les écrivains sont à la fois la sirène et le marin : leur chant est leur force, mais il peut devenir un piège, un enivrement qui empêche un livre de se déployer sur d’autres plans importants – la structure, les personnages, etc. C’est un art de funambule, de ce point de vue.
Quand on vous lit, et notamment dans ce dernier roman, on pense à de nombreuses références littéraires comme Duras ou Claude Simon, dramaturgiques comme Edward Bond ou cinématographiques, telles que Chien de paille de Sam Peckinpah. Aviez-vous lors de l’écriture de ce livre des références de livres ou de films ? Et en quoi est-ce important pour vous avec le roman de tisser des liens avec d’autres univers ?
C’est important parce que c’est simplement naturel. Qui aujourd’hui pourrait prétendre n’être construit que par ses lectures ? Tout travaille dans ma tête à aller vers les livres que j’écris : les films, le théâtre, les arts plastiques et la littérature… mais on pourrait rajouter la vie, la vie toujours dans les mille et un détails qu’elle donne à tous les écrivains du monde toutes les minutes qui passent : le réel, les faits divers, les spéculations, l’immense récit aux milliards de voix qui s’élancent dans le monde chaque seconde, comme les gestes, les actions, et comme tout ce qui, pour ne pas avoir existé, mérite de trouver une place dans une fiction. Pour les films, je pourrais en donner deux qui ont servi très concrètement : La chevauchée des bannis, d’André de Toth, et The Visitors d’Elia Kazan, qui ont compté beaucoup pour moi. Deux films prétendument mineurs que j’aime énormément, et qui sont très liés à ce livre – chacun à une scène dont le livre s’est inspiré.
Il vous reste, chers lecteurs et lectrices, à vous plonger dans l’univers du roman de Laurent Mauvignier pour y tisser vos propres liens
Merci à Laurent Mauvignier de nous avoir accordé cet entretien.
Et Merci aux éditions de Minuit.
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
[one_half]
Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier
Editions de Minuit, septembre 2020
[button color= »gray » size= »small » link= »http://www.leseditionsdeminuit.fr/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/leseditionsdeminuit » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/editionsdeminuit/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/edeminuit?lang=fr » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]
[/one_half][one_half_last]
[/one_half_last]
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
Image bandeau : Photo fournie par l’auteur lui même – Droits réservés.