[dropcap]S[/dropcap]ur la photo prise le 21 janvier 1990 pour la fête d’anniversaire des trente ans de Clara que celle-ci sous-titrera plus d’un quart de siècle après, « Notre Clan avant la bourrasque», ils sont tous là. Quatorze personnes si on inclut celui qui prend la photo et qui ne sait pas encore que c’est une des dernières choses qu’il réalise en ce monde. Quatorze cubains qui ne peuvent imaginer ce que leur patrie va leur faire subir, de souffrance, de privations et de désespoir. C’est le benjamin de la photo, Marcos, six ans alors et désormais jeune immigré à Hialeah, banlieue à majorité cubaine de Miami, qui la montre à sa nouvelle petite amie, Adela, sur le tout récent compte Facebook que sa mère, demeurée à La Havane, vient enfin d’arriver à ouvrir malgré l’étroit contrôle du réseau cubain. Ce qui n’aurait dû être que le banal partage de la nostalgie pour son enfance et la mythique maison de Fontanar qui l’a abritée, prend un tour totalement inattendu lorsqu’Adela semble y reconnaître sa propre mère, enceinte. Sa mère c’est Loreta. La femme de la photo lui dit Marcos s’appelle Elisa. Tout le drame de Cuba est là dans l’écart entre ces deux prénoms : le passé qu’on nie, le passé qui vous rattrape. Avide de connaître ce passé cubain que sa mère a toujours refusé d’évoquer et rejette depuis de nombreuses années, Adela sent qu’une porte vient de s’entrouvrir et qu’elle n’en lâchera plus la poignée avant de savoir d’où elle vient, pourquoi sa mère souhaite oublier Cuba et a tout fait pour qu’elle ne soit qu’une simple petite américaine.
Maître dans l’art de raconter les destinées tumultueuses de ses personnages, Leonardo Padura ouvre avec cet argument une ample et vertigineuse fresque familiale, qui de New-York à Barcelone en passant par San Juan et Toulouse, conduira nombre des protagonistes à franchir ou pas la ligne de démarcation tant convoitée, mais tellement lourde de conséquences, entre le « partir » et le « rester ». Si le positionnement si complexe de chaque cubain face au désir d’immigrer constitue incontestablement le cœur du roman, le parcours des personnages pimente le récit des soubresauts de leurs amours, des trahisons et des trafics que le système communiste gangrené aura engendré, ainsi que des disparitions mystérieuses qui portent parfois ce texte aux limites du thriller. Il appartiendra à la complexe Loreta/Elisa au terme d’un long périple, d’apporter à sa fille les clés permettant d’expliquer ses choix de jeunesse, les conséquences qu’ils auront eues sur les autres membres du Clan, et de lui faire voir ces petits riens qui dans une vie permettent parfois de se sauver.
La construction de Poussière dans le vent qui alterne, au fil des chapitres, les pans de cette gigantesque histoire collective sert avec force et brio le propos. Retours en arrière, récits partiels ou interrompus, scènes identiques relatées à des moments différents ou par des personnages qui en donnent des versions différentes ou complémentaires, tout dans la narration dit la fragmentation des existences, les vies en morceaux, la dispersion qui ronge et dévore chacun. Aux allers et retours dans le temps que propose le texte, répondent les allers et retours dans l’espace des personnages, entre ailleurs et leur si inaccessible Cuba, que chacun quitte en sachant que les espoirs de retour sont quasi inexistants. « Comment avons-nous pu en arriver là » s’interrogera Clara de façon régulière au cours du roman ? Comment ces liens qu’ils avaient tissés si fortement entre eux, ont-ils pu à ce point se dissoudre et se maintenir avec une fidélité aussi profonde, et donner naissance à cette myriade éparpillée aux quatre coins du monde, plus heureux certes, mais au prix d’une douleur inexprimable.
« Il sentait que sa condition d’exilé, d’émigré ou d’expatrié […] l’avait empêché de penser même à un bref retour et l’avait condamné à vivre une existence amputée, qui lui permettait d’imaginer un avenir mais où il ne pouvait pas se défaire du passé qui l’avait mené jusque-là et à être qui il était, ce qu’il était et comme il était. La conviction de ne plus jamais avoir d’appartenance ne le quittait jamais. »
Leonardo Padura
Car ce que Padura nous restitue de main de maître c’est la vie quotidienne de Cuba au cours de la décennie 1990, ces pires années où les cubains en plus de la peur qui déjà régnait sur leurs vies, connaitront le manque de tout, la faim, le déclassement pour ceux qui avait un métier, la désolation et, plus que le reste, un sentiment d’humiliation et de dévalorisation d’eux-mêmes qui les fera se représenter en peuple maudit. Alors bien sûr chacun des personnages de la photo n’aura souvent qu’une idée en tête, partir. Partir à tout prix. Partir lâchement en laissant sa femme et ses enfants tout en sachant qu’on ne reviendra pas comme Dario, le père de Marcos et Ramsès. Partir en laissant une mère comme Ramsès et ensuite son frère, une mère qui vous accompagne à l’aéroport le cœur en mille morceaux mais qui sait que la seule chose qu’une mère peut encore donner ici à son enfant, c’est de vouloir de toute ses forces cet arrachement, qui ampute et libère tout à la fois. Partir en laissant sa fille comme Fabio et Liuba, en la confiant à des parents, mais sans savoir que vous la voyez pour la dernière fois, que la mort au loin rendra caduque la promesse que vous vous étiez faite de venir la chercher au plus vite. A chaque nouveau départ le clan s’effrite, les liens se distendent, le groupe s’éparpille. Curieusement, certains restent ; sans doute parce que leur fonction est de maintenir l’improbable lien avec Cuba sans lequel ils ne seraient définitivement plus rien, plus reliés à leur ile ; sans doute aussi parce qu’on ne peut méconnaître que le prix du départ organise une sinistre sélection.
« La fête se déroula, et ils burent, chantèrent, s’amusèrent parce qu’ils avaient besoin de boire, de chanter, et de s’amuser pour ne pas pleurer ou se couper les veines »
Leonardo Padura
L’exil, démontre Padura, est un malheur infini. Il annihile pour chaque personnage la possibilité d’être soi. Les liens financiers que les exilés maintiennent avec ceux qui restent à Cuba pour assurer leur subsistance, « les bouées de sauvetage » comme les nomme Clara, sont aussi la matérialisation de la dépendance psychologique à une terre qu’on ne peut plus observer que de loin, entre idéalisation et rejet. Même les années de « détente » des relations entre Cuba et les États-Unis d’Obama n’ouvriront pour les cubains qu’une fracture supplémentaire, entre ceux qui voudraient y voir un espoir et ceux qui n’y percevront qu’une ultime trahison. La décomposition du Clan, de cette belle bande d’amis à qui la vie aurait pu tout offrir, apparaît donc comme la plus romanesque et tragique illustration de la décomposition de Cuba dans ses années sombres. Leonardo Padura n’en finira sans doute jamais d’en conter les misères, les gloires et les cendres qui se dispersent comme Poussière dans le vent, comme s’il fallait sans doute plus d’une vie de romancier, fut-ce-t-il génial, pour comprendre « Comment avons-nous pu en arriver là » ?
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
[one_half]
Poussière dans le vent de Leonardo Padura
traduit par René Solis
Éditions Métaillé, 19 Août 2021
[button color= »gray » size= »small » link= »https://editions-metailie.com » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/Metailie/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/editionsmetailie/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/metailie » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]
[/one_half][one_half_last]
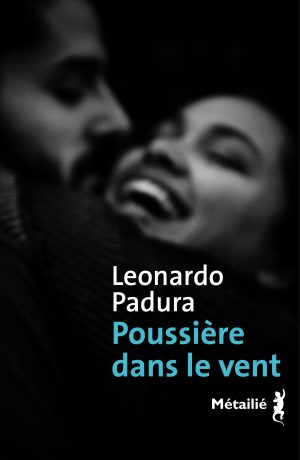
[/one_half_last]
[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]
Image bandeau : Photo by Tom The Photographer on Unsplash

















