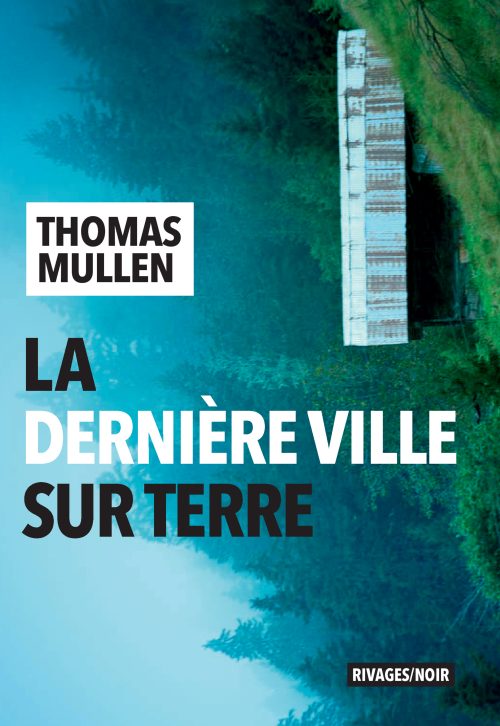Thomas Mullen vient de publier en France, 17 ans après l’avoir écrit, son tout premier roman, La Dernière ville sur terre, dont Barriga nous a parlé ici. Un roman visionnaire et lucide qui raconte l’histoire d’une petite ville du nord-ouest des Etats-Unis au moment de la grippe espagnole, en 1918. Entre guerre et pandémie, la ville de Commonwealth décide de se couper du monde… L’auteur venait en France pour la première fois, et, entre une table ronde et une séance de dédicace à Quais du polar, il nous a fait le plaisir de répondre à quelques questions. Merci à lui !

Quel effet cela fait-il de promouvoir un livre que vous avez écrit il y a 17 ans ?
En fait c’est plutôt intéressant, et même gratifiant. Il y a tant de livres qui sont oubliés ou introuvables que c’est agréable de constater que La dernière ville sur terre continue à intéresser les lecteurs. C’est très inhabituel, en même temps, et aussi excitant. Quelle que soit l’époque, quel que soit le pays, c’est passionnant de parler de ses livres. L’une de mes motivations quand j’ai écrit ce roman, c’était que l’idée même d’une pandémie mondiale, en 2006, était tellement improbable que cela en faisait un sujet unique. C’est à la fin des années 1990 que j’ai entendu parler pour la première fois de la grippe espagnole de 1918. Cela peut paraître bête, mais on n’en parlait jamais aux Etats-Unis. En cours d’histoire, on parlait de la Première Guerre mondiale, mais pas de la grippe. Cela m’a intrigué qu’une telle tragédie ait été oubliée. C’était si étrange, si différent… Et pendant 14 ou 15 ans, effectivement ce sujet est resté quelque chose d’unique. Jusqu’à la survenue de la pandémie. De ce fait, le lecteur d’aujourd’hui connaît une expérience de lecture très différente de celle du lecteur de 2006.
Avec le recul, votre livre est à la fois visionnaire et très lucide. A cause de la pandémie bien sûr, mais aussi de la guerre, depuis l’année dernière.
En fait, tout réside dans la psychologie : quand on écrit, il faut saisir la psychologie des personnages, cerner la nature humaine de façon précise. Si on y parvient, si on montre la façon dont les personnages agissent lorsqu’ils ont peur pour leur famille, lorsqu’ils sont préoccupés par leur vie professionnelle, alors cette précision peut s’appliquer à d’autres situations. Quand j’ai fait mes recherches, je me suis aperçu que beaucoup de scientifiques affirmaient qu’une pandémie allait survenir, que c’était inévitable. Alors bien sûr, j’espérais qu’ils se trompaient. Et quand c’est arrivé – heureusement, c’était moins dramatique qu’en 1918 – j’ai vu beaucoup de similitudes entre les deux crises. Ainsi, c’était très étrange de voir survenir dans nos vies des choses comparables.
Comment êtes-vous tombé sur ces histoires de villes isolées? Je crois que ces expériences de quarantaine ont eu lieu dans certaines villes.
Oui, c’est vrai. J’ai trouvé des documents sur ces villages où l’on pensait que le seul moyen de s’en tirer, c’était d’empêcher les gens d’entrer et de sortir. Ce qui provoquait des situations absolument tragiques : comment refuser d’aider des gens qui mouraient de faim, de soif ou de froid, comment leur tirer dessus de sang-froid ? J’ai essayé de comprendre les différentes perspectives, mais je ne sais pas ce qui est bien ou mal. Et c’est pourquoi il y a deux intrus dans mon histoire : j’ai voulu poser le pour et le contre des situations. Je pense toujours que cette grippe de 1918 était un moment tout à fait unique dans l’histoire, et pourtant tout à fait oublié. Il y avait quelques livres sur le sujet, mais très peu. C’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai écrit ce livre.
Personne n’est cruel, ni foncièrement mauvais : c’est une décision que j’ai prise délibérément. Je ne voulais pas d’un méchant…
Thomas Mullen
Vous évoquez aussi les luttes sociales et politiques, qui ont agité les États-Unis à la même époque, et dont on parle également assez peu. Était-ce aussi un de vos objectifs que de redonner une vie à ces combats ?
On connaît quand même un peu l’histoire des luttes ouvrières de cette époque, ne serait-ce qu’à travers Steinbeck ou Dos Passos. Mais c’est vrai que j’ai eu envie que cette histoire soit valorisée dans le roman.
Et la lutte féministe ?
C’était aussi une période très importante à cet égard. Il y avait beaucoup de théories complexes, de militantisme, de femmes très engagées, et une agitation politique considérable.
Comment êtes-vous passé de l’Amérique du début du XXe siècle aux années 40 à Atlanta, date à laquelle démarre votre trilogie « Darktown », consacrée aux premiers policiers noirs de la ville ?
Entre ce premier roman et la trilogie, j’ai publié un livre qui n’est pas sorti en France, à propos de dévaliseurs de banques pendant la Grande Dépression, puis une histoire d’espionnage mâtinée d’un peu de science-fiction. J’habitais à Atlanta, et j’ai voulu écrire quelque chose qui se situe dans ma ville, où je pourrais utiliser mes observations quotidiennes. Vous savez, le soleil du matin, les accents des gens, les choses qu’on fait à Atlanta, les fleurs qui éclosent, tout ça… Je voulais écrire une histoire sur Atlanta, et au cours de mes recherches, je suis tombé sur des documents sur les premiers policiers noirs recrutés à Atlanta en 1948. Ils étaient soumis à des règles choquantes : ils ne pouvaient pas arrêter les blancs, n’avaient pas droit aux voitures de police, ne pouvaient pas effectuer de contrôles dans les quartiers blancs. J’ai voulu comprendre comment cela pouvait fonctionner, comment ces hommes se débrouillaient dans une telle situation.
Pour revenir à votre premier livre, vous parlez d’une ville fictive, Commonwealth, née d’une idéologie qui est un mélange de socialisme et de capitalisme. Comment avez-vous créé ce lieu ?
Comme je l’ai dit, il y avait beaucoup de luttes ouvrières à l’époque. Certains cherchaient des modes de vie nouveaux, voulaient inventer de nouveaux systèmes, de nouvelles sociétés. J’ai découvert ces utopies qui se développaient dans cette partie du pays (l’état de Washington). Mais pour que l’histoire fonctionne, il fallait qu’elle se déroule dans une ville très isolée. C’est une volonté humaine naturelle que de vouloir laisser aux générations suivantes un monde plus juste, plus épanouissant.
Il y a un double enfermement dans votre livre : on s’isole de l’extérieur, mais on est également emprisonné à l’intérieur.
Oui, on veut créer un monde meilleur, mais on ne peut pas s’empêcher d’apporter avec soi des scories de notre passé. C’est impossible autrement…
A Commonwealth, les hommes et les femmes essaient de se faire confiance, mais cela ne fonctionne pas. Parce qu’il y a tant de secrets, et des ruptures.
Oui, il y a beaucoup de suspense. Les secrets, cela fait partie de la narration, et de la vie aussi. Parfois, l’écrivain décide de donner des indices au lecteur, sans pour autant livrer le secret tout de suite… Histoire de l’intriguer. Qui est cet étranger ? Pourquoi est-il venu jusque-là ? Que fuit-il ? Quel est son passé ?
Et puis il y a l’histoire de Philip, qui est bouleversante.
Je voulais que ce personnage soit jeune, qu’il se batte avec le monde, qu’il ait eu un passé difficile. Je le voulais à la fois timide et courageux, qu’il ait le souvenir de son enfance vagabonde en compagnie d’une mère instable. Il veut trouver une stabilité. Et oui, il est le personnage central du livre, avec Graham bien sûr.
Graham est quelqu’un de dangereux pour lui-même et pour les autres.
Dans ce livre, chaque personnage est persuadé qu’il fait ce qu’il faut. Personne n’est cruel, ni foncièrement mauvais : c’est une décision que j’ai prise délibérément. Je ne voulais pas d’un méchant… Le problème étant que faire ce qu’il faut, c’est parfaitement subjectif. Le bien de l’un peut être le mal de l’autre. Graham est une bonne personne, mais il veut protéger sa famille, il ne veut pas que ses malheurs passés se reproduisent et il est prêt à tout pour cela.
Vous avez là deux personnages incroyables, qui feraient deux formidables héros de film…
C’est vrai, j’aimerais beaucoup que cela se fasse, mais c’est une chose que je ne maîtrise pas.
Quels sont vos projets ?
J’ai un livre qui sort dans quelques jours aux Etats-Unis, un polar situé dans un futur proche qui oscille entre Blade Runner et Minority Report ! J’y parle de technologie, entre autres.
C’est très différent de votre travail précédent ?
Oui, j’ai passé plus de dix ans à écrire sur le racisme, et je voulais un vrai changement. Et j’ai un autre livre qui sortira l’année prochaine, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale : il y est question d’une journaliste à Boston, qui enquête sur de fausses informations destinées à dissuader les Américains de s’engager dans le conflit. Elle doit remonter aux sources, et prouver que ces informations sont fausses. Il y a donc une enquête criminelle dans un contexte historique.
Vous travaillez sur votre pays, et sur les conséquences que ses actions ont sur le monde.
Oui, mais je n’ai pas la vocation d’un romancier « historique » : j’aime raconter de bonnes histoires, et il se trouve que celles que j’ai choisies se situent dans le passé. Je suis tellement content que mes livres aient du succès en France : c’est la première fois que je viens ici, et je suis absolument ravi.